

Dans cet article vous allez découvrir l’histoire de notre rivière, contée par un auteur amoureux du Val de Drôme, Félix Grégoire. Récit lyrique mais néanmoins réaliste à lire avec des yeux du XIXe siècle.
Ce texte est paru dans le bulletin de la « Société d’archéologie, d’histoire et de géographie de la Drôme » sur une période de 1898 à 1901.
UN TORRENT, LA DRÔME
Je dois au grand rien débraillé de mon pays drômois mon goût de solitude et de plein air, mes primes sensations d’Alpe, mon vif amour des sources, des arbres, des vieilles pierres, des bonnes gens. D’où ces pages.
I
LES TORRENTS. LEUR RÔLE. ASPECT GÉNÉRAL DE LA VALLÉE DE LA DRÔME.
SON PASSÉ. LE VIEUX VOCONTIUM.
La tendre Madame Guyon, de mystique mémoire, reconnaissait des âmes dans les torrents. Aujourd’hui nous ne sommes plus ni aussi subtils, ni aussi croyants. Mais nous en coûterait-il beaucoup d’admettre la personnalité relative de l’eau, de ces eaux vives (font, fleuves, rivières ou ruisseaux) qui marchent, irrésistibles, à un but, et qui nous charment si délicieusement dans leur hâte chantante ?
Regardons couler le torrent du haut du pont. N’est-il point réellement une expression vivante ? Il naît, se développe et meurt. Il naît minuscule, soupçon d’eau sous la mousse, boit le lait de maintes fontaines comme maternellement penchées vers lui pour le nourrir, puis il se gonfle et se cabre, déjà fort, prend du large, broie des rocs, saute des rapides, badine entre les prairies, enfin il devient un grand corps, absorbe de droite et de gauche des « rieus » fous précipités sur lui. Il dessine nettement un val, un pays, tour à tour le féconde et le dévaste, mais en lui imprimant toujours son tempérament, son caractère. La source jadis fut un dieu. Qui s’en étonnerait ? N’est-elle pas la raison d’être de l’oasis, du hameau, la preuve magnifique et touchante de la vie ? N’entendons-nous pas le paysan donner à l’eau, suivant ses multiples aspects, suivant son bon ou mauvais rôle toutes sortes d’épithètes chrétiennes ? Les savants expliquent quelquefois la nature — mais les gens simples la comprennent toujours.

Montons aux Glandas. C’est la merveille du Diois. Sauf le mont Aiguille, plus effrayant peut-être, rien n’égale ce fauve, ce fantastique plateau d’Arabie miraculeusement suspendu dans les airs. Sa stature est belle — deux mille vingt-cinq mètres — et, comme la plupart des monts qui l’entourent ne lui viennent guère qu’à la ceinture, Glandas se présente au-dessus des serres, becs, pics, pots (1), buts, récifs de toutes couleurs dont la région tourmente son ciel bleu, telle une terrasse sereine où s’observe la vie pastorale et d’où l’on contemple l’ancien diocèse de Die dans ses hautes et basses paroisses, dans l’étrange chaos jurassique de son territoire.
Là, le premier berger venu, avant l’homme de science, avant vous, a vu cela, et il a senti sûrement l’âme de la contrée, Il s’est expliqué la manière d’être du torrent. Il en a senti les besoins, les aspirations. Mais ce n’est guère qu’aux vents du ciel que l’homme de la montagne jette ses secrets.
Réellement, ce val de la Drôme vu du Glandas, n’est autre qu’un couloir tortueux, tout en poches, en étranglements, en « clus », sombre, puis lumineux, puis sombre encore, où se blottissent comme ils peuvent les hameaux et les villages, où les villes sont trop modestes pour que rien n’en monte jusqu’à ces hauteurs, où les ruines rutilent, presque féroces, encore qu’elles n’inquiètent plus. Car ce val est encombré de rocs et de souvenirs; car l’humanité s’y montra telle que nous y voyons la nature : violente, excessive, héroïque et trop souvent cruelle. Dans nulle autre région du Dauphiné et même de la France, les luttes religieuses ne firent plus de victimes, n’allumèrent plus d’incendies que dans le Diois. C’est que le clergé constituait ici à peu près à lui seul l’élément supérieur. L’évêque de Die, seigneur suzerain de sa ville, détenait au moyen-âge le pouvoir municipal et judiciaire, ou du moins en disposait pour ses créatures. C’était un véritable souverain qui prétendait régler toutes questions politiques. Quand les populations foulées, quand les princes voisins humiliés cherchèrent à secouer le joug, la révolution prit tournure religieuse. Et voilà pourquoi la ville épiscopale de Die put devenir un jour l’un des remparts du protestantisme, une petite Genève, le siège d’une académie huguenote longtemps florissante. La vallée de la Drôme avec ses vallées affluentes compte encore aujourd’hui près de dix-huit mille protestants sur cinquante mille âmes. Elle en comptait trente mille avant la révocation de l’édit de Nantes.
Depuis qui sait le temps, comme disent ingénument nos villageois, depuis qui sait le temps la Drôme est Drôme ? Difficile problème que je ne résoudrai pas. Car, si à l’égal de l’homme, un cours d’eau n’a pas la durée, il a une durée auprès de laquelle nos jours ne sont rien. D’ailleurs, et j’en ai bien du regret, la spécialité du géologue me manque, et je n’ai guère davantage celle de l’archéologue et de l’historien. Je n’essaierai donc d’écrire ici tout bonnement que ce que j’ai vu et senti, ce que j’ai pu saisir des particularités sociales et morales, des caractères locaux de cette région si pittoresque et si variée, à laquelle je garde une âme dévote.
11 est infiniment probable que la vallée de la Drôme — ride à peine sensible parmi l’expansion alpestre — a subi la plupart des phénomènes que les géologues attribuent à cette expansion. Le fonctionnement d’un cours d’eau est un de ces phénomènes tellement familier à nos yeux que nous cherchons à peine à nous l’expliquer. Et sans doute, les anciens qui ignoraient à peu près la géologie, furent durant le cours des siècles, les spectateurs charmés et muets de pareils phénomènes. Aujourd’hui, nous savons à peu près comment se façonna à l’origine le couloir d’une vallée, comment se fît après des tressaillements sans nombre, des retraits, des surrections, le sinueux chemin d’eau, et comment il trouve, de par la relation étroite entre les divers agents atmosphériques, de par les rapports certains entre la terre et l’océan, une alimentation constante. Le fonctionnement de notre Drôme n’a eu lieu, on le conçoit, qu’à la suite des diverses révolutions qui marquèrent chacun des âges préhistoriques, puis, après sa constitution parfaite, le glacier(2) vint, inattendu, inexpliqué, terrible, fermant sources et fontaines, reculant jusqu’au Rhône à Valence, peut-être beaucoup plus bas jusqu’à Pierrelatte ou jusqu’à Avignon toute la contrée, l’effaçant du monde sous sa dalle immense. Enfin, le glacier remonta, le pays se reprit à vivre, le torrent coula de nouveau à l’air libre, et peut-être qu’à ce moment-là parurent les premiers hommes de la vallée : les Prévoconciens.

La Drôme, enfant sauvage et sournois, a eu naturellement, comme tous les cours d’eau de l’ancien monde, ses historiographes. Depuis les Romains, familiarisés avec elle de haute antiquité et qui connaissaient fort bien son caractère inconstant, on peut dire qu’elle n’a cessé de faire parler d’elle. Géographes, historiens, ingénieurs, hommes de loi, archéologues, économistes, et enfin érudits de tout poil se sont occupés et préoccupés de là Drôme. Rien de plus intransigeant, on le sait, que le moyen-âge, sur les questions de frontières, de bornage, de licences, de droits. Notre torrent ne faillit point à son caractère durant l’âpre période et il faudrait un volume pour énumérer les disputes — presque toujours occasions de guerres — dont il fut l’objet.
En ce qui concerne les vieux Voconces, ancêtres des Diois, Mr Camille Jullian nous présente ce vaste agglomérat, comme » un îlot de traditions celtiques, de même que Marseille était une enclave grecque, au milieu de colonies romaines et latines. »
» Dans la région de l’Ouvèze et de la Drôme, dit encore le même écrivain, la nation celtiques des Voconces présentaient ses trois villes de Luc, de Die et de Vaison. Les Gaulois, hommes et dieux y régnaient à peu près en maîtres. Ils occupaient les montagnes, laissant la plaine et les bords du grand fleuve aux Romains. Les Voconces d’ailleurs, n’en aimaient pas moins que ces derniers, les choses et les arts de l’Italie, et les bords de l’Ouvèze et de la Drôme étaient couverts de villages et de villas où se montraient les élégances d’un luxe tout arlésien. » Ajoutons que Die, Vaison, et peut-être quelques autres villes moins notables, avaient un cirque et un théâtre et leurs curateurs de jeux, que les routes du Vocontium étaient parmi les plus fréquentées des Alpes et nous aurons un tableau fidèle quoique restreint de ce vaste groupement.
La Drôme, avec ses dieux indigènes, ses traditions romaines de la plaine, celtiques de la montagne, semble la veine la plus pure de notre vieux Dauphiné, et tandis que la plupart des torrents alpestres semblent emporter irrémédiablement dans leur flot ce qui subsiste du passé, elle, paraît demeurer fidèle à son âme ancienne, ou du moins, elle se défend encore. Ses peuples parlent français, mais ils aiment à chanter et à rire en patois, et ce patois est une langue gaillarde et un peu rude qui fleure bon la montagne, qui révèle tout de suite la race dans son intimité charmante.
(1) Pot (podium), synonyme de puy, mot qui sert à désigner un grand nombre de pics de l’Auvergne.
(2) Période glacière dont l’existence a été affirmée par tous les savants.

II
PLASTIQUE DU DIOIS. SA CARACTÉRISTIQUE. LE CHEMIN D’HANNIBAL. ANCIENNES FORÊTS. EFFETS DE LA DÉFORESTATION. LA DRÔME NAVIGABLE. LE CHEMIN DE FER DE LIVRON A VEYNES. CLIMAT.
Le Diois est rude. Une houle tumultueuse de cimes fières, de cirques déchirés, de plateaux sauvages, de roches bizarres, d’escarpements inouïs, de chaînons enchevêtres, entrechoqués, souvent sans direction apparente, sans soudure appréciable et sans une plaine vraiment digne de ce nom ; houle crispée surtout vers le Levant, et encore assez moutonnante au Couchant pour soulever en regard du Rhône l’admirable vague de Rochecolombe, haute de neuf cents mètres, voilà sa plastique. C’est le calcaire des monts de Grenoble, si fiers de tournure et proches parents du Jura par la constitution. Et le Diois présente d’ailleurs la plupart des accidents jurassiques : gouffres, cassures vives, forteresses saisissantes portant créneaux et redans, fontaines de cristal, pertes de rivières, châteaux d’eau charmants. Mais le Jura, de toute grâce, de toute fraîcheur, est dans l’ensemble trop uniforme. Ses ballons, ses plateaux les plus élevés ont même caractère, mêmes lignes onduleuses et molles. Ici, toutes les formes, toutes les postures — et elles sont infinies — de la montagne, et déjà Tardent midi les dore, les étiquette de noms d’une sonorité particulière. Nombre de hautes croupes s’appellent serres, et c’est le nom des chaînes espagnoles(1). Pour d’autres, la gaillardise dauphinoise se donne librement carrière. C’est ainsi qu’un passage curieux et peu fréquenté, où prend sa source le ruisseau de Grimone, en vue de la Croix-Haute, se baptise col de Vente-Cul. Et ces désignations pittoresques du populaire ne s’en tiennent pas à la montagne. Elles caractérisent tout aussi bien la forêt, le pré, le champ, la fontaine, le ruisseau, le torrent, la ferme, le hameau, le village. D’instinct, l’homme d’autrefois donnait signification réelle aux choses de la nature. L’Embout, c’est le nombril, le village situé de telle façon qu’il fait cicatrice dans le paysage. La Bégude, l’endroit où l’on s’arrête pour boire. La Besantie, un pays gris ayant la forme ou la couleur du gâteau de maïs dauphinois. Le Merdari, c’est le ruisseau « brenneux » où chacun se soulage et que les orages nettoient. Tandis que les pierrailles du Rieusec et de Brame-Vache hurlent la soif.

Le Diois, dans les plis de ses monts, cache des merveilles. Il n’a pas, il est vrai, les neiges éternelles et c’est grand dommage pour la constance de ses rivières aussi bien que pour la majesté de ses panoramas. Mais si ses roches s’effacent devant les gloires étincelantes du Pelvoux et de Belledonne, on les sent aussi plus près de soi, et disons le mot, plus humaines. De plus, on les contemple avec fruit, chose rare et dangereuse sur les géants alpestres. Quelques-uns des défilés drômois comptent parmi les plus admirables de France, s’ils n’en sont pas les plus célèbres, et ses portes, arcs de triomphe naturels, s’ouvrant tout-à-coup sur la féerie verte de vallées idylliques, n’ont de rivales dans aucune Alpe.
Point de lac. Ces nappes transparentes que l’on rencontre parfois dans l’Isère et dans les Hautes-Alpes à plus de six mille pieds ne pourraient tenir ici. Le sol criblé de trous, fêlé, fissuré, prodigieusement perméable, et qui a dû l’être beaucoup moins jadis, n’assemble aucun de ces miroirs si chers aux touristes et qui doublent tout aussitôt la beauté d’un site. Par contre, des grottes profondes, dont quelques-unes très imparfaitement explorées, recèlent stalactites et stalagmites. Il en est maintenant qui approvisionnent de glace certaines localités, d’autres qui vomissent subitement le flot de toute une rivière.
Le Diois enfonce une sorte de coin entre l’Isère et les Hautes-Alpes, et par là vient battre contre l’escarpe haillonneuse et hautaine du Dévoluy. C’est son dernier bouillonnement, et il y met toute sa fougue. Là, des montagnes, dévêtues par l’homme et rudoyées par les vents et les averses, lèvent leurs têtes chauves entre deux mille et deux mille cinq cents mètres. A leurs pieds s’étale le ravissant paysage de Lus-la-Croix-Haute qu’on n’oublie jamais une fois qu’on l’a vu. Des villages tout luisants de bonheur et de santé, des ruisseaux d’argent, des rocs feutrés de mousse, d’ondoyantes prairies, et comme fond de tableau le vert grave des sapins et des mélèzes escaladant le lilas gris du Lauzon, de Costebelle, de L’Aiglière, du Rama et des Aiguilles, cette heureuse et salutaire nature non seulement vous réjouit les yeux, mais vous prend aussi l’âme parla magnificence de son repos, par l’impression forte de sa vie simple et comblée. Le col de la Croix-Haute (1179 mètres) est le plus haut point de la ligne ferrée de Grenoble à Marseille. Par son maître courant le Trabuëch, plus tard grand Buëch, cette région s’égoutte tout entière dans la Durance. De même, la Vernaison, la Vèbre, l’Ouïe, rivières dioises pour tout ou partie, ne s’épanchent pas dans la Drôme et travaillent pour le compte d’autres affluents ou sous-affluents du Rhône.
Notons en passant que la commune de Lus-la-Croix-Haute, plus vaste que Paris, est avec ses neuf mille hectares(2), l’une des plus amples de France et, avec ses quinze hameaux, l’une des plus sporadiques.
Nous l’avons vu, la civilisation gagna de bonne heure le pays. C’est que l’entaille de la vallée de la Drôme, malgré ses « clus », ses étranglements, séparant la bousculade des monts en deux parties franches, forme en réalité un sillon de pénétration remarquable. Par cet escalier facile, ouvert largement sur la rive gauche du grand fleuve, chemin du pain et aussi des guerres, on pouvait gagner le cœur même de la région alpestre.
Du Rhône au pied du col de Cabre, en effet, sur une distance de près de vingt-cinq lieues, c’est à peine si l’on s’élève de six cents mètres, soit un peu plus de la moitié de l’altitude totale de ce col au-dessus des mers. Montée fort douce en somme et que dépassent de beaucoup les routes du plateau central, des dômes et des puys.
Frappés de ces avantages, certains historiens n’ont pas hésité. Ils ont fait à notre vallée l’honneur de la visite du grand Hannibal marchant sur Rome. Ils ont supputé ses étapes, l’imagination montée en croupe et galopant avec les brillants cavaliers numides. Ainsi, des Africains véhéments, des éléphants, tours ambulantes et offensives auraient bu à notre Drôme, plus de deux siècles avant Jésus-Christ ! Version plus vraisemblable dans tous les cas que celle du passage par la vallée de l’Isère. Mais il nous en faut rabattre, dût notre amour-propre en subir quelque atteinte. M. Louis Montlahuc a consacré vingt ans de sa vie à étudier la question, il connaît toutes les vallées et tous les cols de nos petites Alpes, et fort de son expérience autant que d’un examen scientifique approfondi, il affirme : Hannibal est passé par là, il n’a pu passer autre part. Avec un flair tout dauphinois, l’auteur évente les traces carthaginoises et nous mène à la suite du guerrier dans les plaines du Pô.
» Il est probable, dit M. Montlahuc, que le Carthaginois eut d’abord l’intention de passer par Dea Augusta, où la voie était plus battue, où la vallée est plus large, mais en général habile, avant de se mettre en marche d’Espagne, il voulut s’allier tous les petits chefs gaulois, sur les terres desquels il devait passer. Dans ce but, et celui aussi de reconnaître la route, il avait dépêché des courriers à tous ces petits rois. A l’exception des Voconces du Nord qui occupaient la vallée de la Drôme et avaient Dea Augusta (3) pour capitale, tous promirent leur concours et le passage. «
L’auteur dénonce plaisamment le cas de ces historiens qui, mettant en pratique le proverbe : Tout chemin mène à Rome, ont eux-mêmes, de leur cabinet de travail et sans jamais avoir foulé un pays d’Alpe, tracé sentencieusement son chemin à Hannibal. N’ayant pas réussi à retrouver la rivière appelée « cyapokr » par Polybe, ils en imputent la faute au texte même : Scoras, c’est une erreur, écrivent-ils, c’est Isaras (l’Isère) que Polybe aura voulu mettre.
Or, la grande affaire était surtout de retrouver ce Scoras, mais de façon honnête et sans accuser les textes. Et ce Scoras, si déconcertant, M. Louis Montlahuc a fini par le découvrir. Fils des monts de la Drôme, c’est l’Aygues, dont la dénomination ancienne transparaît clairement dans l’Esclate, une des branches mères de la rivière de Nyons. Et voilà fixé pour toujours, ce semble, un des points de l’histoire les plus débattus, les plus décourageants. Mais on en glosera encore….
(1) Les sierras.
(2) 8820 hectares
(3) Au temps d’Annibal, cette capitale était plutôt Luc.

L’œuvre de civilisation dans la montagne fut hélas souvent, trop souvent, l’œuvre de destruction. Qui croirait à voir le Diois si nu, si pierreux, si ardent, si fauve, qu’il fut jadis noir de forêts ? Presque partout le bois y effaçait la roche, noyant d’un vert implacable plis, replis et vallons. Des cimes que nous voyons chauves, aucune qui ne fût magnifiquement encapuchonnée. D’ailleurs, à tout prendre, la Gaule n’était-elle pas, comme sont encore des parties de l’Afrique et de l’Amérique, une mer d’ombre épaisse et sauvage, une mer dans laquelle l’étranger ne se risquait qu’en tremblant et cuirassé du triple airain du poète? A l’imitation de leur sol, les gaulois étaient chevelus comme aucuns barbares. Mais si les cheveux repoussent, les forêts ne reviennent pas, et il semble que ce siècle ait entrepris de pousser à bout hommes, animaux et choses.
Seul alors peut-être parmi les fleuves de notre patrie, le Rhône présentait une voie commerciale, active, battue de Phéniciens ou de Massiliotes, et les emporium du Rhône dataient-ils même de toute antiquité. Partout ailleurs, les vieux, les durs légionnaires sentaient leur cœur chavirer à pénétrer dans celte Hercynie. Les Voconces, sans grands besoins, ayant herbage dans les bas-fonds et glandage sur les coteaux, menant une vie simple et de tout point conforme à la nature du lieu, firent peu de mal à la forêt, protégée d’ailleurs par une multitude de divinités topiques, par les croyances touchantes aux esprits de l’arbre et de la source. Ils étaient surtout pasteurs, chasseurs et pêcheurs, et s’ils se livraient à des échanges avec les trafiquants du Rhône ou avec leurs voisins de la haute montagne, c’était occasionnellement et relativement à un petit nombre d’objets. Les mœurs d’un peuple, sans commerce et sans relations extérieures, ne s’altèrent pas. Elles restent à peu près immuables.

Un fait digne de remarque dans l’antiquité, c’est l’amélioration sociale résultant de leurs défaites chez la plupart des nations vaincues. Avec les Romains, maîtres de la Gaule, les conditions de la vie devaient changer fatalement dans cette vaste contrée. Nos ancêtres, vaincus des premiers, furent des premiers aussi à recueillir ces avantages moraux. Sans perdre leur originalité, leur vieux fond celto-ligurien, ni cette humeur grivoise dont nos Diois actuels semblent avoir hérité, ils subirent l’impulsion latine, ils adoucirent leurs façons barbares, prirent goût au bien-être et aux choses de la civilisation. Une grande route établie le long de la vallée unit les villes principales d’Augusta (Aouste), Darentiaca (Saillans), Dea (Die) et Luco (Luc) avec Valentia et Vienna d’une part, et de l’autre avec Milan et les Alpes par le col de Cabre (Gaura Mons) et le mont Genèvre (Matrona Mons). En peu de temps, la population doubla, et alors commencèrent, contre ces drus ombrages dont les légions s’effrayaient jadis, des violences constantes, terribles, administratives en quelque sorte. Sur ces terres nouvelles où les émigrants succédaient aux émigrants, il fallait s’établir et vivre, et on ne le pouvait qu’en repoussant au fur et à mesure la forêt partout maîtresse. Bientôt, l’on vit les cultures assiéger les coteaux et verdoyer la vigne sur toute pente bien orientée. Le blé et le seigle frissonnaient autour des villes et des villages.
Pourtant, la part de l’ombre était encore belle au Moyen âge. Elle couvrait toute cime un peu fière, elle cernait d’une solitude immense l’abbaye, parfois aussi le château fort et le village. Cela gênait. Pour faciliter leurs opérations, catholiques et protestants, durant les guerres religieuses, brûlèrent des milliers et des milliers d’hectares. De nos jours, par leurs chèvres impatientes, à la dent jamais lasse, par leurs troupeaux bêlants, par la mise en coupe réglée du noyer et du chêne, les paysans ont consommé la ruine de l’arbre. Et la ruine de l’arbre, c’est la ruine de la montagne, c’est la mort de l’oiseau, c’est le soleil qui fane toute culture, c’est la font qui se ferme, c’est la désolation, c’est l’exode de la vie.
Sur certains points, le Diois, fait de schistes sans consistance, qui n’ont, pour les retenir, ni gazon, ni plantes, ni arbres, se disloque tout-à-coup sous les orages diluviens, et dégringole et saute pêle-mêle avec le flot gris de ses torrents, jusqu’au Rhône, jusqu’à la mer. Sur d’autres points, ce sont des canonnades ou avalanches de pierres : un bloc roule qui en entraîne un autre, et les rocs, comme mus par une puissance diabolique, bondissent et pétaradent avec un bruit terrible, arrachant avec eux et entraînant dans la plaine une bande de l’épiderme du mont.
Qui ne voit dans ces phénomènes, les représailles de la nature? Qui ne sent, dans le précaire équilibre de certaines roches, le châtiment des méfaits humains? Le berger qui passe au pied de ces escarpements branlants, arrête sa chanson et se hâte. Quand il est hors d’atteinte, il se retourne et jette une injure à l’impassible mont qui l’a épargné. Les Italiens ont un joli mot pour peindre ce sentiment-là : » Le péril passé, disent-ils, on se moque du saint. «
Qu’était la Drôme de l’ancien Diois magnifiquement vêtu de forêts ? On la suscite sans peine. Quoique capricieuse déjà et sujette à des colères, elle versait au Rhône un flot plus abondant et surtout plus égal qu’aujourd’hui. Elle avait un lit moins large et mieux rempli et elle ne se traînait pas, comme nous la voyons les étés, parmi des blancheurs réverbérantes de grèves, maigre, usée, folle, esquivant à grand’peine la traîtrise des graviers. C’était une assez gaillarde commère ayant ses lunes certes, mais serviable et d’humeur suffisamment égale. Sa vivacité même tournait au profit de son entourage.
Lâchons le mot : la Drôme portait bateau au temps des Voconces et bien avant dans le Moyen âge. Et tant pis pour l’épigraphie qui n’a point encore exhumé la bienheureuse pierre probante. C’est assez de son affirmation catégorique en ce qui concerne les deux cours d’eau voisins de l’Ardèche et de l’Ouvèze pour nous permettre d’affirmer aussi par simple comparaison. Attribuer le caractère de navigabilité à ces deux rivières, et le refuser à la Drôme, cela ne paraît pas possible et la plus superficielle observation s’y refuse. En effet, le superbe torrent Gavoit, à peine aussi long que le nôtre, dans une conque à peine supérieure, offre une pente autrement considérable, ce qui n’est pas pour faciliter la batellerie ; de plus, cette pente tortueuse à l’extrême se répartit de façon fort inégale. Quant au « rieu » des Baronnies, qui ne draine qu’un fort étroit bassin, ce serait un très pauvre sire, s’il n’avait le bon esprit de tomber à point dans la Sorgues, attachant ainsi sa maigre fortune à l’urne immortelle de Vaucluse. Enfin, dans un acte de 1450, le Dauphin Louis (depuis Louis XI) dit que la Drôme étant navigable, lui appartient comme seigneur supérieur et comte de Valentinois et de Diois et nullement à autre part, ce qui est un droit de régalle.

Ainsi, nos ancêtres descendaient la Drôme dans des barques plates à faible tirant d’eau, de Die au moins jusqu’au Rhône. ‘Les routes, avant la grande voie romaine de Valence au col de Cabre, n’existaient pas, à peine des sentiers ou mieux des frayés, c’est-à-dire de dangereux chemins créés seulement par l’habitude qu’on avait à y passer, et non par le travail de l’homme. De tels chemins sont fréquents encore dans nos montagnes où l’on utilise même, pour se rendre d’un village à un autre, le lit desséché d’un torrent, le fond d’un ravin. Les raccourcis, les accronches, joignant les lacets des grandes routes, ne sont autres le plus souvent que des voies anciennes.
Par exemple, quand ils voulaient revenir chez eux, les bateliers de la Drôme devaient sans doute se transformer en muletiers, la rivière étant trop rapide pour pouvoir être utilisée à la remonte.
Tout usé qu’il est, le Diois donne encore refuge à l’ours. Là, parmi les vestiges superbes de forêts millénaires, bois inaccessibles, brousses inconnues, rocs hirsutes, Martin vit son roman d’ermite. Le mal léché vaut mieux, cent fois, que sa réputation. L’homme, pour excuser son plaisir de détruire, à toujours dit du mal des bêtes, et dans les histoires d’ours on peut toujours être certain que c’est l’homme qui a le mauvais rôle. Il est des soirs où le bon lourdaud s’ennuie dans sa solitude. Que se passe-t-il alors dans son âme naïve et peu complexe ? Songe-t-il que l’homme, qu’il sait d’ailleurs méchant, pourrait se raccommoder avec lui, devenir son ami ? On le croirait. Martin, tout en flairant longuement sur l’opportunité de sa démarche, s’en vient parfois tout près d’un jasse(1) ou d’une grange et quête en se dandinant une démonstration amicale. Souvent c’est un coup de fusil qui répond… Et nous voulons que les bêtes nous aiment, qu’elles ne montrent jamais la griffe, leur naturel ! Une, deux, rarement trois peaux d’ours vendues chaque année, tel est le bilan de ces chasses absurdes. Et l’on pourrait prévoir le moment où le dernier représentant de la race plantigrade, où le dernier de ces bons ours aux rêves pacifiques, aux plaisirs simples, aux dandinements si expressifs, viendrait à disparaître, si l’administration forestière, avec une ténacité admirable et insuffisamment encouragée, ne s’apprêtait à rendre peu à peu notre Diois à son ancienne nature. Et ainsi les terres se recollent, les rochers se remettent, et la Drôme déjà quelque peu améliorée, n’a plus tant de délires et ne demande qu’à redevenir navigable. Nous ne verrons pas cela, mais nos arrières-neveux nous devront cet ombrage et le reste.

De part en part, on peut traverser le Diois en chemin de fer, la Drôme prêtant son val à la ligne de Livron à Briançon. La gare de Livron, mère d’un autre embranchement qu’elle envoie incontinent chercher sa vie dans l’Ardèche, au cœur du pays des châtaignes, à Privas, a ainsi son importance. De la sorte, Loriol, malgré l’avantage moderne de sa situation en plaine, n’a pu détrôner sa rivale, la petite cité huguenote, le cauchemar de Henri III.
La ligne de Livron à Briançon semble étroitement unie à notre torrent. Elle le remonte presque jusqu’à l’origine, elle en épouse tous les caprices est c’est à peine si elle consent à le perdre de vue dans les passages les plus difficiles. Sur le territoire de Beaurières, on pourrait croire que le double ruban d’acier, fidèle jusqu’au bout au ruban d’onde, va s’insinuer dans la gorge natale et transpercer l’Aup-Duffre afin de voir venir au monde la première font drômoise. Il n’en est rien pourtant. Les ingénieurs — à tort peut-être — préoccupés par la tradition, préférèrent le col de Cabre. C’est par là que la voie romaine descendait au pays des Tricoriens. Et la grande route actuelle suit dans ses grandes lignes le frayé romain.
Lentement, prudemment, dévotement, ce train d’alpe égrène ses stations, à raison d’une par vingt minutes. Vieux wagons courts et bas, qui geignent et qui tanguent à tout propos, vieille locomotive mastoque et asthmatique, c’est un matériel à la retraite, une théorie d’éclopés que l’on mène — tant qu’ils durent — à la promenade sur les voies peu battues des lignes stratégiques. Toutes les gares-bifurcation abritent de cette antiquaille. C’est sous les vastes toits en auvent de cambuses lépreuses et fuligineuses, de pauvres diables d’hospitalisés à l’air frileux et morne, à la robe passée et ridicule, qui essaient d’échapper aux regards aussi bien qu’à la corvée. Car si elle leur donne asile, la compagnie ne les ménage guère ces roulottes antiques, aïeules toussottantes de nos sleeping-cars. A elles, comme par une sorte de dérision, l’étrenne des voies nouvelles, les rampes dures, les chocs imprévus qui les font tressauter jusqu’au tréfonds de leur vieille âme de bois. Leur sort rappelle assez bien celui de ces lamentables mulets qu’on finit en montagne. Après vingt-cinq ou trente ans de bons et loyaux services, ils avaient bien acheté, ce semble, le droit aux travaux faciles, aux courtes besognes coupées de longs repos. Eh bien ! non, les pauvres bêtes, haut bâtées, — je l’ai vu au Glandaz — vont chercher tous les jours jusqu’à deux mille mètres et plus le fumier des transhumants pour le descendre dans les hameaux ou dans les fermes des bas-fonds. Pas de chemins, à peine des sentiers de chèvre, et des pentes terribles, hachées de ravins vertigineux. Que l’animal se brise, le paysan songe : petite perte. A la foire prochaine pour cinq ou six écus, il aura un autre mulet, une autre vieillesse à crucifier.
Foin des rapides de la grande ligne de Marseille, ces ouragans de fer lâchés à l’esbroufe dans l’allongement infini des paysages, et qui donne au voyageur la sensation d’une nature en démence furieuse, de sites pleins de rage qui vous sautent aux yeux ! Notre train est raisonnable, lui. Ces emballements ne sont plus de son âge, Aussi la garde-barrière l’espère tout bonnement sur sa chaise en tricotant ses bas. Puis elle rit et fait des signes quand il passe, car, toujours, quelque connaissance apparaît aux portières.
O ces stations du chemin de fer de Die — grains d’humanités poussés à l’aventure dans des lieux négligés et quasi sans âmes — stations seulettes et blanches qui étiquettent tel village introuvable, perdu à travers monts dans son innocence et sa sérénité ! On s’arrête. Une casquette impérative, brodée d’un P. L.M. d’or souligné par des feuilles de chêne, frémit, s’agite, va, vient le long du quai, tente de faire croire à l’assaut des voitures par une foule débordée. Un nom qu’on entend mal est jeté cinq ou six fois aux portières indifférentes. Et, si par hasard on se penche, on s’aperçoit qu’on vient de s’arrêter pour rien, si, pour cette casquette ! De foule point. La gare est vide. Hors les jours de foire, ou encore les jours de vogue, le train de Die ne chauffe guère que pour quelques voyageurs. Nos montagnards, tous assez drus pour rouler char ou charrette, boudent au chemin de fer. Ce luxe ne semble pas fait pour eux.
La région industrielle et commerçante de Crest mise à part, le Diois est par excellence la contrée des petites gens, des petits moyens. Il y a bien trace d’industrie ici et là, et la population largement dosée de protestants, est loin d’être inactive (elle est même fort ingénieuse), mais il n’y a nulle part l’un de ces ateliers, l’une de ces mines qui chiffrent par millions leurs affaires, qui drainent jusqu’à eux le sang jeune et la vie des campagnes. Au vestibule des monts, la vigne, qui sert à la fabrication d’une pétillante clairette et le mûrier qui, pendant quelques semaines, s’effeuillant jusqu’à sembler mort, vient compliquer la ferme d’une magnanerie, c’est-à-dire d’un atelier où l’on éduque le ver à soie, mais le pays n’en demeure pas moins pastoral dans la montagne et agricole dans la plaine.
Tous propriétaires ! N’est-ce pas l’idéal merveilleux à quoi tend l’effort humain dans ses manifestations multiples ? Eh bien, ce rêve, il est bien peu de Diois qui ne le réalisent. La terre est morcelée à l’infini. A chacun sa parcelle. A chacun l’âne ou le mulet pour le transport, le cochon noir et agile, vivant dehors et qu’on saigne à la Noël, la chèvre pour la tome ou le fromage, le mouton pour le commerce, et souvent la ruche d’abeilles. De tels pays sont-ils pauvres ? Oui, si l’on considère l’argent, le capital dans les applications effrénées de la vie courante. Non, si l’on s’arrête à l’idée simple du travail commandé par les milieux, par la nature. Les grandes villes, les villes riches, brassant l’or, fourmillent de sans-asile, de loqueteux, de faméliques, de gens qui brament leur misère et leur haine jusqu’à la mort. Au lieu que le pauvre est ici une très rare exception, s’il existe même. Si l’impôt n’était pas si dur, si la terre ne glissait pas trop souvent dans le torrent, si le fonctionnarisme n’était pas le prurit que chacun, complaisamment avive, le Diois, avec son existence peu chargée, n’abandonnerait point sa patrie. La restauration de la montagne fera-t-elle un jour ce miracle de retenir les populations chez elles ? ou bien, si elles s’essaiment, ne pourront-elles, par le souvenir, doux au cœur, des beautés abondantes de la terre natale, venir s’y reposer et mourir ?
A Gumiane, commune très reculée, au pied du mont Angèle, le paysan est comme partout dans le Diois sans grandes ressources, mais si la récolte est mauvaise, il trouve toujours de quoi se suffire avec son troupeau et ses noyers. A-t-il besoin de deux cents francs ? Il abat aussitôt un de ces arbres merveilleux, dont les dômes servaient autrefois de temples. Un gros propriétaire du pays s’étant avisé de laisser après lui une certaine rente pour les habitants les plus nécessiteux, jamais personne ne daigna se présenter à la Maison Commune pour faire l’office de pauvre. En désespoir de cause, le maire, afin d’employer la somme, dut imaginer des travaux locaux de terrassement et de canalisation. C’est là, si je ne me trompe, un trait bien vivant de la race dauphinoise, qui allie si bien la fierté et l’indépendance à toutes les vertus domestiques.
Pourquoi cette ligne ferrée à travers un pays si patriarcal ? Le paysan ne peut ou ne veut la faire vivre, et les beilles elles-mêmes, qui vont estiver sur les hauts plateaux du Grand-Veymont, du Glandaz et du Devoluy, trouvent avantage à économiser le transport, à faire bravement leurs étapes pulvérulentes par la grande route. Tout simplement pour une abstraction, la stratégie. Briançon, poste avancé vers l’Italie, se trouve de la sorte relié avec la vallée du Rhône. Et la ligne est si résolument stratégique, elle est si négligente de la moindre affaire qu’elle n’a même pas songé à exploiter les beautés naturelles, en grand nombre, dont s’adorne la région. Une Drôme illimitée et torride en amont de Livron, une Drôme modeste, mais d’onde certaine devant Die, une Drôme toute frétillante et menue, avec ici et là un joli village étranglé dans des gorges, des ruines fières, des schistes et des marnes inertes, et la vision rapide de deux ou trois belles cimes, c’est tout ce que le train de Die sait nous montrer. Les gorges, les cascades, les forêts, les portes naturelles, les gouffres, les falaises, ni le chemin de fer, ni personne n’y songe. En revanche, les salles d’attente des gares de Livron, de Crest et de Die affichent des Veniseries glauques, des sites algériens d’un rugissant vermillon, des thermes omnicolores. Comme si les braves gens de la montagne songeaient à ces douceurs si compliquées, si loin, si chères !

A rebours de l’Isère et des Hautes-Alpes, que déjà de grands hôtels outragent et avec eux les indicateurs de panoramas, et toutes les tolérances intolérables du snobisme voyageur et gourmé, le Diois demeure passablement farouche et fermé. C’est un pays qui n’est pas dans le mouvement. Il garde et gardera sans doute longtemps encore la sincérité de ses horizons et la probité de ses auberges.
L’arrondissement de Die, tel que l’ont taillé les hommes de 1790, représente aujourd’hui plus et moins que l’ancien Diois. Plus, puisqu’il a gagné la région qui s’étend de Saillans à Loriol et à Livron, moins, puisqu’il a perdu le Trièves, portion de l’Isère actuelle. L’ancien Diois des évêques, fort de deux cent dix paroisses, était donc moins accessible, mieux clos, plus entièrement montagneux que de nos jours. Il ne voyait pas finir sa rivière. Il est vrai que la perte de la rivière dans le Rhône ne lui appartient pas non plus aujourd’hui, mais des collines d’Allex ou de Grâne on voit cette fin peu glorieuse parmi les grèves de la plaine ensoleillée. A Livron et à Loriol, l’olivier, troupeau gris et charmant, escaladait, avant le funeste hiver de 1709, les collines tournées au midi. C’est dire combien la température est magnifique à ce point de jonction de la Drôme. Sans le mistral, il n’y aurait pas d’hiver. Le mûrier a remplacé l’olivier presque partout et il monte facilement jusqu’à Luc. Les deux tiers de la vallée appartiennent donc encore à un climat fort tempéré. Mais le déboisement d’une part, d’une autre la situation particulière des lieux, déterminent au sein de la montagne parfois des chaleurs excessives, inconnues même à la claire plaine du Rhône. Le val de Die, notamment, encaisse si bien les rayons solaires, qu’on a vu souvent le thermomètre y dépasser 400, jours torrides, suivis d’ailleurs par la traîtrise des nuits fraîches, et quasiment froides. Lus-la-Croix-Haute est un sanatorium d’air pur, d’air balsamique, à deux pas des neiges persistantes, tandis que Glandage, Grimone, Toussières, Ambel, le col du Rousset sont des Sibéries, Le vent lombard amène dans le pays les pluies aveuglantes qui en un quart d’heure font d’un ravin une avalanche d’eau et du torrent un déluge. A peu près partout, le ciel est d’une sérénité toute méridionale.
(1) Gîte de la montagne, bergerie.
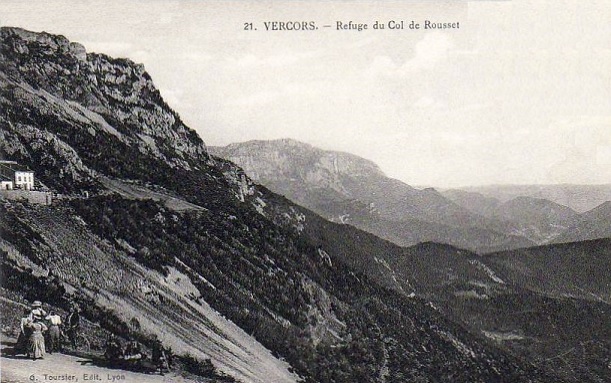
III
LA DRÔME DANS SA ZONE DE FORMATION. LA BATIE-DES-FONTS.
LES FONTS DE LA DRÔME. LES PREMIERS AFFLUENTS.
» La Drôme prend sa source dans la cave d’un curé. » C’est ce qu’on vous dira partout, à Valence, à Livron, à Crest, à Die, à Luc, à Beaurières. Mais bien peu de gens ont songé jusqu’ici à aller vérifier sur place cette origine édifiante.
A la vérité, peu de paysages ont l’air aussi bibliques, aussi austères, que ce cirque de l’Aup-Duffre où notre rivière voit le jour. On dirait un coin de ces déserts où la foi protestante persécutée aimait à s’exalter, où les ministres hâves et meurtris rassemblaient les ouailles échappées aux dragonnades. L’Aup-Duffre et non pas le Laup-Duffre comme on a l’habitude de l’écrire, (Aup étant la forme patoise du mot Alpe), décrit un vaste arc de cercle tourné vers la Drôme et dont les crêtes servent de limites entre notre département et celui des Hautes-Alpes. La plus haute côte dans la Drôme est de 1759 mètres, la montagne d’où sortent les sources n’en compte que 1646.
Il faut, si l’on veut de Beaurières gagner les sources de la Drôme, deux heures de voiture environ. J’ai accompli ce voyage et j’oserai en raconter tout bonnement les péripéties. Si des souvenirs trop personnels — pour lesquels je m’excuse d’avance — viennent à se glisser sous ma plume, le lecteur n’y voudra voir que l’intention de paraître moins affecté, et partant plus fidèle et plus sincère.
Partis de Beaurières une après-midi de septembre, dans une jardinière attelée d’un bon cheval, nous avons gagné Valdrôme en une heure à peine. Dix kilomètres environ séparent ces deux localités.

Cette gorge natale de la Drôme, qui s’ouvre en face de la grande route de Die à Sisteron, au confluent du Maravel, est tantôt pressée d’âpres falaises d’où sautent parfois, après les orages, des cascades tonnantes, tantôt bordée de hautes montagnes auxquelles le reboisement récent prête l’allure d’un vignoble prodigieux. Point d’habitations sur ce chemin, mais nous passons non loin des Prés, assis, en effet, sur le velours d’un herbage, et l’on nous montre, hissés sur d’effroyables rochers, des hameaux : Artamare, Chouet, Prachaton. Mais notre œil s’ingénie vainement à découvrir comment ces nids d’aigle peuvent communiquer avec leurs chefs-lieux. A un endroit, des treuils à demi ensevelis, des échafaudages brisés, des monte-charges brisés, des wagonnets fracassés, abandonnés, les roues en l’air. C’est, nous dit le conducteur, une mine de calamine qui a mal tourné. Déjà ce gigantesque appareil de travail n’est plus qu’un squelette et la forêt l’attaque. Si l’homme ne revient bien vite, la nature effacera tout.
Enfin nous abordons le frais bassin de Valdrôme où s’épanouissent en une sorte d’éventail sept vallons animés chacun de l’ondulation souple d’un rieu murmurant. Nous constatons que le plus vif de ces rieux n’est pas la Drôme, ni le plus joli, c’est le ruisseau du col de Rossas.
Valdrôme n’est en somme qu’un site. Rien à y voir que des ruisseaux bordés de peupliers et de saules. Le château de Vaugelas, qu’on nous signale en passant, n’est lui-même qu’une jolie maison de campagne au milieu des prairies.
Aussi nous repartons. C’est un bien mauvais chemin que celui de la Bâtie-des-Fonts, où nous devons nous rendre. Il est presque neuf pourtant, mais les ravins raturent tout ici. Avec une malignité désespérante ils défont, ils détruisent. Çà et là des noyers, des brousses essaient de rendre notre ascension moins dure, moins maussade. Combien dans cet accul de monts, j’y songe, ces bonnes divinités qui prirent jadis soin du vieux Vocontium et dont le brillant épigraphiste Florian Vallentin nous restitua quelques unes des figures galantes, devaient être heureuses ! Longtemps elles durent échapper au christianisme. A l’abri de leurs montagnes, drapées d’impénétrables sylves, qui aurait découvert de la grande route de Vienne à Milan par le mont Gaura ces génies élémentaires, si paisibles, attachés suivant leur nature à un arbre ou à une fontaine ? Les premiers évêques de Die eurent sans doute beaucoup de mal pour arracher du cœur de ces montagnards leurs croyances ingénues.
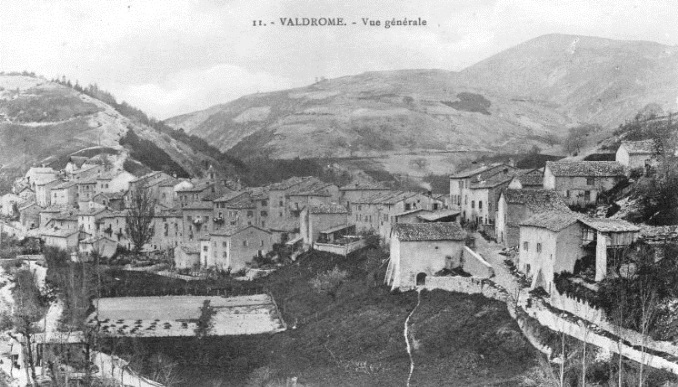

La Bâtie-des-Fonts ! Une quinzaine de bâtisses cousues à la montagne. Nous descendons de voiture sur une sorte de placette qui doit servir d’aire banale. Je m’adresse, ne voyant nulle enseigne, nulle branche de pin, à la première maison venue.
— Où est l’auberge ?
Je vois venir un long et robuste prêtre.
— Monsieur, c’est chez moi Je passe premier, et si vous voulez bien me suivre
Je pourrais bien vivre cent ans que jamais je n’oublierais cet homme, ni son mot. L’auberge, c’est chez moi ! parole patriarcale dont l’Orient seul est encore capable aujourd’hui.
Nous suivons le prêtre, et entrons derrière lui dans le presbytère. Mais à peine sommes-nous assis que la moitié du village, capable de boire, entre aussi à son tour et sans façon tous ces gens-là prennent des chaises et s’installent autour d’une vaste table. Alors je compris mieux encore la phrase touchante du prêtre. Il était le seul homme de la commune à avoir du vin blanc, et naturellement, en bon pasteur, il le versait à ses ouailles !
— Il y a longtemps que vous êtes curé de la Bâtie ?
— Quatre ans. La commune était sans desservant depuis deux années. Aucun prêtre ne voulait y venir. Moi, j’ai accepté. On est aussi bien ici qu’ailleurs. Puis les protestants, — quel dommage ! tous de braves gens, ma foi. — grouillent dans cette haute Drôme, et la commune de la Bâtie ainsi abandonnée à elle-même courait grande chance de devenir huguenote. On a vu maint villages gagnés de la sorte à la confession de Genève. Et ici cela se serait passé comme ailleurs, sans bruit. Un beau jour Monseigneur aurait appris la chose, mais trop tard. Mais, j’y pense, ce n’est sans doute pas pour un aussi pauvre bonhomme que moi que vous êtes monté jusqu’à la Bâtie, et si je connaissais le but de votre visite, peut-être pourrais-je vous être utile
— Nous sommes venus voir les sources de la Drôme.
— Je m’en doutais un peu. Et naturellement on vous a dit que la Drôme sortait de ma cave. Hélas, je n’ai même pas de cave, et au surplus une telle source me serait bien utile pour allonger mon vin.
Et mon interlocuteur achève sa phrase par un gros rire et porte notre santé.
— Sortons, voulez-vous, nous visiterons l’église, et je vous montrerai la véritable font drômoise.
Ce disant nous traversons une venelle et nous pénétrons dans une grange qui, à l’extérieur ne diffère nullement des autres, mais qui à l’intérieur soigneusement blanchi à la chaux, représente de son mieux la paroisse de la Bâtie. La porte à peine poussée, un reptile court à travers bancs, puis s’élance vers le maître-autel. Mais d’un bond extravagant le prêtre atteint la bête et l’écrase net d’un coup de talon.
— Du serpent (1), voyez-vous, dit-il, en l’examinant.
— Une couleuvre, rectifie un paysan qui nous a accompagnés.
— En tout cas, c’est un fidèle que je ne saurais tolérer dans mon église.
Pauvre église ! sans clocher, sans vitraux, où l’hiver la neige entre, et aussi parfois les oiseaux du ciel chassés par les autans, où pénètre le démon lui-même sous la forme rampante et hideuse du serpent ! Pauvre paroisse de primitifs sans autres ressources que leur foi, et dont le casuel de toute l’année ne pourrait payer une soutane neuve ! M. l’abbé Nicolas, en sortant, nous montre l’endroit où était l’ancien presbytère de la Bâtie. C’est à côté de ce presbytère sous un jardinet que la Drôme prend sa source et se divise en trois branches. Il y a environ quarante ans on tenta de faire fluer une fontaine, mais on ne le put à cause du niveau trop bas, et l’on se contenta de creuser un canal qui contourne la cure actuelle et une maison voisine. C’est tout près de ce dernier bâtiment (je reproduis les indications du prêtre) que flue la première branche de la source drômoise. Là on avait placé vers 1859, des pierres avec cette inscription :
M. L. P.
FERLAY
N. D. L.
S. DROME.
ce qui veut dire : M. le Préfet Ferlay. Nom de la source : Drôme. Mais ces pierres ont été enlevées et placées maladroitement au-dessus d’une fontaine voisine qui n’a rien de commun avec la Drôme.
La seconde branche sort d’une vieille muraille contre laquelle l’ancienne cure était adossée. Elle va bientôt rejoindre l’autre et les deux réunies vont se jeter dans l’écluse de l’ancien moulin.
La troisième branche coule non loin de là, traverse des jardins par un conduit et gagne le torrent de Fontsole au N.-O. du village, près de la route de Valdrôme. Cette source qui fournit la meilleure eau du pays a été baptisée la Misère. De nombreux torrents d’occasion, dont deux descendus du hameau de Chamel (1259 m.) [Commune de la Bâtie] sous les noms de Fontsole et de des Préaux grossissent la Drôme en temps de pluie. Le Freyssinet, le Villard et le Clos-long sont les trois principaux ruisseaux dont elle s’alimente avant de se doubler à Valdrôme par la jonction du courant venu du col de Rossas.
— En somme, dit gaiement le prêtre, nous sommes ici au biberon de la Drôme. L’altitude est 1023 mètres, notre rivière sur un parcours de 111 kilomètres descend donc une pente totale de 925 mètres quand elle atteint le Rhône.
N’ayant plus rien à faire à la Bâtie-des-Fonts, la bien nommée, nous remercions chaleureusement le digne abbé Nicolas et nous regagnons Beaurières. La nuit est complète quand la jardinière nous dépose à notre auberge et la course à été longue. Mais du moins nous voilà un peu mieux renseignés que cet excellent La Vallée, un géographe du XIXe siècle, qui place les sources de notre rivière dans les montagnes de Gap et dit que comme ses voisines, l’Isère et la Durance, elle est fort dangereuse lors de la fonte des neiges ! L’Aup-Duffre cuirassé de glaciers ! C’est cela qui nous rendrait fiers nous autres Drômois. Pardonnons à La Vallée II n’écrit guère que cent ans après Boileau, l’homme qui fait » naître le Rhin au pied du mont Adule entre mille roseaux, » et admirons l’impudence superbe de la Géographie au Grand Siècle.
(1) On désigne plus particulièrement dans la Drôme sous le nom de serpent, le reptile venimeux.
IV
LE CIRQUE DE BEAURIÈRES ET LE COL DE CABRES. — LE TORRENT DE MARAVEL ET LE VAL-THORANNE. —
LE NOM DE LA DRÔME. — LES LACS ET LE CLAPS DE LUC. — LE BOURG DE LUC-EN-DIOIS.
En ce cirque de Beaurières, tout comme dans la cachette de l’Aup-Duffre que nous venons d’explorer, et où, pouponne, vagit la Drôme, on peut se croire au bout du monde. Il semble qu’il n’y ait rien au-delà de cet horizon louche de schistes, de cette nature dévastée, glissante et comme en dissolution. Mais, au lieu que l’Aup-Duffre, rapiécé çà et là de jaune et de vert, et çà et là ombré du duvet des pacages, ne déplaisait point trop, les monts qui étreignent Beaurières ne sont qu’une plaie. Ils évoquent pour l’imagination ces contrées vacantes de l’Afrique, où les dunes souveraines défient l’aventure des hommes.
Eh quoi, c’est là ce fameux mont Gaura des vieux itinéraires ? — Oui. Mais ce mont Gaura, les anciens ne le reconnaîtraient plus aujourd’hui. Il est débaptisé d’ailleurs. Il s’appelle tout bonnement le mont des chèvres (1), ne justifiant que trop sa dépréciation morale et sa ruine physique. Bientôt, les chèvres elles-mêmes, lasses d’y user leurs lèvres sur des schistes inertes, n’en voudront plus.
Donc, tout l’intérêt du paysage consiste, si j’ose le dire, dans sa désolation. Elle est surprenante, infinie. Sur ces masses noirâtres, sur ces résidus d’enfer que ne perce même pas le squelette de la montagne, ni herbe, ni mousse, ni buisson, ni arbre, ni champ, ni grange. Avec la personnalité du val drômois, qui, sinon géographiquement, du moins conventionnellement s’abolit au sein de cette sinistre nature, la vie semble aussi vouloir renoncer. Au bas, pourtant, le village se défend de toutes ses cultures, comme de griffes, contre le schiste, contre la mort. Il est même quasiment gai avec ses jardinets, ses lambeaux de prairie, ses deux, ruisseaux vifs, le Maravel et la Choranne, ses quelques noyers, ses peupliers. Il a du reste, par tradition, son importance. C’est sur son territoire, au quartier dit des Tours, que se trouvait le chef-lieu du mandement féodal du Val-Thoranne, dont les Isoard d’Aix — un nom qui revient souvent dans les chroniques du vieux Diois —furent peut-être les premiers seigneurs. En outre, Beaurières a toujours été un relais, un gîte d’étapes. Naguère encore, le village était animé par le va et vient des rouliers et des courriers de poste. L’auberge était pleine de bruit et sous ses hangars se pressait le peloton fringant des bêtes de renfort : chevaux à forte encolure et à queue en chignon, mulets aux jambes lisses et à panse blanche. Tout cela est changé. Ce sont les locomotives qui s’arrêtent pour boire à Beaurières. Les mulets de fer, malgré leur prestance monstrueuse et leurs poumons ronflants, ont besoin de se reprendre ; ils ne pourraient sans cela se mesurer avec le géant de schiste. Cette ligne, dans sa structure saisissante, est toute la vie de cet humble village, sa distraction, son diorama éternel.
— Que de mal, me dit un pauvre fabricant de lavande, installé pittoresquement auprès de son alambic dans le lit du Maravel dont il parfume l’onde vive, que de mal, Monsieur, et que de sous ! et d’un geste peureux il me désigne la terrible montagne toute couturée, toute trouée, Pendant des années, plus de deux mille ouvriers ont trimé dans ces terres qui ne tiennent pas, et qui parfois glissaient tout à coup, brisaient les galeries et s’effondraient avec le bruit du tonnerre dans la vallée. Tous ces gens logeaient dans le village où nous ne sommes pas deux cents aujourd’hui. On commençait des tunnels qu’on laissait ensuite ; on déplaçait des plans entiers de montagne, et cela ne servait à rien. Puis, le poison des souterrains — le grisou — comme vous dites, s’en est mêlé ; il est mort toute une équipe. A ce qu’on dit, il y aurait la dedans du pétrole et du pétrole, mais cela ne profitera guère à nous autres.
Mon interlocuteur parle encore, qu’un sifflet pique l’air sec. C’est un train qui monte, et je m’amuse de voir peiner la longue bête noire sur cette pente redoutable, tant de fois consolidée et à peine sûre encore.
— Ah ! vous en avez pour un moment avant de le voir disparaître, reprend mon brave parfumeur.
Et en effet, une fois sur les flancs incertains de la montagne, le train n’avance qu’à regret. On dirait que les ponts, les encorbellements, les galeries sont pour lui des sujets de réflexions. Par moment, les souterrains sont si rapprochés que la tête et la queue du convoi semblent prises et qu’elles ne pourront plus se dégager. Enfin, à un dernier coup de sifflet qui traîne et désespérément se lamente, j’augure que le grand tunnel de Cabres ouvre sa gueule béante. Ayant engoulé mon train, il ne le rejettera plus que dans le bassin de la Durance, à la Baume-des-Arnauds, première station des Hautes-Alpes.

M. Ardouin-Dumazet, épris surtout de technique, et qui, dans les pages substantielles de son « Voyage en France » paraît diriger l’effort de sa pensée dans le sens d’une colossale enquête industrielle et commerciale, a consacré un de ses chapitres au chemin de fer du col de Cabres. Les schistes l’ont fort impressionné lui aussi, et il nous donne, tout en notant complaisamment les acrobaties vertigineuses de cette partie de la ligne de Livron à Briançon, un aperçu curieux sur la région si tourmentée de Beaurières. On lira cette relation avec plaisir. Si M. Ardouin-Dumazet est renseigné comme un rapport d’ingénieur, cela ne l’empêche pas d’être pittoresque et descriptif. Il a fort bien vécu ses trop rapides voyages.
Quelques chiffres. Le col de Cabres s’entaille à 1180 mètres. Le plus haut point de la ligne est à 890 mètres, soit environ 280 mètres au-dessous du col de la Croix-Haute, sur la ligne de Grenoble à Marseille. De Luc à la Baume-des-Arnauds, soit l’espace de 24 kilomètres, les tunnels, au nombre de dix-huit, représenteraient, mis bout à bout 8279 mètres. Le grand tunnel de Cabres à lui seul ravit à la lumière 3800 mètres de voie.
Le Maravel, qui symbolise aujourd’hui pour nous ce Val-Thoranne, dont il arrosait jadis le mandement, fort de quatre paroisses, peut être considéré comme la seconde branche mère de la Drôme. Avant d’atteindre Beaurières, il court, formé de trois ruisseaux : les Ayes, le Pontilier et les Ruis, dans une région agreste, dont les pics lèvent des têtes, trop souvent chenues, entre seize et dix-huit cents mètres. Il faut voir cette jolie combe. Elle semble faite pour reposer de Beaurières, pour dédommager la vue de ce paysage de cendres. En haut, le Pilhon ; à mi-côte, la Bâtie-Cremezin ; en bas, Fourcinet, et les trois villages fermés au reste de la terre par une de ces portes naturelles comme on n’en voit que dans la Drôme. Entre les blocs énormes que coiffent des chevelures éplorées de plantes grimpantes, le Maravel, fuyant rapide et clair, a peine à se livrer passage. Il y a quelques années, il fallait le sauter à la sauvage sur de grosses pierres roulées dans l’eau par les paysans. Maintenant, un arc très fruste, taillé dans le roc de gauche, permet l’accès du haut Val-Thoranne. Les ingénieurs, bien avisés, n’ont point gâté l’œuvre pittoresque de la nature.
La Bâtie-Cremezin, ce village fameux, parce que, depuis qu’il est érigé en commune, ses dix électeurs deviennent d’emblée conseillers municipaux, est à une demi-heure des Portes de Fourcinet. Mais que son chef-lieu cantonal, Luc, et que sa capitale, Die, se taisent. Au dernier recensement, la Bâtie leur a fait honte en gagnant quinze âmes et neuf électeurs. La commune compte dès lors 57 habitants, y compris la garnison d’un garde-champêtre.
Laissons le Maravel, qui avait si bien commencé, finir tristement en reflétant les schistes. Nous voilà revenus sur les bords de la Drôme. Mais, avant de reprendre le voyage en sa compagnie, je crois nécessaire d’ouvrir une parenthèse. Nous ne nous sommes pas inquiétés jusqu’ici du nom de notre rivière. Les savants épris de grec ont naturellement vu dans ce vocable sonore, qui tombe, semble-t-il, comme une masse, le qualificatif Spona, qui a fourni, suivant la remarque de M. de Coston, Dromo et Dromon ; mais il convient d’attribuer à cette eau bavarde une origine plus conforme à son caractère et à son milieu, et nous avons, pour nous la fournir, comme le veulent la plupart des érudits dauphinois, le très noble et très vénérable radical celtique dur ou dour. Près de quinze pour cent, des rivières françaises viennent de là. Cela étant, pourquoi la Drôme et non la Drome ? Pourquoi cet accent circonflexe sur une voyelle devenue longue par la grâce des bureaux parisiens ? Ausone, au IVe siècle, dit Druna ; le cartulaire de Cluny, au Xe, dit Droma; aux siècles suivants, Droma encore et Aqua Drome; au XVIe siècle, Deroume et Dromme. Enfin, nos paysans prononcent d’instinct et sans aucune gêne Dromme et même Dramme. Cela est bien fâcheux pour l’accent circonflexe, et certes, M. l’abbé Moutier a raison cent fois, qui propose d’en débâter notre rivière. Hélas ! contre l’étymologie, contre la prononciation traditionnelle, contre mes propres convictions, je le sens, je vais continuer lâchement à écrire Drôme.
On s’éloigne de Beaurières sans regret. A la longue, ce village, enseveli dans les plis de son linceul de cendre, désole le cœur, et son atmosphère oppressante vous communique le froid d’un tombeau. Pourtant, le Maravel bu, la Drôme n’en a pas fini avec les schistes, mais déjà les monts, mieux endentés de cols, mieux dessinés, offrent quelques perspectives riantes. Quant au fond même du val, il a totalement changé. Une vaste nappe d’eau miroitait ici, il y a à peine cent ans. Les géographies l’évaluent à environ trois cents hectares, mais en réalité elle était bien plus considérable. Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer les terrains avoisinant la jonction du Maravel. Là, nous l’avons constaté, le roseau, comme au-dessus de Luc, prospère dans des creux et lève une moisson de glaives et de sceptres. Cette végétation, parmi les marnes détritiques, les schistes pulvérulents, peut sembler étrange, impossible même. Elle ne l’est plus en admettant l’hypothèse lacustre On peut donc, sans exagération, doubler l’amplitude de ce lac, qui, depuis le confluent du Rif de Miscon jusqu’à celui du Maravel, couvrait près de deux lieues de longueur et dont la largeur, très variable, allait de 3 ou 400 mètres jusqu’à une demi-lieue. Il n’en reste plus aujourd’hui que le souvenir, mais le sol, imparfaitement desséché, tout gonflé de sucs palustres, superbement dru d’ajoncs, de graminées dures, de fourrages dangereux, exhale la fièvre. Les campagnards ne l’habitent guère. Ils y viennent pour faucher le roseau, don éternel du marécage, et le travail fait, regagnent les hauts villages salubres de Charens, de Beaumont, de Lesches, de Miscon. De Beaurières à Luc, deux hameaux seulement coupent la solitude de la grande route : les Bouligons et les Côtes. Lesches-Beaumont est la seule gare qui dessert ce fond de lac.
Naturellement, l’immense conque ne s’est pas vidée toute seule. En écrivant ces lignes, j’ai précisément sous les yeux une estampe allemande de la fin du XVIIIe siècle représentant le grand lac de Luc (Ansicht des grossen Sees von Luc in der Dauphiné). On y découvre un charmant panorama d’eau et de montagne. Que pensez-vous de ces Allemands ainsi familiarisés avec notre Diois, et prenant la peine d’en dessiner les curiosités, à l’heure où les voyages constituaient une entreprise méritoire ? Songez en outre que le Diois, sans grande ville et sans grand commerce, et défendu par ses monts, ne sollicitait guère l’aventure. N’est-ce pas un sujet digne de réflexion, et n’y a-t-il pas là une preuve manifeste de cette soif de connaître, de se répandre, de vulgariser, de ce besoin d’expansion qui caractérisent la race ? L’image a dû être détachée d’un ouvrage sur le midi de la France. Elle est un peu naïve, sans doute fidèle, et, si l’on observe les détails, relevée d’une certaine grâce. Au premier plan , sur les vagues linéaments de la vallée commençante, des chevaux broutent une herbe fine; en face d’eux, des chasseurs, à l’affût dans les oseraies, tirent un gibier d’eau; au loin, sur la partie libre du lac, une grande barque paresse, portant deux personnages, enfin, comme horizon, une ceinture de croupes nues où trône la majesté d’un pic dans un collier de nuages.
» Ils avaient un volcan, et ils l’ont laissé s’éteindre » ! Si jamais cette boutade m’a semblé, par analogie, véridique et incisive, si jamais j’ai éprouvé le besoin cruel de la rajeunir, c’est bien en face de la pauvre conque vide où, au lieu de s’amortir dans son lac, la Drôme serpente aujourd’hui sans beauté et sans profit. » Ils avaient un lac, et ils l’ont vidé dans la campagne ! «
A l’aide de l’estampe allemande, c’est un plaisir pour moi que de susciter la vision ancienne, de faire revivre ce paysage aboli et d’en goûter la grâce rétrospective. Et cela me fait oublier les maudits chartreux de Durbon, par qui cette mauvaise action fut commise il y a quelque cent ans. Afin d’augmenter leur domaine (une grande partie de ce territoire leur appartenait), ils brisèrent le seul miroir de l’Alpe dioise. Quand il n’aurait servi qu’à régulariser, qu’à décanter la Drôme, le lac de Luc méritait d’être; Mais il était une harmonie et une beauté au sein de ces montagnes âpres. De plus, avec la science moderne qui multiplie, partout où elle le peut, les barrages, les réserves d’eau, il rendrait peut-être, à l’heure où nous écrivons, des services incalculables.
Voilà comment notre rivière a perdu son Léman. Chose étrange, c’est un cataclysme assez récent qui lui en avait fait don. En 1442, la montagne du Puey ou Pic de Luc, haute de plus de onze cents mètres, se fendit soudain, oscilla, et toute son immense couronne de rochers bondit dans la Drôme, s’y écrasant en deux masses distinctes, séparées entre elles par l’accident appelé Petit Lac. Ce fut si subit et si terrible qu’on n’entendit plus jamais parler de l’ancien Luc dont la forteresse féodale commandait ce point de la gorge. Même, certains auteurs, à peine convaincus de sa perte irrémédiable, s’attardent à chercher encore le vieux bourg. Sans doute, jamais pierre ne s’en dégagera. L’éboulement pèse de tout son poids formidable sur ce passé.

La Drôme, on le conçoit, irrésistiblement barrée dans sa course, affolée, et cherchant vainement à fuir, remonta vers sa source comme la rivière de l’Ecriture. En deux ou trois jours, elle fit un lac immense de la plaine supérieure; dans l’abîme, sans compter nombre de granges des mandements de Beaumont, de Lesches, de Miscon, disparut la paroisse de Rochebrianne. Heureusement, la plupart des habitants avaient pu fuir. S’étant adressés dans leur malheur au Dauphin (depuis Louis XI), le prince prescrivit au gouverneur de détaxer ces pauvres gens. La lettre de Louis que possèdent les Archives de l’Isère, a déjà été reproduite plusieurs fois, notamment par le chanoine Jules Chevalier, dans son très savant ouvrage sur l’Eglise et la ville de Die. J’en détache néanmoins le passage suivant pour donner une idée du style et des formes naïves de l’époque :
» L’umble suplication des manans et habitans des lieux de Luc, Miscon, St-Gasian, Lesches, Alpilon, Fornet, Montlor et Burières, avons reçue, contenant que huit ans a ou environ, il tumba une montagne auprès et audessoubs du chastel et ville dudit lieu de Luc, laquelle montagne a escouppé, retranché et empesché le cours de la rivière de Droume, que a présent y a ung grant lac qui contient plus d’une lieue de pays et dure depuis ledit lieu de Luc jusques au lieu de Rochebriane, lequel lac a noyé et dépéri les lieux, villages et habitations, terroirs, possessions, vignes et héritaiges desdits supplians tellement qu’ils n’ont à présent où ils puissent recueillir blé, vin, ne aultres choses de quoy ils puissent substanter leurs vies, ne de leurs mesnaiges et combien que pour la cause dessus dite, lesdits supplians soient tellement appauvris et diminués de leurs chevances que à peine ont-ils de quoy vivre et que grande partie d’entre eulx s’en sont allés demeurer aultre part et en aultres seigneuries … »
Le site créé par le Claps (c’est le nom de l’éboulement) est inimaginable. Les montagnes, dans un recul semi-circulaire, ont pris la forme saisissante d’un théâtre antique. Et devant ces gradins vides, éternellement un drame se joue, qui a pour personnages les bloc?, mis en scène par la catastrophe. Cela est risible et terrible. Ces blocs s’agitent, se traînent, courent, prennent toutes les attitudes du geste. Il en est de quatre-vingts pieds de haut qui s’apprêtent à maudire une foule prosternée, d’autres qui semblent pris de folie, d’autres ivres, qui titubent. Et l’œil, en présence de cette scène lunaire, dantesque, innommable, peut se croire mené par le cauchemar. Quand la Drôme est en belles eaux, quand, d’un bond, elle saute du plan du lac supérieur dans celui du petit lac, on a une fontaine de Vaucluse, et on croit entendre gronder et mugir ces fantômes de pierre.
Le Claps de Luc m’a laissé ainsi, outre le charme grandiose du site, l’impression poignante d’une fantastique, d’une irréelle féerie. Quel dommage — je ne saurais assez le dire — qu’à côté de cette merveille, le grand lac n’étale plus son azur !

Le chemin de fer et la route — c’est fort heureux — ont respecté le Claps. La route s’inscrit harmonieusement dans la courbe immense de la scène et de son large ruban blanc éployé, lui fait comme un couloir de dégagement. Quant au chemin de fer, il s’illustre, en vue de cette arène grandiose, d’un pont magnifique, fruste à souhait, et avec cela, élancé, aérien. Ce pont domine de près de cinquante mètres les bouilles tumultueuses et les ouïes effervescentes de la rivière courroucée. Le pont franchi, la voie glisse aussitôt dans le four d’un tunnel. Que les ingénieurs soient loués !
Le bourg de Luc-en-Diois, qui a ces belles choses à sa portée, n’en est pas plus fier. Il est calme, paisible, et ses habitants paraissent vivre dans une atmosphère de nonchaloir. C’est le village agricole par excellence, mollement couché le long de la grande route, l’espace d’un bon demi-kilomètre. Peu ou pas de venelles latérales. Tout le monde a vue sur la voie romaine. Il faut un peu de gloriole à ces vies simples, peu chargées. Jadis, le roulage empêchait la bourgade de sommeiller tout à fait. Aujourd’hui, elle sommeille tout de bon, n’ayant pas d’ouvrage à donner au chemin de fer.
A Luc, les gens sont aisés, les maisons propres, l’auberge excellente, les jeux de boules très en honneur. A ce prix, la commune consent à perdre quelques âmes à chaque recensement. – Le bourg du moyen âge, comme il a été dit plus haut,
dressait ses défenses à deux kilomètres en amont, en pleine gorge du Claps. Il y périt de maie mort en 1442. Le Luc celtique et le Luc romain, au contraire, s’étaient contentés fort bien de remplacement heureux et régulier sur lequel nous voyons le village actuel. Il y eut là, même avant Die, la capitale des Voconces du nord, la rivale de Vaison. Lors de la conquête romaine, Luc, bien loin de perdre avec ses vainqueurs, couronna son nom du titre de ville augustale, titre évident de la suprématie : Lucus colonia Augusia Vocontiorum. Cette belle fortune sombra tout à coup. En l’an 69, Vitellius, chef des armées de Germanie, trouvant le moment favorable pour renverser Othon, son compétiteur, envoya deux de ses lieutenants en Italie, l’un, Fabius Valens, par les Alpes Cottiennes, l’autre, Cécina, par les Alpes Pennines. Tacite nous a laissé une relation de cette marche de Valens à travers le pays des Voconces. Il nous raconte que, sous la rouge menace des torches crépitantes, chaque maison de Luc dut fournir au général une somme d’argent. Quand il n’estimait pas la rançon suffisante, il jetait ses soldats sur les femmes et les filles des habitants. Une grande partie de la population, quittant le municipe, témoin de tant de hontes, alla, dit-on, s’établir à Die et contribua ainsi à la prospérité grandissante de la ville. Luc, réduit en peu de temps au titre de simple mansio, c’est-à-dire de gîte d’étapes, ne devait jamais complètement réparer ses désastres, ni se refaire de grandes annales.
Les gens de Luc savent-ils qu’ils boivent l’eau d’une fontaine singulière, dont un sarcophage, contemporain des divins empereurs, forme le bassin ? Quelles amères réflexions pour le passant, et quel torrent d’ironie pour un parisien, que ce sépulcre dont, parfois, des fillettes, juchées sur de grosses pierres, boivent à même l’eau parfaitement limpide et assurément délicieuse ! Voilà une destination que les Romains n’avaient pas prévue ! Ce monument funéraire, vénérable de dix-huit siècles, peut-être aussi vieux que le brillant Trogue-Pompée dont la famille était originaire de Luc, a sans doute, employé de la sorte, évité de périr. Il est, pour la jolie bourgade, un brevet d’innocence et d’esprit pratique charmants.
De nombreux débris anciens doivent joncher le sous-sol de Luc. Jusqu’à ce jour, on y a fait assez peu de découvertes, mais elles sont capitales. M. Camille Jullian n’hésite pas à faire figurer dans son ouvrage Gallia ce fameux tombeau représentant un cavalier armé, et dont une épitaphe souligne l’image de pierre. Il s’agit du légionnaire Caius Marius, de la tribu Voltinia, natif de Luc. Enfin, je ne puis passer sous silence l’admirable mosaïque, œuvre de l’architecte romain Quintus Amiteius, découverte par M. Nal, et offerte en 1892 au musée de Valence, où elle est en bonne place, pour l’honneur de notre Drôme.
(1) C’est ce que signifie le col de Cabres. — Cabre, chèvre en patois.
V
DE LUC A DIE. — LA PREMIÈRE PLAINE DE LA DRÔME : VIGNES, NOYERS, MURIERS. — LES AFFLUENTS. LA BÉOUX, LE BEZ. SES MONTAGNES, SES VALLÉES, SES MYSTÈRES, (COMBEAUX, ÂRCHIANNE, CHATILLON, MENGLON, MENGLON, LE VALCROISSANT, LA MEYROSSE.
Enfin paraît la vigne. Comme cela prête des moyens à une contrée ! comme un horizon, grâce aux pampres verts, prend tout de suite air de gaîté et d’abondance ! A la voir seulement, il semble qu’on respire une haleine plus clémente, qu’une intimité fraternelle vous rapproche des êtres et des choses. La vigne réchauffe d’humanité le site le plus grave et le plus sauvage, elle marie les terres arides à des idées confuses de bien-être et de belle humeur. Ici, elle ne constitue pas naturellement la richesse comme dans certaines provinces, car elle ne saurait être la culture essentielle, mais soit qu’elle tapisse le plafond du val, soit qu’elle ébouriffe d’un vert vigoureux les. rudes pentes de la montagne, elle est l’objet des mêmes soins jaloux ; quelques bouteilles de vin paillet chambrées au nord de la grange, avec cela le paysan accepte de bonne grâce ses misères éventuelles.

Saluons donc le clocher de Luc, pourtant débile et nu. Il annonce la vigne et il chante avec la voix fluette de son humble cloche l’hymne du Diois Heureux, l’hymne sensuel de la douce clairette. Ce Diois Heureux, d’ailleurs, est encore plus que libéralement Pétré, mais le malin montagnard en tire même avantage. Sans les innombrables murs en pierres sèches que l’on voit de toutes parts, il n’y aurait sur les pentes trop rapides de la montagne ni de ces charmants étages de culture, ni de ces agrestes jardins suspendus. Puis, le pays s’amende tous les jours et peu à peu ses plaies se ferment grâce au reboisement. Un troupeau magnifiques de hêtres, de sapins, de pins, d’épicéas, a escaladé les croupes voisines de Luc : monts de Cerne, de Clamontard, d’Aucelon. On rend à la chèvre inique la vie de plus en plus difficile. Le rendement en fromages sera moins grand, mais il sera compensé par un rendement inappréciable en fraîcheur, en beauté. De l’horrible mort sylvestre dont l’homme l’avait frappée, n’est-il pas merveilleux que l’homme, par le bénéfice de la sagesse et de la science, ressuscite une terre à la vie, lui redonne ses décors naturels, la fasse remonter dans les siècles ?
Mais en piquant un ciel plus bleu, le clocher de Luc donne aussi le branle à une végétation plus franchement méridionale. Les granges, les fermes isolées se multiplient et dans la plaine, presque toutes se doublent d’une magnanerie. Aux dômes d’or brun de leurs paillers, dont le nombre, suivant un dicton, représente autant de centaines d’écus de rentes et gonfle d’orgueil le cœur de l’ancien, on reconnaît des situations à l’aise. Dans les bas-fonds, de petits mûriers, dans la joie de se poursuivre le long des héritages, rient à feuilles déployées dans la lumière d’un soleil déjà provençal. Pruniers, poiriers, pommiers, amandiers, châtaigniers, noyers, s’équilibrent tant bien que mal sur les pentes, en éteignent de touches pâles et discrètes tantôt l’ocre féroce, tantôt le gris livide. Les noyers surtout intéressent. Cet arbre harmonieux donne au Dauphiné une partie de ses grâces et l’on peut dire qu’il tient à sa physionomie. Malheureusement il tire l’œil, il est trop puissant, trop beau, trop généreux, et un quatre-vingt-treize mercantile médite d’en découronner nos Alpes. L’instituteur qui est presque toujours le camarade et souvent le conseiller du paysan dans nos villages, ne pourrait-il, par la persuasion, faire entrer l’amour de l’arbre dans les mœurs ? C’est par l’humble fonctionnaire des campagnes que l’idée récente de la protection des sites a quelque chance de réussir. Mais il y a mieux qu’un intérêt d’agrément en cette affaire, il y a une raison de bien-être et d’existence même pour le montagnard. Ce que, dans le Diois en particulier, l’abatage Systématique des noyers a ruiné de gens et provoqué d’exodes est inimaginable. L’instituteur le moins sagace aurait là une bien intéressante leçon de choses à enseigner. Il serait une force à opposer au vandalisme de ces exécuteurs qui, courant la montagne, marquent partout des victimes pour leurs sacrifices barbares.
De seuil en seuil, nous voilà bellement descendus de près de cinq cents mètres depuis La Bâtie des Fonts. C’est dix fois la hauteur de la fière tour de Crest, près de vingt fois celle des Jumeaux, ces deux personnages formidables de la scène du Claps, que j’ai cités plus haut sans les nommer. Et nous n’avons guère parcouru que 33 kilomètres. D’autre part, supposons un instant le Rhône de Loriol coulant sous Luc. Nous ne le verrions pas à plus de quatre cents mètres au-dessous de nous, abîme, certes, des plus honorables, envisagé de la sorte, mais assez lent affaissement en somme s’il s’agit de l’incliner sur soixante dix huit kilomètres. Telle est, en effet, la distance qui sépare Luc du confluent de notre rivière. La dénivellation entre les sources et le palier du Claps s’établit donc dans des proportions environ trois fois plus fortes qu’entre ce palier et la fin de la Drôme à Loriol, en amont qu’en aval de Luc. Il ne faut pas s’étonner qu’un ingénieur en chef du département(1), ait songé, dès le commencement de ce siècle, à rendre navigables ces soixante-dix-huit kilomètres à faible pente. Cette idée, à laquelle l’œuvre du reboisement donne un regain d’intérêt, germera-t-elle un jour ? Nous le souhaitons sans l’espérer.
Maintenant une plaine appréciable s’offre à nos regards. Il faudra compter cinq lieues et plus avant une nouvelle cluse, et la vallée, dans.sa fuite lumineuse, orientée vers le nord, mettra désormais un peu d’ordre dans le chaos calcaire du Diois. Les montagnes, sans s’abaisser, (Aucelon, 1523 mètres), (col de Pennes, 1244 mètres), (Serre Chauvière, 1214 mètres), (hauteurs de Saint-Justin) à gauche ; (monts de Cerne, 1133 mètres), (Glandas, 2025 mètres), (Dent de Die et pic de Romeyer, environ 1800 mètres) à droite, ont pris en s’espaçant, des nuances plus tendres, des formes moins revêches. La rivière, à peine évadée du Claps, qui dans ses tenailles la mordait à vif, s’est ressaisie. Son sans-gêne de va-nu-pieds reprend bien vite le dessus. Elle accapare le fond du val, mendie effrontément son eau, tantôt à gauche, tantôt à droite et reçoit trop souvent les rebuffades des torrents d’occasion. Quand par hasard, la copieuse aumône d’une eau constante lui arrive, elle devient double, triple, elle essaie de faire croire, mais vainement, qu’elle est un fleuve. Comme jadis, quand le val, empourpré de sang, hurlait de souffrance, la plupart des villages, Montlaur, Jansac, Recoubeau, Barnave, Montmaur, Aix et Molières, demeurent à mi-chemin du ciel, pour me servir de l’expression exquise du poète Champavier.
La Drôme, dans ce bassin de Die, fait beaucoup de mauvaises rencontres. Généralement fort courts, ses affluents se fâchent au moindre orage et se ruent dans la plaine. On réussit à les éteindre un peu en embarrassant leur lit de branchages, en les cassant pour ainsi dire de distance en distance. Énumérons seulement les ruisseaux de Charel, de Montlaur, de Jansac, de Barnavette, d »Esconavette, des Auches, de Satayac, de la Salle, celui-ci né à peu de distance de la grotte de Solaure, jonchée de débris préhistoriques et qui porte le nom d’une ancienne villa épiscopale [rive gauche] ; ceux de Luzerand appelé Blanchon dans son cours inférieur, de Saint-Roman, de Laval d’Aix et de Beaufayn [rive droite]. Aucun n’atteint dix kilom., aucun n’a d’importance topographique. Plus longue, plus sauvage, la louche Béoux, en éventrant toute une pouillerie de monts mal assis, permet aux vallées de l’Aygues et de la Drôme de communiquer ensemble. En guerre éternelle avec ces terribles cônes schisteux, semblables à distance, à de rigides pièces de soie grises drapées par des géants, la Bléoux dévaste plus qu’elle n’arrose les territoires de Jonchères et de Poyols, Nous avons gardé pour la fin : le Bez, le Valcroissant, la Meyrosse [rive droite], eaux candides où, à n’en pas douter, se baignèrent les Matrœ agrestes du Vocontium.
Ce Bez, ainsi que le remarque l’abbé Moutier, est déjà passablement étonnant pour l’étymologie. Grimone ou Vierre, puis Charans, puis Gas, puis Bez, il change quatre fois de nom en vingt-six kilomètres. A considérer le volume des eaux, l’Archianne, avec ses dix mètres cubes à la seconde devrait être son maître courant; si l’on tient compte de la seule longueur, c’est au ruisseau des Gas, formé de l’appoint presque simultané de la Borne, de la Grimone et de la Vierre, que cet honneur doit revenir.
Au bec de Mensac, comme la Garonne au bec d’Ambès, le torrent trouve sa Gironde en s’appelant Bez. Mais que dire de sa capricante beauté ? comment apprécier les crispations fabuleuses de ses paysages ? Quand on monte de Die à Lus-la-Croix-Haute en passant par le charmant village de Châtillon enfoui dans une somptueuse verdure, on s’abîme il est vrai dans un des plus longs et des plus saisissants défilés des Alpes, on contemple, après avoir salué au passage son irrévérence le Mont Vente-Cul (1691 m.) sur lequel le Jocon (2056 m.) s’empile, le site de Lus dans sa reposante majesté, mais on ne soupçonne pas les mystères du Ruisseau Noir, entaille à peine familière aux pêcheurs de truites, et on laisse de côté la solitude grandiose du vallon de Boule et les splendeurs mystiques du calcaire d’Archianne. Contrée fabuleuse d’innocence et de renoncement que celle-là, où fréquente l’ours, où se pavane le coq de bruyère et qui exhale je ne sais quel relent préhistorique. Contrée minée, sans doute, d’insondables catacombes, de cryptes audacieuses, aussi intéressante dans ses dessous que dans sa forme extérieure. L’œil d’intrépides Châtillonnais fouillait tout récemment les grottes de Pelebi, qui s’ouvrent en vue de Mensac, sur son haut promontoire, et reconnaissait quelques-unes de leurs galeries. Mais comme les braves gens ne s’attendaient pas à un accueil aussi profond et aussi durable de la nature, ils durent, à ce que raconte M. Darty, revenir avec le regret des choses inexplorées.
En une seule journée, j’ai eu la satisfaction, partant de Die, d’y revenir par un point opposé en faisant le tour du Glandas. Au cours de ma promenade je tombai tout à coup sur Archianne. Loin de moi la prétention d’avoir découvert ce coin de grâce primitive. Les habitants de Die en savent le nom, ceux de Châtillon en savent l’emplacement.
Les guides, d’ailleurs, parlent d’Archianne. L’un enseigne qu’on y fait de bons fromages, l’autre qu’on y voit des grottes remarquables. Un-troisième cite les grottes et les fromages. Le précis Guide Bleu de Stéphane Juge indique seulement le chemin terrible qui y glisse du Glandas. Mais de l’étrangeté grandiose du site, bernique ! il n’en est pas question.
C’est surtout ici qu’il me semble avoir pris contact avec Glandas, avoir goûté avec une vraie joie d’artiste les magnificences mystiques de son architecture. De Die, on sent très bien la complexité dé cette masse.monumentale, mais les lointains, en unifiant les arêtes, en façonnant les crocs et les aspérités, en enveloppant d’ombres mauves toute la montagne, ne permettent pas de la juger dans ses détails. A Romeyer et à Valcroissant, autres habitacles de la singulière montagne, on est plutôt en présence d’une citadelle imprenable, inouïe, avec tours, bastions, donjons, échauguettes et mâchicoulis. A Archianne, rien de pareil. Le Glandas s’idéalise en un envol de flèches aiguës, de pignons, de dômes, de clochetons, de pilastres, de dentelures. C’est une cathédrale surhumaine, rayonnante de gothicité. On se prend à chercher des croix d’or aux cimes de ces flèches, aux sommets de ces dômes, mais en vain, la nature n’a pas poussé plus loin la figure. La nature ignore les religions et ne s’inquiète pas des symboles. Voilà tout de même un but de sain et réconfortant pèlerinage, sans les images polychromes, sans les patenôtres, sans les mendiants et avec, pour encens, l’arôme fort des pins et des buis. Le paysage écrasé de soleil, semble agenouillé devant cette merveille, et un rieu, plein de fougue, y murmure éternellement sa prière spumante.

Archianne. se compose d’une douzaine de cabanes en chaume, semées sans soin dans la poche d’un petit vallon. Quelques familles y végètent, dont les ascendants ne sont peut-être jamais sortis de leur horizon natal. Il me souvient d’un type de mère-grand aux cheveux en broussaille et aux yeux électriques, dont l’expression me remua soudain comme si je venais de frôler l’époque farouche des Burgondes. Jamais je n’oublierai la façon dont elle nous poursuivit dans son champ de pommes de terre que nous traversions fort innocemment pour nous rendre à la grotte, — car Archianne à une grotte qui vomit tout un torrent à certaines époques de l’année. A notre sortie, le fantôme des âges de proie nous guettait et j’imaginai le plus aisément du monde une scène terrible où la vieille, un peu moins scrupuleuse, enfumait l’étranger dans son trou comme un renard. M. Martel, le célèbre spéléologue, et M. Etienne Mellier, le premier explorateur de notre Vercors, venus, sur la foi des guides, visiter cet antre négligeable, ont dû — et cette communion dans le même sentiment m’honore — se rabattre eux aussi sur le spectacle du Glandas, commotion sublime. Et maintenant, la part d’admiration satisfaite, louons les fromages à l’instar d’un simple guide. Il s’en fabrique assez peu à Archianne, où la population des chèvres est peu dense ; davantage à Grimone et à Glandage, C’est une des variétés véhémentes de ce picaudon vénéré, gloire de Bourdeaux et des Tonils, qui fait qu’on se passe quelquefois de dîner, et après lequel le bouquet d’un vin si bien se dénonce. Quelle hérésie, goûter le vin sans picaudon ! Autant, ma foi, vaudrait goûter le picaudon sans vin ! .
Treschenu, que vient de nous restituer M. Lacroix, dans une de ses savantes notices, comprend outre Archianne, les écarts de Menée, Benevise et des Nonnières. Or, Treschenu n’est qu’un mythe, il n’existe pas. Il étiquette seulement la fédération administrative des quatre groupes. On dirait que tout se concerte pour le mystère en ce coin du Glandas.

Les Nonnières perpétuent la très dramatique histoire d’un des plus anciens moûtiers de France. C’est aux Combeaux (4 kil. de ce hameau) qu’il fut fondé vers l’an 610 par Meltride et trois légataires de Sainte Radegonde, femme de Clotaire Ier Maxime étant évêque de Die. Malgré la solitude hérissée de pics de 1800 à 2000 mètres, malgré l’inconnu de leur retraite et l’éloignement des voies naturelles, les Sarrasins, flairant les moniales et leurs trésors, dénichèrent les Combeaux. Piller la maison, puis y mettre le feu après avoir sans doute violé les filles de Sainte Radegonde, fut l’affaire de peu d’instants. Bien des noms, bien des légendes dans nos vallées, témoignent des incursions de ces barbares et de la terreur qu’ils inspiraient. Il y a naturellement beaucoup de réserves à faire sur les récits du Moyen-âge relatifs au Sarrasin. Il serait difficile de mesurer la hauteur de ce flot d’Islam dans nos vallées, et tout à fait impossible d’en rechercher le dépôt dans l’âme Dauphinoise, mais j’ai trop souvent surpris dans de hauts villages la flamme mystérieuse d’un œil noir, j’ai trop souvent senti un sang étrange gonfler certaines veines, pour ne pas soupçonner les porteurs de cimeterre. Hantés par les âpres souvenirs des Sierras, ils n’étaient point trop dépaysés en ce pays de rocs altiers, de forêts noires, de solitudes farouches. Individus fatigués d’invasions, individus gagnés au charme d’une patrie semblable à la leur, ou même qui sait, retenus par les liens de l’amour, un sédiment arabe, très sporadique, il est vrai, finit par s’attacher au sol diois.

Châtillon, dans son creux, n’a rien qui impose. Assis entre des rochers feutrés de mousse et des collines dominées par l’inévitable Glandas, toute sa vie, comme à Luc, se concentre en sa longue rue, parallèle au Bez. Des jardins, des vergers l’entourent, grimpent sur les hauteurs dont des murs en pierres sèches soutiennent les larges gradins, et lui font une parure exquise. Les agneaux appelés truands et les truites d’Archianne, des Gas et du Ruisseau Noir, sont la renommée de Châtillon, dont les mines de zinc voisines des Boidans (comme de Menglon) pourraient faire un jour un petit centre prospère. Ces mines, exploitées par la Compagnie Asturienne, qui recherche très activement d’autres gisements dans la Drôme, (à Brette, à Gumiane), occupent de cent-vingt à cent-cinquante ouvriers. Le minerai lavé au préalable est transporté à la gare voisine de Recoubeau qui l’expédie dans le Pas-de-Calais. La gare de Châtillon est Pont-deQuart. C’est là que la grande route de Die à Sisteron passe de la rive droite de la Drôme sur la rive gauche, après avoir envoyé le tronçon de la vallée du Bez sur lequel se grefferont à leur tour le chemin de Menée, d’Archianne et des Nonnières et le chemin de Boule et de Bonneval. Pont-de-Quart, hameau de la commune d’Aix, voit de jour en jour son chef-lieu dépérir à son profit. Les habitants d’Aix, insoucieux de l’ancienneté fabuleuse de leur dieu aquatique Bormanus, et peu confiants dans la forteresse caduque des La Tour du Pin Gouvernet, bâtie par la ferveur huguenote avec les pierres noircies et fumantes encore de la cathédrale de Die, lâchent leur colline pour la plaine, et peut-être la proie pour l’ombre. Les noyers d’Aix et de ses environs passent pour donner les meilleurs cerneaux du Diois. Dans son ensemble, la Drôme est — que nul ne l’ignore — le premier département de France pour les noix » de Grenoble ».
Le Bez, déclaré flottable sur dix kilom., paraît ne pas s’être soumis encore à cette décision arbitraire des Ponts et Chaussées. Il n’en double pas moins la Drôme, en s’y jetant en face de l’Esconavette par 476 mètres d’altitude.
Le Valcroissant, aux reins souples, franchit en une lieue et demie de cours, les 233 mètres qui séparent son commencement sous Glandas de sa fin dans la Drôme sous le tertre calciné de Molières. Il porte à juste titre le nom fanfarant d’une ancienne abbaye de l’ordre de Citeaux, fondée vers 1188, ruinée ensuite pendant les guerres religieuses, et finalement transformée après la Révolution en exploitation rurale. Imaginez une courbe d’à peine deux cents pas de large, s’insinuant ainsi qu’un calme fjord de verdure entre des à pic rocheux de douze cents, dix huit cents, deux mille six cents pieds. Une brèche extrêmement étroite, par où fuit le torrent lui sert de seuil. Partout ailleurs elle est close. Des moines vécurent là sans bruit et presque sans faire parler d’eux durant quatre siècles — chose rare pour une grande communauté du Moyen-Age. Une ferme est dans la ruine, mais c’est la ruine que l’on vient voir, jolie à souhait : restes de chapelle, arcs solitaires, escaliers rompus et pierres descellées baignant dans les hautes herbes. Au moment de notre visite, un coq qui a choisi pour son perchoir un vénérable reste de pilier, claironne ses amours, cependant que de petits porcs noirs, agiles et charmants, se lutinent avec frénésie sous les voûtes écroulées du cloître. O cette animalité mutine parmi les souvenirs de pénitence, parmi cette solitude redoutable ! Quel fil de mélancolie à dévider pour une âme sensitive que le spectacle d’un pareil tableau ! Mais au lieu de chercher des raisons à la nature, ne vaut-il pas mieux mêler le rêve£t la vie dans une juste proportion ? Ne vaut-il pas mieux, comme le paysan, accepter la force des choses, et au besoin s’en accommoder et en jouir ? Les siècles imposent à l’ouvrage des hommes des superpositions impayables, inattendues.
Le Valcroissant, ou du moins quelques-unes de ses sources, admirablement limpides, servit, sous les Romains, à l’alimentation de Die. Ces eaux étaient amenées par un aqueduc dont quelques pierres se voient encore. Courant sur les confins méridionaux du vaste territoire de Die (près de 7000 hectares), le ruisseau, avant de terminer sa courte carrière, regarde en passant Salières-les-Bains (vapeurs à la thermo-résine) et sa fontaine ardente, petite sœur de l’ex-merveille de Dauphiné (2).
La Meyrosse ou Mérosse est également redevable au Glandas de ses plus belles fontaines. Née au Pas-des-Econdus (1736 mètres), elle descend très rapidement jusqu’aux Vignons (3) au sein d’une admirable vallée close que dominent les crêtes turriformes de Glandas, reçoit le Rays, dont les eaux glacées abreuvent la cité des Voconces, franchit au pont de la Roche un arc de triomphe naturel célèbre, atteint Die, s’y souille et ribaude quelque peu dans les profondeurs malsaines d’un vieux faubourg et gagne la Drôme après une course de douze kilomètres.
(1) M. d’Ingler. (Delacroix, Statistique de la Drôme).
(2) La Fontaine Ardente de Vif (Isère).
(3) Commune de Romeyer.
VI
LA VILLE DE DIE ET SES ORIGINES : LA DÉESSE ANDARTA,
LE CULTE DE CYBÈLE ET LES TAUROBOLES. LE CHRISTIANISME DANS LE DlOIS : LES ÉVÊQUES ET LES LUTTES DU MOYEN-AGE. — LA RÉFORME. PROMENADE DANS LA VILLE DE DIE ET PARTICULARITÉS DU CARACTÈRE DIOIS.
A qui vient de Paris, de Lyon, ou même simplement de notre mégalomane Valence, la ville de Die peut paraître un village : venelles où les poules picorent, vastes bassins de pierre où bleuit la lessive et placettes mal aplanies où elle sèche ensuite sur des cordes entre de grands ormeaux, empiétement de la voie publique par l’oisiveté jaboteuse des commères, pavé rare et rouillé, trottoirs suspects, bruits innocents comme ceux du rabot, de la lime ou de la scie au sein des boutiques désuètes à ravir, quelques gendarmes en fait de garnison, tout cela compose un ensemble rural des plus évidents. Mais pour qui descend de la montagne avec des yeux non libérés encore de la mélancolie des sapins noirs et de l’immensité poignante des solitudes pastorales, Die se présente sous les traits indéniables d’une cité : grande route, chemin de fer, promenades ombreuses, eaux vives, bâtisses suffisamment hautes et bourgeoises, hôtelleries et cafés passables, cercle, petite gazette locale, lot de fonctionnaires prompts à se saluer, c’est en un mot la sous-préfecture qui a de l’amour-propre.
Mais quel parfum d’antique province en cette pauvre ville effacée où rien, parmi les ombres bleues, si favorables au sommeil de quelques mendiants — les plus heureux des hommes — n’attente à la douceur de votre promenade ! Et que de vieilles pierres pour y susciter l’émotion et ébranler le souvenir ! Chaque fois j’y viens pour y faire la même chose : songer, songer des Voconces, de Rome, du Moyen-Age, des guerres religieuses, et le soir me surprend dans ses rues muettes comme si j’allais, contribuable ému des empereurs, y voir passer parmi la foule impatiente les flamines, ou le curateur des jeux et spectacles, ou bien le bouillant évêque Amédée de Roussillon, mitre en tête et cuirasse à l’épaule, suivi d’une cavalerie fringante.
Die est une assez grande dame devenue servante, mais la servante dissimule imparfaitement la grande dame que l’on reconnaît à l’allure, à la physionomie, à la robe jadis galante, aujourd’hui passée et pleine de trous.
Die a compté dans l’histoire. Dans ses rêves ingénus d’humble chef-lieu d’arrondissement, elle se voit capitale. Par malheur, l’histoire — j’entends l’enseignement populaire, vulgaire — ne s’en inquiète pas. Et il en va de même ainsi pour des contrées, des villes, des bourgs qui tinrent une place honorable dans nos vieilles chroniques. On n’apprend à l’école ou au collège que l’histoire de Paris et de sa prodigieuse fortune et on l’appelle l’histoire de France. En réalité, l’histoire de France, c’est-à-dire l’histoire de l’ensemble des provinces, ne fait ses confidences qu’aux savants. Ce n’est pas un objet de consommation courante, mais un article de luxe, inabordable de prix quand il n’est pas introuvable. Il y aurait peut-être mieux à faire. Loin de moi la pensée de réduire ou de contrecarrer l’enseignement général, et la méthode une et patriotique, en somme, des Universités. Mais on pourrait apprendre, ce me semble, son pays dans son pays, sans gêner beaucoup l’histoire de France et cela, familièrement, en quelques tableaux, en quelques leçons. Quoi de plus aimable, quoi de plus impressionnant, quoi de plus profitable à l’esprit que le passé dont on sent l’ambiance autour de soi, dans la poussière duquel on marche tous les jours.
La ville de Die devait me causer ces réflexions. Nulle n’a été plus célèbre dans la vallée de la Drôme et nulle ne garde tant de souvenirs. Chaîne bigarrée d’or et de sang que son passé deux fois millénaire.
Point de jonction de la plaine haute et des monts, et peut-être timide emporium d’un trafic celto-grec, notre ville hérite à coup sûr d’une très vénérable aïeule. En raison de ses avantages physiques, qui sait si elle ne fixa point l’une des. étapes de l’expansion aryenne dans nos Alpes ?
Problème difficile à résoudre, et dont la solution, d’ailleurs, importe peu. Mais sans remonter à ce déluge d’hommes qui noya l’Europe, et du limon duquel sortirent la plupart des civilisations, il n’est- guère présomptueux d’affirmer l’existence du bourg celtique dès les premiers vagissements de Rome. C’était un de ces pagi (1) des Voconces qui, soudés les uns aux autres, formaient la patrie commune, la cité. Cette cité des Voconces, vaste de plus ou moins d’un million d’hectares, soit l’étendue de deux départements moyens, se divisait en deux grandes circonscriptions, commandées par l’état des lieux. Comme nous l’avons vu, les capitales étaient Luc et Vaison. Mais Die, tout d’abord ignobile oppidum (2), suivant l’expression de Pline, devait se décrasser en un jour et ceindre, à la place de Luc, ruiné par la guerre, la couronne augustale.

Die, c’est le nom lumineusement frappant, le nom sacro-saint de Dea ou Dia (déesse). Mais de quelle déesse s’agit-il, ou plutôt de quel culte, puisque la déesse Andarta nous est connue par des inscriptions votives ? Savants, salivez encore, salivez toujours, Le vieux Chorier, humaniste avant tout et très seizième siècle, ne pouvait manquer de voir dans le mot une origine grecque. Pour lui, Dye, déesse sicyonnienne, a présidé aux destinées de la capitale des Voconces. Opinion naturellement reçue comme un chien dans un jeu de quilles par les celtisants. Pour eux, c’est tantôt une Borne — divinité un peu benoîte et disons le mot, un peu bornée pour mériter un tel honneur, — tantôt une Victoire, tantôt une Chasseresse, une Diane locale, et même beaucoup moins que cela, un simple composé grammatical, un humiliant et prosaïque agglutiné signifiant deux eaux (3), et, en effet, la ville de Die s’espace entre deux rivières : Drôme et Meyrosse. Les latins purs l’identifient soit avec Livie, femme d’Auguste, que la vanité romaine mit au rang des Olympiens, soit avec Cybèle, la déesse par excellence, la Mère des Dieux. Et — comme pour vous mettre l’eau à la bouche — on a découvert dans le sol voconce huit ex-voto à Andarta! Aucun, malheureusement n’exhume les attributs de cette mystérieuse déesse, aucun ne révèle sa figure morale. Scientifiquement, hélas, je n’ai pas de préférence, et j’ai dû borner ma curiosité de passant à cette énumération sans commentaires, mais toutes mes sympathies d’instinct vont à l’ Andarta pré-latine de M. Florian Vallentin, à la simple, agreste et honnête divinité du foyer voconce, au .génie aimable et parlant de ce vieux naturalisme que ni Grecs, ni Romains, ni Barbares, ni Chrétiens n’ont réussi à chasser complètement de nos montagnes.
Ces Voconces, alertes et gais, et qu’on nous dit pères de Novare la Lombarde, devaient s’amollir au contact latin et perdre quelques-unes de leurs vertus. Die, faite un peu comme alors toute capitale, à l’image de Rome, connut l’opulence, eut ses temples, ses palais (4), ses arènes, ses thermes, ses jeux publics, ses sévirs, à la fois prêtres et officiers municipaux, tout un collège de sacrificateurs et de prêtresses, ses libraires et jusqu’à ses onguentières ou parfumeuses publiques. Ville de montagnes, elle devait, dans une position aussi reculée, se suffire à elle-même, concentrer la somme de ressources et de distractions indispensables à une population vive, intéressée aux choses du luxe et du plaisir. Mais elle est surtout religieuse, elle est avide de mystères, de symboles, de sacrifices sanglants. Aussi la voit-on l’une des premières en Gaule, mettre à la mode les tauroboles dont elle devient en quelque sorte la ville sainte. Cybèle, honorée en Asie-Mineure sous le nom de Mère Idéenne, à cause du Mont-Ida dont lés innombrables pins lui étaient consacrés, n’était pas -là dépaysée autant qu’on pourrait le croire. Le Glandas, socle auguste lui aussi, montagne héroïque, nourrit cet arbre au port élégant, à la veine si sensible au couteau, et que gonfle la résine, ce sang miraculeux. Il dut impressionner les légionnaires retour d’Asie pleins des mystères de l’Ida ; accueillir et adopter la légende du bel Atys le Phrygien, aimé de la Déesse et changé par elle en un pin toujours vert. On peut se représenter ces nouveaux adeptes de Cybèle comme des décadents du polythéisme latin, en grippe avec l’ancien culte parce que trop simple et trop grave ; comme des gens que n’amusait plus, suivant le mot spirituel de M. Vallentin » la timide Vénus, déesse à moitié chaste d’un Olympe à moitié vertueux ». Il faut dire qu’au même temps, Isis l’Egyptienne et Mithra le Persan voyaient également s’agenouiller des fidèles devant leurs autels, mais leur culte, assez craintif, ne paraît pas avoir gêné le culte devenu tout puissant et en quelque sorte officiel de la Mère Idéenne. Cinq tauroboles attestent la ferveur Voconce envers Cybèle. On en trouve la description dans différents ouvrages, mais ce qu’il importe de savoir à leur sujet c’est que les sacrifices accomplis sur ces monuments; visaient, comme l’ a très judicieusement fait ressortir M. l’abbé Jules Chevalier (5), à une sorte de régénération. Pour grossier et hideux que fût le symbole de ce prêtre recevant en pluie sur la tête, les épaules et dans les mains le sang d’un taureau, il n’en rappelait pas moins la tradition chrétienne. L’officiant, à l’issue de cette rouge cérémonie, se trouvait purifié pour toujours. L’oblation en l’honneur d’Atys le Phrygien consistait dans le sacrifice d’un bélier. Quelquefois le taureau et le bélier étaient immolés simultanément. Le plus grand des tauroboles de Die consacre précisément cette association symbolique, en montrant sur une de ses faces, sculptées avec un art très sûr, les têtes de ces animaux.
Die était donc malgré son éloignement de la mer et d’un grand fleuve une des villes privilégiées de la Gaule. Sans doute, elle le cédait de beaucoup en population, en richesse et en opulence à Lyon, à Vienne et à quelques autres villes majeures, mais elle n’avait pas de rivale dans les Alpes. On aime à se la représenter comme un groupe agreste et un peu fermé, maintenant de son mieux les types sociaux et les traditions du foyer voconce. Les bois, les vins, le miel, la poix et la résine y attiraient des trafiquants, mais, je le répète, on y venait en dévotion. On disait la ville de la Bonne Déesse, un peu comme on dit aujourd’hui le pèlerinage de telle ou telle Notre-Dame. Et les Ages ne changent pas tant les hommes. Quel endroit mieux préparé pour la fondation d’une église ? La piété attire la piété et les religions se superposent. Les plus solides chrétiens ne se recrutaient pas parmi les indifférents du paganisme, mais parmi ses dévots et c’est une des habiletés de l’Eglise d’avoir su faire siennes les attitudes et les passions du populaire. S. Augustin recommande de ne pas exproprier brutalement le paganisme de ses temples, de ses autels, de ses images ; il veut au contraire qu’on les fasse servir doucement aux desseins du Christ. Et voilà pourquoi nous pénétrons aujourd’hui dans la cathédrale de Die par un porche qui, peut-être, fut tout à la glorification de Cybèle.
L’histoire de Die va se confondre désormais avec celle de ses évêques.
Il était une fois… voilà comme j’aimerais aborder la plupart des mitres de Die, si voisines du conte par l’outrance ou l’ingénuité d’âme. Mitres blanches, penchant leur candeur sur les rognes et les squames du Moyen Age. Mitres d’or, mitres conquérantes dominant la mêlée furieuse des guerres intestines.
On s’explique parfaitement aujourd’hui l’absorption qui se fit de la société dans l’Eglise, à partir des Ve et VIe siècles. En face de la brutalité barbare, bien souvent, l’évêque, avec pour seule force, pour seules armes, l’idée morale qu’il représentait, s’était dressé défendant son peuple. Comment ne pas reconnaître de tels services ? Au surplus, écoutons Bancel : » Pour le pape Grégoire VII, dit-il, la société, l’humanité, c’est l’Eglise. Elle mérite d’ailleurs la souveraineté qu’elle s’arroge… Parmi les bestiales horreurs des rois francs et leurs atrocités, l’esprit n’avait d’autre refuge que l’Eglise ». L’évêque, déjà honoré un peu partout du beau titre civil de défenseur de la cité par la reconnaissance publique, n’eut qu’un pas à faire pour joindre à la mitre la couronne ducale ou comtale. Ce pas il le franchit d’un instinct sûr.
Hemico, évêque de Die, est à Mantaille au mois d’octobre 879, en compagnie d’autres prélats et d’un certain nombre de seigneurs. Pourquoi ? Tout simplement pour un coup d’Etat. Il s’agit de détacher du sceptre carolingien Bourgogne et Provence et d’en réunir les deux couronnes sur la tête de Bozon. Déjà le séparatisme ! Il faut dire que nos provinces, polluées par la domination franque, et reniant leur lien ripuaire, n’aspiraient qu’à renaître aux traditions latines, aux mœurs élégantes, à l’indépendance de l’esprit. Si Bozon triomphe, Hemico et ses compagnons sortent du concile la tête haute. Que ne pourront des hommes qui viennent d’élire un roi et de sauver la patrie ? Chose digne de remarque. Ces évêques batailleurs ménagent leurs vassaux et la plupart des historiens s’accordent à reconnaître en eux le bon tyran, si on garde à ce mot sa signification antique, dénuée de malveillance. La main sur les évangiles, ils jurent de maintenir les libertés et les franchises communales de Die et demeurent fidèles à leur serment. Certains valent Louis XI par la ruse et la diplomatie, d’autres égalent les meilleurs capitaines par l’audace et la bravoure. Ils sont si convaincus de leur rôle représentatif et politique, que beaucoup ne se refusent pas les jouissances chères au commun des grands seigneurs, savoir : la chasse au faucon, la chasse à l’ours, les grandes chevauchées, les jongleries.
Et quelle mobilité ! En un temps où les communications sont difficiles, où la voirie est nulle, où les voyages par terre et par mer donnent une valeur exceptionnelle au mot fameux du poète » illirobur et oex triplex… », ils vont en Palestine, en terre germanique, en Italie, à Paris, à Vienne, à Avignon, à Arles, ils vont partout ! C’est que, d’abord, le Diois, comme partie de la Bourgogne, relève nominalement des empereurs d’Allemagne, et il s’agit d’entretenir avec eux les meilleures relations possibles, soit pour l’obtention de nouveaux privilèges, soit pour la confirmation d’anciens droits. Puis, il ne faut pas perdre de vue cette société si incohérente et pourtant si unie dans les croyances, les arbitrages incessants, les conciles, les hommages, l’état de guerre quasi permanent, mais surtout l’amplitude de ce diocèse aux huit archiprêtrés entrecoupés de monts, aux paroisses avoisinant les terres de seigneurs ambitieux, toujours prêts à un coup de main.

L’abbé Jules Chevalier a décrit consciencieusement ces époques d’énergie. Il a fait revivre ces existences d’évêques si fatalement partagées entre le spirituel et le temporel. Une analyse, même sommaire, des principaux faits de cette longue histoire est impossible ici, mais peut-être ne m’en voudra-t-on pas de croquer, d’après les vieilles chroniques du Diois, quelques silhouettes épiscopales.
Si la pauvre nef de la cathédrale enseigne des noms de saints : — S. Martius, entité pieuse, et souriant à la pure légende ; S. Nicaise, un des Pères du grand concile de Nicée ; Pétrone et Marcel, deux frères, dont Grégoire de Tours cite les traits édifiants ; Etienne et Ismidon ; en revanche, les ruines innombrables de la vallée de la Drôme résonnent de gloires plus sonores, plus militantes.
— C’est Hugues de Romans (1073-83), un fidèle de Grégoire VII, de ce formidable pontife, fils d’ouvrier, qui faisait attendre trois jours sous la neige son absolution à un empereur. Qui, légat, joue au pape en France, convoque des conciles, dépose un archevêque, et meurt primat des Gaules, tantalisé peut-être par la tiare ; — l’infortuné Humbert III ( 1222), massacré devant l’une des portes de sa cathédrale — depuis Porte Rouge — victime d’une de ces émeutes populaires, assez fréquentes à Die où les libertés communales trouvèrent d’indomptables champions ; — Amédée de Roussillon (1276-1281), surnommé Heurtebise et ouragan, en effet toujours armé, toujours casqué, hirsute, sobre, dur à lui-même et fraternel à ses Diois, infatigable, héroïque, inouï, qui assiste à vingt rencontres, mate son irréductible ennemi le comte de Valentinois, et est maté à son tour, et meurt enfin moins de ses glorieuses blessures que d’émotion, n’ayant pu foudroyer que d’anathèmes les Romanais révoltés ; — Jean de Genève (1283-98), discuté par ses chanoines dont l’arrogance ne connaît plus de bornes, et obligé de reprendre sur ses propres sujets sa ville épiscopale ; — Guillaume de Roussillon (1298-1331), l’ennemi mortel d’Aymar de Poitiers, mais la providence des Juifs chassés alors de partout ; — Pierre de Chatellux ou de Chalus (1342-52), qui termine la guerre deux fois centenaire des Episcopaux, prélat magnifique et d’un goût éclairé, dont les papes d’Avignon, non moins artistes, non moins magnifiques, s’adjugent après sa mort, les riches collections ; —Amédée de Saluces, grand cardinal qui détient ses diocèses (6) en commende ; — Jean de Poitiers (1390-1447), que l’on voit en relations étranges avec Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, et qui par un vilain tour, dépouille, l’ayant fait prisonnier dans son propre château de Grane, son cousin, le vieux comte Louis II de Valentinois.
Les évêques de Die étaient seigneurs de leur ville épiscopale et des terres de : Aouste, Aurel, Bourdeaux, Bezaudun, Chamaloc, La Chapelle-en- Vercors, Châtillon-en-Diois, Crupies, Jonchères, Mirabel, Montmaur, Poyols, Saillans, St-Agnan-en-Vercors, St-Julien-enVcrcors, St-Martin-en-Vercors, de Vassieux et de Valdrôme pour partie. Ils étaient en outre détenteurs de quatre-vingt cinq fiefs, et jouissaient d’un revenu annuel de quatre à cinq mille florins d’or, soit plus ou moins de trois ou quatre cent mille francs de notre monnaie. Ils exerçaient encore la haute, moyenne et basse justice, gravaient leurs armes, moyennant deux sols par objet, sur toutes les mesures à l’usage de l’époque. Ils levaient des troupes, déclaraient la paix ou la guerre, battaient monnaie, recevaient certains dons en nature, entre autres celui de toutes les langues de bœufs tués dans le diocèse.

Pendant plusieurs siècles, leur pouvoir fut à peu près sans limite. Car des comtes civils de Die dont ils héritèrent à propos, on sait fort peu de chose. A peine les noms de Guillaume, d’Adalelme, d’Aleyris et d’Isoard, — celui-ci emporté dans la tourmente héroïque des croisades — sont-ils parvenus jusqu’à nous.Toutefois, la luminosité douce et poétique d’une femme viole cette nuit d’un éclair charmant. Béatrice, comtesse de Die, vécut, dit-on, au XIIe siècle, et épousa Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois, tout en conservant, après son mariage, le titre du Comté apporté par elle en dot. Son lieu de naissance, sa famille, les principales circonstances de sa vie, sont autant d’énigmes. L’un lui fait tenir cour d’amour à Die, ce qui ne peut que flatter l’âme dauphinoise, l’autre fait du château de Bourdeaux, aux ruines si singulières, son séjour favori. Mais on sait qu’elle ressentit pour Rambaud d’Orange, baron du Languedoc, une passion des plus ardentes qui ne fut qu’à demi partagée. De là ses pleurs élégiaques en ce verbe ingénu, magnifique et sonore que devaient bosseler dans la suite tant de chocs barbares.
Une autre comtesse de Die, Alix ou Allix, que l’on croit fille de Béatrice, régna également, par l’esprit et la beauté sur la chevaleresque Provence.
A quelles causes attribuer le vif empressement du Diois à accueillir la Réforme ? Sans doute autant à son organisme moral qu’à son isolement, à ses barrières naturelles.
» Depuis longtemps, écrit M. Mailhet, la vallée de la Drôme était sillonnée par des barbes, prédicateurs vaudois, des colporteurs évangéliques… » » C’est au sein des vallées dauphinoises, ajoute Bancel, au pied des Alpes, parmi le calme et la sérénité des prés et des bois, simples comme ses agneaux et ses chevreaux, purs comme l’eau des glaciers, que vivaient et travaillaient les Vaudois, peuple pasteur. » Chrétiens libres, ils répudiaient l’alliance avec Rome. Ils firent sans doute une forte impression sur les gens simples et graves de la montagne. Cette foi primitive, toute nue, sans apprêt, sans latin, facile à pratiquer, et quasiment toute intérieure; cette foi aux dogmes retranchés ou refroidis ne pouvait-elle flatter, en ces temps de guerre continuelle, les vagues rêves de fraternité universelle ? Quoi qu’il en soit, la Réforme fit de rapides progrès dans le Diois, et bientôt les guerres de religion y renouvelèrent, en les dépassant, les scènes sanglantes du Moyen-Age. On pille, on pend, on brûle, par devoir. L’incendie de la maison catholique semble au huguenot feu de joie et réciproquement. On éteint dans le sang, dont il reste toujours à propos quelque mare, la torche criminelle.
Jean de Monluc est ce singulier évêque de Valence et de Die que Brantôme nous dépeint : » Fin, délié, trinquât, rompu et corrompu autant pour son savoir que pour sa pratique. » Frère du fameux Blaise, c’est ce dernier qui est le croyant, le prêtre enflammé de colère et de foi. Lui, l’évêque n’a pas tant de vertu. C’est l’homme dont le souple opportunisme saura se couler sans dommage entre les événements tragiques de l’époque. Il sera même — chose incroyable — à propos papiste et à propos biblard.
Jean de Monluc, loin d’arrêter les progrès de la Réforme dans ses diocèses, y aida plutôt en protégeant ouvertement certains membres de la magistrature et de l’université de Valence qui » sentaient le fagot. » Il y eut bientôt un si grand nombre de protestants dans le Diois, que Henri IV, à la demande des synodes provinciaux, se décida à y établir une académie de la Religion. Voilà Die ville sainte du protestantisme, comme Montauban, Nîmes, Montpellier, comme Genève. A son foyer intellectuel qu’entretient le zèle pieux d’un Charnier, jusqu’à 150 étudiants viennent dilater leur esprit, affermir leur conscience. Die répare ses désastres, renaît à la vie industrielle et commerciale, voit ses draperies, ses tanneries, ses papeteries reconquérir leur vieille renommée.
Ce temps de prospérité dura peu. Amputée de son académie en 1684 par Louis XIV, et par surcroît, vidée tout d’un coup de ses protestants par la révocation de l’édit de Nantes, la vieille cité éparpilla son âme un peu partout, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique, et même en Amérique. La restitution de son évêché, rattaché à celui de Valence depuis environ quatre cents ans, ne compensa point les pertes qu’elle venait de faire. Ce titre de ville épiscopale, elle le perdit d’ailleurs à la Révolution.
(1) Pagus, district, cercle, division territoriale.
(2) Ville de peu d’importance.
(3) Di et A, deux eaux, d’après Bullet.
(4) Un quartier de Die s’appelle de toute ancienneté le Palat ou Palas.
(5) Essai historique sur l’Eglise et la Ville de Die.
(6) L’évêché de Die fut uni à celui de Valence par le pape Grégoire X en 1276, sans confusion des diocèses, il en fut de nouveau séparé en 1687 sous Louis XIV.
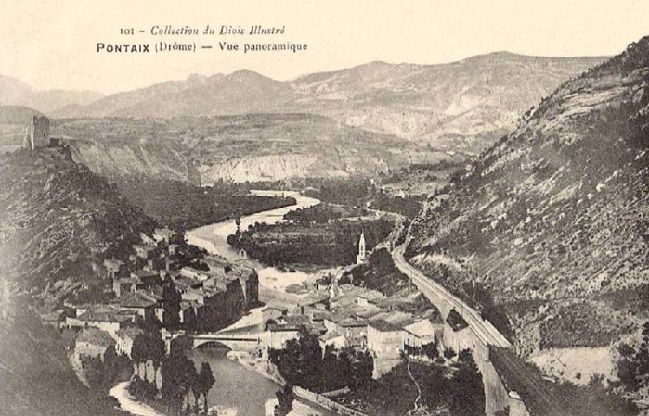

VII
Die a été plusieurs fois livrée au pillage, jadis par les Barbares et par les factions politico-religieuses, de nos jours, par les archéologues, — ceux-ci, on le conçoit, dans des intentions différentes. —Mieux peut-être qu’en aucune cité dauphinoise, mieux qu’à Vienne, qualifiée Pulchra et Ornatissima par les Empereurs, on y respire ce mucre latin, cette odeur spéciale que gardent, des civilisations dont elles furent imprégnées, les vieilles murailles.
Le Moyen-Age, à qui l’énorme coûtait peu et qui maçonnait au besoin la montagne, bâtit et rebâtit d’une truelle inlassable dans la vallée de la Drôme, mais ici, pressé sans doute, il se borna à modifier et à ressemeler dans le sens de son architectonique. Sous les évêques, la ville était, dit-on, percée de douze portes ou poternes et flanquée d’un nombre considérable de tours. On y employa, pêle-mêle, sans les défigurer, sans les dépaïenniser, les matériaux de tous les monuments anciens. Ces pierres, petit à petit, se retrouvent, et chaque fois que la pioche en exhume, Die se sourit à elle-même.
Deux portes romaines donnaient jadis accès dans la ville. Sous le prétexte bouffon, de donner de l’air à un quartier, la porte St-Pierre a été abattue. Il reste la porte St-Marcel, arc de triomphe de paternité fort douteuse, — et très joliment fruste. Va-t-on le jeter par terre ? Les savants, les curieux, tous ceux qui, à différents titres gardent au passé quelque tendresse, peuvent avoir confiance en M. Joseph Reynaud. Le maire de Die, dont la sensibilité de lettré s’est émue de mainte déprédation, garde sa ville.
A part le très beau porche que l’on sait, présent durable de Cybèle à l’Eglise, la cathédrale, dépecée par le terrible La Tour Gouvernet, et réédifiée au XVIIe siècle, est la laideur même. S. Nicaise, S. Pétrone et les quelques autres saints patrons de Die, en baissent les yeux. Le chœur, toutefois, offre au rez-de-chaussée des stalles anciennes richement sculptées. Le clocher, très court, finit lâchement en un affreux campanile de fer. La tour ruinée de Ste-Agathe est le seul reste d’une citadelle bâtie en 1595. La tour de Purgnon, débris vénérable d’un château des évêques bâti au XIIe siècle, a été convertie en 1860 en une chapelle sous le nom de N.-D. d’Espérance. Quant à la citadelle, sise sur une sorte de terrasse d’où la vue plonge fort agréablement sur la ville et sur toute la vallée de la Drôme, ce n’est qu’un vaste décombre.
Mais il faudrait dénombrer les vieilles pierres qui, partout, lapident le sol d’ex-voto historiques, et qui nous confient le secret de leurs joies et de leurs peines ; il faudrait parler des bancs publics, jadis orgueilleux bas-reliefs, et des fontaines ex-colonnes de temples ; il faudrait citer les maisons romanes aux voûtes pesantes dont l’une, habitée justement par M. Reynaud, demeure si précise en ma mémoire autant par le plaisant anachronisme de son architecture que par l’exquise hospitalité que j’y reçus ; il faudrait doubler les angles vifs et comme méchants de certaines ruelles et lever les 3’eux vers leurs fenêtres ouvragées ; et il faudrait ne pas oublier les savants, tel cet opiniâtre Denis Long, qui fouilla toute sa vie le sol de sa ville natale. J’ai ma Drôme à suivre,- ma Drôme dédaignée un peu de la cité qui lui tourne le dos, et que je vois serpenter là-bas par l’échappée des ruelles dans le verdoyant bassin du Périer, le jardin potager de Die !
Hâtons nos pas. La comtesse de Die a peut-être tort de clore ses jolies paupières. Elle est sur une place si calme, si ombreuse, si propice à une cour d’amour ! Mais sans doute elle médite, l’esprit bercé par le murmure des fontaines jaillissantes. Le buste noble et séduisant, dû au ciseau de Mme Clovis Hugues, fut inauguré en août 1888, au début de la plus mémorable tournée peut-être des Cigaliers et des Félibres. Maurice Faure, Henry Fouquier, et quelques autres bouches d’or, avec, pendus à leurs basques, tout un essaim bourdonnant de poésie, excitèrent dans ces montagnes un enthousiasme indescriptible. De toutes parts les rustiques : bergers, vignerons, et simples pied terreux’ vinrent boire à la coupe fraternelle de poésie. Et tout un jour, le peuple, dans un élan superbe, vint affirmer son droit à la beauté par une compréhension touchante des oeuvres pures de l’esprit. Ne vit-on pas ces braves gens, haranguer les représentants du gai sçavoir, des messieurs de Paris, puis leur offrir des fruits et des fleurs ?
Mais — qu’on me pardonne — le plus beau monument de Die, c’est le Glandas.
Si le mont Aiguille, qui d’ailleurs fut diois sous les évêques, est un prodigieux obélisque, le Glandas eut en son impayable structure, je ne sais quel chimérique Kremlin, vers lequel monteraient les respects, sinon les admirations des habitants. Les gens de Die qui lui vouent un culte, n’y vont guère. Ils se contentent de le regarder tout le jour, mais laissent volontiers à sa solitude ce puissant arbitre du vent et des orages. Les rares excursionnistes s’y hissent par la vallée de Romeyer. C’est la route suivie depuis un temps immémorial par les bergers de Provence, que M. Etienne Mellier, définitif historiographe des transhumants, nous montre en des pages si attachantes, poussant devant eux à travers siècles et civilisations leurs hordes débonnaires et bêlantes. La draille est inégale et peu sûre, mais aussi elle s’entretient toute seule, ni plus ni moins que jadis les sentiers voconces, et elle est pleine de charme et d’imprévu.
Le Glandas donne à boire aux Diois d’une urne si libérale que la ville est à cet égard l’une des mieux pourvues de France — eau admirablement limpide et délicieusement glacée. Sur ses flancs, drus de pins noirs et de grands hêtres, on cueille à pleins paniers entre autres cryptogames, un champignon appelé vulgairement beligouras et qui doit être le clavaire jaune. Des fleurs rares émaillent ses patriarcales terrasses si vertigineusement suspendues, et l’arnica montana, sur certains points délaissés par les lapiaz, y lève de véritables moissons.
Ce cirque de montagnes aux merveilles trop secrètes, ces imposants belvédères, ces sanatoires d’air pur et de lumière, toute cette nature agreste qui fait si bien planer sur Die comme un charme primitif et mystérieux lui vaudront quelque jour des touristes, de nombreux touristes, et des Anglais sans doute, ces Pères de l’Agitation perpétuelle. Mais la ville, sortie enfin de sa torpeur, et avec sur sa face vieillotte et archaïque le fard du badigeon, nous demeurera-t-elle aussi chère, et y trouverons-nous pour nos rêves la même douce quiétude ?
Die abrite à peine quatre mille habitants, gens aussi peu amorphes que possible. On y tient en particulière estime les amuseurs, les buveurs, les casse-cou. Il existe à Die l’homme qui a mangé de tout, et il paraît que les digestions heureuses de ce Voconce n’ont pas d’histoire. Est-ce que cette force d’instinct et cette animalité plaisante, comblées par de tels goûts, ne ressuscitent pas toute une préhistoire endormie ? Des types, ces Diois ! aussi bien aux anciens jours qu’à notre époque. L’énergie de leurs syndics au Moyen-Age, touchant les libertés de la commune, est légendaire. L’un d’eux, Albert Maurin, sorte d’Etienne Marcel, s’imprime dans les vieux souvenirs avec une netteté d’eau forte. Mais il y a aussi des figures plaisantes, hilares, tel le philanthrope Berton Gabert. Les auberges étant, paraît-il, très malfamées en 1437, et la loi, d’autre part, infligeant trop souvent le fouet aux pauvres ribaudes et aux femmes adultères, l’excellent homme ne trouva rien de mieux pour concilier la morale publique et sa pitié native, que de s’exproprier lui-même en faveur des filles de joie. D’après l’acte de donation, sa maison de la rue du Palat devait leur servir d’asile « tant de jour que de nuit « . Nul ne dit combien d’années fonctionna ce lupanar municipal.
David de Rodon ou Derodon est une physionomie curieuse du XVIIe siècle. Protestant, il se fait catholique et publie : Quatre raisons pour lesquelles on doit quitter la religion prétendue réformée. Raisons dont il se met bien vite à rire en redevenant protestant. Il publie alors : Le tombeau de la Messe, livre piquant et bizarre qui est condamné au feu. Professeur de philosophie à Orange et à Genève, il se flatte d’être également détesté par les protestants et les catholiques que tour à tour il assomme de ses satires, comme d’un marteau.
Ces « fortes têtes », ces batailleurs, ces péroreurs, ces rhabdomanciens, et même ces gens d’esprit, — d’un esprit caustique et verveux en diable — tel le poète Boissier, sont des particularités morales précieuses à noter.
Il y a peu d’années, —je tiens ce détail de M. Reynaud — les gamins de la haute ville (quartiers du Palat et de St-Pierre), attendaient tous les jours ceux de la ville basse (St-Marcel) sur un point donné, et immédiatement les champions s’attaquaient avec une incroyable furie. Ces rivalités, souvenirs obscurs des discordes civiles, ont existé d’ailleurs dans d’autres localités dauphinoises où on a dû maintes fois en réprimer le scandale.
Notons encore, pour en finir avec les diois dignes de mémoire, outre les noms déjà cités : Artaud, un vieux juriste du XIIIe siècle ; Avond, un curieux mystique, qui fit un poème en l’honneur du sacré vœu de virginité ; Rambaud, un avocat du temps d’Henri IV ; l’antiquaire François Drojat, et plus récemment, l’érudit auteur de la Biographie du Dauphiné, Adolphe Rochas, mort à Valence, il y a quelques années.
Die présente un caractère rustique et agricole trop prononcés pour accorder beaucoup à l’industrie. Pourtant, ses eaux vives, — force considérable — y maintinrent longtemps des fabriques florissantes. Elle façonne aujourd’hui des meubles et des parquets, blute du ciment et ouvre la soie (le canton a produit jusqu’à soixante mille kilos de cocons). Mais, c’est la patrie de la clairette — notre Champagne à nous, Dauphinois, — et à ce propos, il est bon de rappeler que le vin poissé de Vienne, que vante le vieux Dioscoride, — poissé peut-être avec de la poix vocontienne — et le vinum dulce de Die étaient déjà des crûs classés au temps des Césars. La sensualité romaine s’émerveillait de ces vins d’Alpe — l’un, amer et chaud, l’autre doux et mousseux et procurant aux narines une chatouille délectable,— l’un, vin d’estomac,l’autre, vin de tête. — Naturellement, le phylloxéra a fait des siennes, ici comme ailleurs, mais la Clairette de Die n’a rien perdu de ses brillantes qualités, et l’effort patient des populations durant plus de vingt ans, a permis de reconstituer le vignoble. Les bois, les noix, les moutons, les agneaux, les porcs et les chèvres complètent les éléments du commerce local.
Le Martouret, ancienne maison seigneuriale, et Saillères ou Salières, tous deux établissements thermo-résineux, soignent les arthrites régionales.
Les armes de Die sont de gueules au château surmonté de trois tourelles d’argent.
VIII
DE SAILLANS A CREST. — PIÉGROS-LA-CLASTRE, MIBABEL ET BLACONS. — LA VALLÉE DE LA GERVANNE, LES GORGES D’OMBLÈZE ET PLAN-DE-BAIX. — BEAUFORT. — AOUSTE.


Saillans ouvre une porte rustique sur un jardin qui n’en finit plus. A mesure que l’on avance vers Aouste et vers Crest, on sent que la montagne vous délaisse, qu’elle abandonne la partie. En même temps, il semble que l’on infuse dans un ciel plus léger. Adieu les gorges. L’œil, à la rigueur, peut s’effarer encore des derniers heurts de la tempête figée du Diois, mais ce qui l’attire surtout, c’est la pente douce de la vallée, ce joli fleuve de cultures courant là-bas jusqu’à ce que des voiles l’effacent, ces voiles ténus et pourtant infrangibles que tendent toujours entre les collines lointaines de malicieuses vapeurs bleues. Au mitan, la rivière qui se cherchait jusque-là, se révèle adulte, croit s’être trouvée. Mais la destinée l’a marquée pour souffrir. Après la nature, l’homme. Le bourreau n’a fait que changer de nom. Finies, n’est-ce pas, les transes de l’étranglement dans le noir des défilés, mais c’est la saignée qui commence. Tout à l’heure, la torture à huis-clos, maintenant le supplice sous le soleil, dans la plaine élargie, et pour ainsi dire parmi la clémence ironique des choses ! Coule-t-elle prudente, au milieu de son lit ? La traîtrise d’un barrage l’amène auprès des terres. Glisse-t-elle bénévolement contre une berge ? On lui ouvre de même le flanc. Et le sang frais, le sang clair gicle à droite, gicle à gauche, gorgeant les guérets. On ne sait pas ce qu’endurent les pauvres rivières pour les vallée coquettes, pomponnées, fleuries…

Saint-Sauveur, Aubenasson, villages de rien, l’un malgré son ancien prieuré de l’ordre de St-Antoine, l’autre malgré son château d’Aubenas — entendez par château, une ferme des plus candides. Mais Rochecourbe n’est-il pas grand de reste ? D’ailleurs, Piégros-la-Clastre et Mirabel et Blacons ne sont pas très loin et de leurs tertres mornes on pourrait faire lever d’assez drus souvenirs.

A Piégros(1), abbaye, puis prieuré, le paysage de silence et de mort, garde quelque chose de monastique. Parfois, dans la lande montueuse, le pied bronche contre des pierres qui furent imprégnées d’oraisons lentes, le long des siècles, et il en demeure, éparse, comme une mélancolie. Ce passé agenouillé, on dirait qu’il rumine encore, là-haut, à mille mètres d’altitude, dans une pauvre chapelle où l’on monte invoquer S. Médard ; là-bas, dans l’appellation austère du village chef-lieu, La Clastre (clanstrum, cloître), où les moines descendirent au XIVe siècle et où il s’érigèrent en commanderie.

Mirabel a conservé, au contraire, la maison commune. Fauve est ce village, jadis place forte des évêques de Die, qui y déléguèrent longtemps le pouvoir à la maison de Blacons. Dépositaires infidèles, ces Blacons se firent protestants et avec eux tout le pays, qui eut dès lors beaucoup à souffrir. C’est là, à la suite d’un combat mémorable que Montbrun, pâle et sanglant, dut rendre son épée à deux gentilshommes catholiques, lieutenants de de Gordes. L’un était d’Ourches, l’autre François Dupuy-Rochefort, l’un de ses proches ! De pareils tête à tête n’étaient pas rares dans les guerres de religion. Montbrun, conduit d’abord à Crest en litière, fut ensuite transporté à Grenoble où le Parlement entendu d’avance avec le roi, devait le condamner à la peine capitale. Motif: le crime de lèse-Majesté. Moqué, battu et mécontent, Henri III n’était pas homme à oublier ; surtout il ne digérait pas la prise de son bagage à Pont-de-Beauvoisin, l’année précédente, et le fameux propos égalitaire tenu par Montbrun lors de ce fol exploit, à savoir » qu’en temps de guerre, qu’on a le bras armé et le cul en selle, tout le monde est compaignon. » De là son rire jubilant et ses frottements de mains à la nouvelle de l’affaire de Blacons, de là le mot rapporté par Brantôme : » A ceste heure, il verra s’il est mon compaignon ! «
Pour en revenir aux seigneurs du lieu, disons seulement qu’un certain Pierre d’Armand de Forest indifféremment appelé Blacons et Mirabel par les contemporains, fut un des plus intrépides partisans réformés du XVIe siècle. Après avoir été gouverneur de Lyon, puis de la principauté d’Orange, il serait mort en 1574 au siège de Livron. Les biographes citent encore les noms de son fils Hector, qui servit sous des Adrets avec vaillance et cruauté aussi sans doute, et d’un de ses descendants probables, le marquis Henri-François-Lucretius, l’un des premiers députés de la noblesse aux Etats-Généraux, qui spontanément renoncèrent à leurs privilèges.
Mais trêve à ces souvenirs de sang ! A la place où Montbrun tombait, la cuisse fracassée, bourdonne aujourd’hui au sein d’un vallon égayé par les arbres et les eaux vives, une grande ruche industrielle. Interrogez quiconque sur la grand’route : Blacons ? — Oui, vous savez-bien, … le papier. Et combien de gens ainsi synthétisent en France, découvrent par des expressions concrètes leurs âmes positives ! Le papier, il faut le dire, sert beaucoup mieux que son histoire, l’actuelle renommée de Blacons. Même, j’y songe, non sans quelque attendrissement, c’est sur ces feuilles, à la fois robustes et luxueuses, portant le nom de Blacons, imprimé dans la pâte blanche et faisant de la musique quand on marginait — parfois au dam des oreilles trop sensibles d’un pion impulsif — c’est sur ces belles feuilles que nous faisions nos compositions, que nous mettions nos devoirs au propre, au collège. Oh ! leur bonne nature supportait tout, ne voyait aucun mal à l’absence de la raison ou de la rime, et s’il leur arrivait de soupirer en rendant un léger bruit mat, c’était d’avoir reçu des boulets noirs sur leur robe immaculée. Et depuis cette époque que d’outrages n’ont-t-elles pas subi sous mes yeux ! Adresses, requêtes, suppliques, ce par quoi, tous les jours, notre impétrante et peu fière humanité fait voir ses tares, ses trous.
Laissez-moi plaindre en passant ce pauvre papier ministre… laissez-moi jeter sur son berceau un regard ému.

Blacons à peine dépassé, on traverse la Gervanne. Pour être juste, je devrais au moins un chapitre à cette sémillante rivière. Mais il est dit que je serai fils ingrat pour la Gervanne, comme je l’ai été pour le Bez, pour Glandas, pour le Vercors. La Gervanne, il faudrait raconter sa vie, ses vertus, ses folies. Il faudrait la prendre depuis sa première fontaine sous ce fameux mur entre deux précipices qu’on appelle je ne sais trop pourquoi, le col de la Bataille, et ne la quitter qu’à son embouchure. Dans les gorges d’Omblèze, on rêve des crispations effroyables de la matière quand l’Alpe se débrouilla, et la catastrophe, quand parfois le vent sournois de la montagne s’en mêle, ne semble qu’en suspens. Des blocs prodigieux çà et là menacent, et il semble qu’il ne faut plus qu’un coup de pouce pour les faire choir, pour abolir ce qui est. Mais quelle gaîté à côté de cet effroi ! C’est la grande avec la petite Pissoire, avec d’autres Pissou. — C’est-à-dire l’eau qui jase à vous doucher sur le chemin même, sinon à vous rendre sourd. Puis c’est le cirque d’Ansage, et puis l’épouvante. Un peu ce que vous éprouveriez à la vue d’un enfant précipité dans le vide. Il n’y a qu’un instant, la Gervanne gamine avec un moulin pour jouet, le moulin de la Pipe — savourez ce nom — glissait de toute son innocence sous les saules. Tout à coup le sol lui manque. Elle tombe de plus de quarante mètres. Un saut et un trou si impressionnants cette Druise (2) que des fillettes, conduites à ce spectacle et au préalable averties, se mirent à fondre en larmes. Des truites de race, reconnaissables à leurs disques roses, remontent l’effroyable chute au dire des pêcheurs. La rivière est lente à se ramasser. Elle ne sait plus comment sortir du gour ténébreux. Elle se sauve enfin, mais l’abîme continue. Le pays en demeure fêlé tout au long. Les hameaux de Plan-de-Baix et surtout cet intrépide château de Montrond assis sur le bord de l’horrible lèvre, font frissonner. Une entaille à gauche, c’est le Sépie qui presse deux petits troupeaux de granges (3) visiblement tombés du ciel. Une entaille à droite, c’est la Blache qui isole le Velan de la Raye et possède un Trou de l’Enfer. Toute contrée qui se respecte a des Ponts du Diable ou des Trous de l’Enfer.
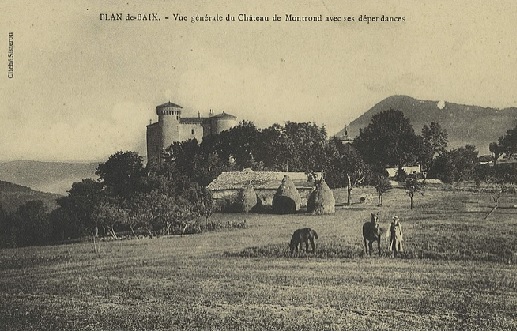

Beaufort, vieille aire féodale, est au centre de la vallée de la Gervanne, ce qui lui donne pour les foires, le commerce, le passage, le pas sur Montclar, Gigors et Suze, agglomérations voisines. Il a un belvédère charmant sur le torrent frais émoulu des gorges et une source magnifique, les Fontainieux. Un grand et probe artiste, le graveur Adrien Didier, élève d’ Henriquel Dupont et de Flandrin, et qui a été chargé d’exécuter le diplôme de l’Exposition Universelle de 1900, vient tous les ans à Beaufort passer la saison chaude. Il s’y délasse de son art en taquinant la muse, la muse fruste des bords de la Gervanne qui parle gavot, porte le cotillon de toile et le bonnet chiffonné. Enfin, Beaufort compte une illustration protestante : Pierre Lombard ou plutôt Lombard-Lachaud qui fut député du Loiret à la Convention et mourut pasteur à Crest.



Comme nous l’avons vu, le torrent tombe à Blacons dans la Drôme par deux cents vingt-deux mètres d’altitude, après avoir réfléchi un instant les ombrages du château de Vachères (4) et trimardé sans vergogne pour les gens de Bertalhais, un hameau industrieux que Mirabel regarde de toute sa hauteur moyenâgeuse.
Aouste. C’est un nom glorieux que peu de cités portent ainsi sans alliage. Une en Italie dont le roman est venu grossir la renommée, et je crois deux ou trois autres en France seulement.
Sans conteste, notre bourg devait l’avoir mérité, car Auguste n’effeuillait pas uniquement pour le bon plaisir cette fleur sacro-sainte du vocable. Aouste — par tradition les habitants prononcent Oste — était donc, à l’aube chrétienne, l’un des noyaux du Vocontium, une de ces colonies prospères qui, placées aux débouchés des monts, permettaient aux vainqueurs d’avoir l’œil sur d’immenses territoires. L’Itinéraire d’Antonin, la Table de Peutinger et L’Anonyme de Ravenne mentionnent l’Augusta Vocontiorum qu’ils placent sur la grande route du mont Genèvre, entre Valence et Die. Malheureusement, Aouste n’est guère qu’un nom, car, à part un autel romain dont l’inscription a été reproduite dans divers ouvrages, on n’y a découvert que d’assez insignifiants vestiges. La ville, anéantie par les Barbares, aurait, dit-on, grâce à ses puissantes racines, rejeté à une demi-lieue de là. Ce rameau, bientôt vigoureux, expliquerait ainsi l’origine de la ville de Crest. A son tour, fils pieux, Crest serait venu relever Aouste des ses ruines. Quoiqu’il en soit, le bourg, dont il n’est plus question pendant plusieurs siècle, s’était repris à l’existence dans la seconde partie du Moyen-âge. Nous y voyons une enceinte percée de quatre portes suivant les quatre points cardinaux : Tourelle, St-Christophe, Surville et Sie ou Sye et nous y retrouvons une vieille connaissance, ce bon St-Géraud d’Aurillac, curieuse âme auvergnate — idéal et affaires — qui sème à tout vent de sa filiation pieuse et rêve de mettre partout dans ses meubles l’ordre de St-Benoît. Le prieuré de St-Pierre, fondé de la sorte, et placé sous l’obédience de celui de Saillans, finit par lui être rattaché en 1535. Aouste, qualifié de villette au XVIIe siècle, jouissait d’un état prospère s’il faut en croire le vieil Aymar du Rivail, l’enquêteur informé d’alors, qui vante la fertilité de son sol, et recommande l’usage de ses bourneaux de terre qui font l’objet d’une exportation considérable. Pris et repris pendant les guerres religieuses, comme il se doit, et ruiné en partie, le bourg fut décapité de sa citadelle par Louis XIII.

Aouste, pour se rajeunir, a jeté bas tout ce qui datait à sa vue : remparts, ruelles, maisons, église et son vieux pont dont une pile, fleurie par la pitié des pariétaires, persiste singulièrement au milieu de la Drôme. Le badigeon, ce fard des villes qui se croient (il en est des villes comme des femmes), lui a fait perdre, vous entendez bien, à peu près toute originalité. On jurerait un faubourg de Crest, reprenant après quelques hectomètres de campagne.
— Voyez, on ne vient jamais coucher ici, me lance mon hôte, ami si affectueusement paradoxal qu’il m’a fait séjourner à Aouste et m’a obligé à prendre une chambre. J’ai du admirer avec lui le fin clocher de la nouvelle église, les fabriques de papier-corde, et la Sie ou Sye, affluenticule de vif argent, qui. bondit dans la bourgade juste pour se voir mettre en cage et servir à l’éclairage électrique. Tout cela compensé d’ailleurs par une bonhomie charmante, par des anecdotes sur les Gresse et cette famille Fabre des Essart qui donna un évêque à l’Eglise et aux lettres deux poètes de talent. N’ai-je pas été voir aussi l’endroit où est né Martial-Moulin, le romancier? Je dis l’endroit, car la maison n’est plus sienne, et j’en ai eu de la peine pour lui.
(1) Podium grossum au moyen-âge, et Puy-Gros (gros pic).
(2) C’est le nom de la cascade.
(3) Eygluy et le Cheylard, deux communes de l’arrondissement de Die.
(4) Commune de Montclar.
IX
LA VILLE DE CREST. — SES COMMENCEMENTS. — LES ARNAUD, LES POITIERS, LES ÉVÊQUES DE DIE. — LE CHAPITRE DE SAINTSAUVEUR. LES LIBERTÉS MUNICIPALES. MOEURS ET CHOSES CRESTOISES, LES ILLUSTRATIONS, LA LITTÉRATURE PATOISE. LA TOUR ET LES CURIOSITÉS DE LA VILLE. — LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE.
Rien que pour sa vision si personnelle, si imposante de quelque côté qu’on l’aborde, j’aurais voté pour Crest Préfecture de la Drôme, si j’avais été des commissaires de 1790 (1). Plus petite que Montélimar et Valence, ses concurrentes, en revanche elle était plus centrale (argument de poids si l’on songe à la fièvre concentrique qui régnait alors), et elle trempait ses pieds dans le cours d’eau patronymique du département nouveau-né. Pourtant, Valence l’emporta après trois tours de scrutin. Quand on a des recommandations …
Ma pensée, d’ailleurs, ne comporte pas de regret. Loin de là. Il est infiniment probable, au contraire, que sa promotion au rang de chef-lieu eût gâté notre ville. Il en coûte toujours de paraître et plus la cité se hausse, plus on en veut à son passé. Agrandir, embellir, mais surtout abattre, les hommes de nos jours saisissent toutes occasions de faire parler d’eux. Crest, en demeurant petite, mais hautaine, avec le cube énorme de sa tour énonçant tout d’un trait une époque, et totalisant le paysage, avec ses maisons blanches ou dorées, ses volets gris, ses volets verts, ses toits plats aux tuiles couleur feuille morte comme ceux de la Toscane ou de la Grèce, son quai si clair le long de la Drôme charriant du soleil, a mérité de n’être confondue avec aucune autre dans le souvenir.

La ville, appuyée contre une singulière roche coquillière, dernier contrefort d’une chaîne roide et droite courant vers le nord, sert d’heureux amortissement à cette montagne appelée si simplement et si justement la Raye — raie ou sillon formidable, en effet, de l’immense plaine de Valence. Ce décor symbolique de jadis, ce joyau presque intact, enté sur l’Alpe architecturale, crée dans le paysage une harmonie dont l’œil ne se lasse de jouir. Et il est le fait de gens qui ne songeaient qu’à batailler !
Les hauteurs voisines couvertes de bois font à la ville une ceinture agreste et mouvementée. En face, ce sont les chênaies de Divajeu, maigres et comme inquiètes des ressauts tempétueux de la Forêt de Saou. Les mûriers, quand ils ne font l’exercice en sections irréprochables dans la plaine menue, pomponnent de touches rudes le vert pâle des vignes sur les coteaux, et de hauts cyprès bronzent de mélancolie les jardins suspendus où se plaît l’humeur capricante d’une population vive et hardie. Il y a aussi dans le cadre même de la cité, entre Lozière et Saleine (2), des terrains incapables où profite l’amandier, et là où la roche semble maîtresse et jusque dans ses anfractuosités, on peut voir suspendue aux branches tourmentées de l’arbre biblique, une figue sucrée dont les formes turgescentes déjà remarquées par le vieux Rigaud, un poète-drapier du cru, furent chantées par lui en un couplet trop significatif pour que je me risque à le reproduire. Avec cela un ciel limpide, bleu comme ne l’oserait pas toujours un peintre, un air d’une transparence telle que l’œil détaille les plus négligeables broderies de l’horizon. Les paysages baignent dans une lumière caressante et blonde, déjà voisine de celle des golfes latins.
Au temps où les Dieux fréquentaient chez les hommes, Saturne, allant fonder la Rochelle, eut la fantaisie de passer par le Dauphiné. Chemin faisant,
« Il veoit et Serre et Die, et le Crest qui se vante
De tirer de Crestos le grand roy sa descente. »
C’est ce qu’on peut lire dans un poème du xvie siècle, récemment exhumé de sa poussière et de sa nuit. N’en rions pas. Kronos, en ces temps fortunés, semait volontiers l’innocence et laissait tomber l’âge d’or en manne des plis divins de son manteau. Il faut regretter seulement que l’auteur — un Dauphinois, vous l’avez deviné — ait embouché une trompette d’airain au lieu d’une trompette de bois.
Crest (Crista, crête), est un de ces noms qui parlent à l’imagination, comme en trouvaient d’instinct nos ancêtres, à force de regarder dans la nature. Le Crest en Auvergne, le Crestet dans le Comtat, et quelques analogues ne signifient pas autre chose. En particulier, notre roche crestoise, dont la haute tour festonne et double en quelque sorte le caroncule, coquerique avec un rare bonheur. Et cela, à tout prendre, vaut mieux que la fuligineuse mémoire du roi Crestos.
Il est singulier qu’avec une position si avantageuse, Crest n’ait pas fait parler de soi avant le xne siècle. Le pape Calixte II s’étant avisé d’y écrire une lettre aux évêques de Coïmbra et de Salamanque, « ses vénérables frères », l’écrit est demeuré jusqu’à nos jours le plus authentique extrait de baptême de la ville. Il porte la date du 2 mars 1120, Apud castrum Cristam. Aouste la romaine, y avait-elle, comme on l’a insinué, un poste d’observation, d’avant garde ? Cela n’est pas certain, mais ce qui est hors de doute, c’est la fortune rapide de la cité dans la seconde moitié du moyen âge.
Crest s’appela longtemps Crest-Arnaud ou le Crest-Arnaud. Même, l’infidélité au souvenir de ses premiers seigneurs ne date guère que de la fin du XVIe siècle. Plus constantes, Montélimar (Montilium Adhemari) (3) et nombre d’autres localités ont reculé devant l’amputation.
L’obscurité règne sur ces Arnaud. Un les veut roturiers, un autre alliés aux anciens comtes de Diois. D’ailleurs dès 1145, ils abandonnent la suzeraineté de Crest, moyennant 1200 sols et le pardon de leurs fautes, entre les mains des évêques de Die. Prudence crestoise. Peut-être, on leur eût pris le gâteau sans autre compensation pour leur fortune et pour leur conscience.
Sorte de petit Etat indivis entre les évêques et les Poitiers, — l’enclume comtale et le marteau épiscopal — Crest devait être un perpétuel objet de querelle. Egales et furibondes, les deux ambitions ne pouvaient longtemps, sans se mordre, palpiter sous même toit, et on aime à se représenter les Arnaud, dépossédés mais philosophes, nombrant les coups. Ce n’est qu’en 1356 que les comtes de Valentinois finirent par être seuls maîtres de la place, moyennant la cession de leurs droits sur Bezaudun, terre âpre et pauvre. La possession de Crest constituait pour eux un si grand, un si évident triomphe, que l’évêque Pierre de Chatelus, la mitre basse, eut toute sa vie dans les oreilles ce dicton, issu de la gloriole locale :
« Fallait avoir le sens perdu
Qui laissa Crest pour Bezaudu. »
La cité des Arnaud devenue leur capitale, les comtes y étayèrent aussitôt leur pouvoir de cette forteresse, dont le donjon seul debout aujourd’hui, symbolise si orgueilleusement leur pensée volontaire. Ils avaient lutté près de deux cents ans pour arriver à ce résultat, deux siècles d’histoire touffue, bourrés de combats, de conquêtes, de revers, de trêves, de traités, d’artifices diplomatiques. Ces Poitiers, qui ne tiennent pas en place, qui montrent des dents carnivores et haussent parfois jusqu’à l’épique leurs tailles avantageuses, savent être bons et généreux quand il le faut. On les voit accorder à leurs vassaux une charte d’affranchissement qui est, si je ne me trompe, la plus vénérable de la province (4). Un moment hérétiques avec les Albigeois et assiégés à ce titre dans Crest par Simon de Montfort, ils rentrent ensuite dans le giron de l’Eglise et sèment autour d’eux les fondations pieuses. Après cela on comprend leur amour pour cette ville au beau visage ensorceleur comme celui d’une dame de pensée. Là, ils battaient monnaie, là ils avaient leur cour majeure de justice — transformée depuis par l’ombrageux Dauphin (Louis XI) en vi-sénéchaussée forte de cinquante six paroisses, là surtout, depuis 1225, ils avaient leur sépulture chez leurs bons amis les Cordeliers, comblés par eux de toutes sortes de faveurs.
De leur côté, » n’ayant que les comtes en teste » les prélats avaient essayé de se rendre également populaires parmi les Crestois. Amédée de Roussillon, ce pontife auguste et hirsute que ses biographes comparent à saint Maur sortant du désert, fondait ici en 1276 un chapitre ou collégiale, composé de chanoines pris mi-partie dans les diocèses de Die et de Valence. Mais les chanoines ne furent pas toujours selon le cœur des évêques. En 1467, l’institution, purement nominale, ne répondait plus suivant l’expression du Prévôt, à la grandeur et à la beauté de la paroisse. Louis de Poitiers intervint une première fois, d’accord avec l’évêque, pour la restauration de la collégiale. Mais deux siècles plus tard la discipline s’était relâchée.
« Lous chonoineis, que d’ordinaire
Soun plus gras que lou nécessaire «
comme le chante cette mauvaise langue de Boissier, avaient pour cette raison ou pour d’autres, besoin d’une réforme. Séraphin de Pajot de Plouy (5) leur imposa des statuts et règlements qui ont subsisté jusqu’à la Révolution. A cette époque le chapitre de St-Sauveur est encore composé d’un doyen, d’un chantre et de sept chanoines.

Crest n’a pas joué de rôle prépondérant dans les événements de la Réforme. La ville connut sans doute l’occupation huguenote, les tribulations anarchiques, la sauvagerie des sièges de l’époque, aussi funestes aux assaillants qu’aux défenseurs. Mais Die, travaillée de bonne heure par Farel et quelques-uns des plus fougueux apôtres de la foi nouvelle, était, on le conçoit, l’espoir du parti, la capitale rêvée peut-être par la dictature théocratique des pasteurs. Comme le remarque M. J. Brun-Durand — le savant de Crest — pour qualifier en passant sa mentalité féconde, on connaît assez mal l’histoire sociale du protestantisme dans notre province. Tentés par la peinture facile des guerres de religion, des dragonnades, du sang et du feu, la plupart des écrivains spéciaux ont négligé les faits considérables qui agitent la société protestante sous Henri IV et sous Louis XIII, et ils nous servent la sempiternelle histoire-bataille, ce plat réchauffe et insipide. Franchement, nos appétits en ont soupe. Après l’apparition de l’édit de Nantes, la cause de la Réforme n’étant plus en péril, les passions se font jour. La noblesse, qui a été à la peine veut être à l’honneur et c’est dans cet esprit qu’elle prétend exclusivement à la conduite des affaires convoitées de même par les synodes aux tendances rigoristes et genevoises. Et chacun de tirer la couverture à soi. Il faut la forte main de Lesdiguières pour faire cesser le scandale.
Comparativement, ce petit peuple crestois fut heureux. Je veux dire qu’il n’eut jamais trop à souffrir, même dans ses plus lointaines racines. Rien n’est instructif à cet égard comme la charte de 1425. Ses quarante-six articles, en même temps qu’ils constituent une sorte de code des codes, et redorent le bel âge du vieux droit, nous soulagent de bien des préjugés. A les parcourir on a l’illusion de se mêler à la foule naïve du Crest-Arnaud, de vivre sa vie de tous les jours. Sans doute cet habitant du xve siècle descend environné encore de mystère dans le demi-jour de notre pensée recueillie, mais il a tournure libre, mais il est homme, et s’il émeut notre pitié lointaine, c’est surtout à cause de ces fatalités rugissantes : invasion, peste ou famine, qui alors dominent le monde et courbent les nations comme la tempête un champ de blé. Tout est déconcertant dans ce moyen âge pour nos idées modernes de pénétration, d’assimilation, d’unification économique et de concorde universelle. Souvent, la communauté la plus indépendante, la moins foulée, palpite dans l’organisme le plus étroit, le plus cuirassé contre l’extérieur et c’est à travers le particularisme et le protectionnisme que filtrent les conditions de la vie les plus acceptables. De fait, par un de ces paradoxes, dont l’histoire sociale n’est pas chiche, le bien-être crestois, ira diminuant, ce semble, de la Renaissance à la Révolution, c’est-à-dire en raison inverse du mélange et de la diffusion des races, de la marche des idées humanitaires.
Outre ses libertés et ses franchises précieuses, l’ancêtre crestois peut « sans empeschement d’aulcune personne, chasser cerfs, ours, sangliers, renards et autres bestes sauvages, pescher en la rivière de Drôme et autres rivières du territoire, de jour et de nuit, en payant seulement au seigneur, des grosses bestes : la teste du sanglier, l’espaule du cerf et la patte de l’ours. » Quels temps nouveaux restitueront ces passe-temps ?
Deux consuls sont à la tête de la cité érigée en commune. Ils se montrent si pleins de leurs devoirs, si désintéressés de soi et si ambitieux pour leur ville, qu’un jour le Crest enthousiaste les saluera du beau nom de Pères de la Patrie. Ils sont assistés de personnages choisis parmi le clergé, la noblesse, la magistrature et le peuple. L’ensemble forme le conseil, élu chaque année, et qui travaille dans la Maison de la Confrérie, titre aussi honorable et aussi significatif que celui d’Hôtel-de-Ville. Le Comte ne gêne guère ses délibérations, car, au moindre mécontentement l’évêque pourrait surgir. La crainte de l’améthyste est le commencement de la sagesse. Et la petite république, parmi le moyen-âge qui crépite et qui fume, traverse ainsi des époques de repos et de douceur. Non contents de donner aux écoles — la petite ou l’on enseigne « l’arfabet » et la grande où l’on enseigne à peu près tout, y compris la « didactique » — des recteurs et des maîtres de leur choix, les consuls ne s’avisent-ils pas d’établir jusqu’à l’horaire des classes ? Rien n’échappe à leur puérile et touchante sollicitude.
Le Conseil, déjà bien timide sous le grand Roi, ne comprenait plus au XVIIIe siècle qu’un maire, deux échevins et douze membres choisis parmi les notables.
(1) Cette commission qui siégea du 19 au 29 mai 1790, avait été réunie à Chabeuil, chef-lieu de canton de l’arrondissement de Valence, et cela dans le but de ne pas augmenter les chances de l’ancienne capitale du Valentinois.
(2) Deux minuscules affluents de droite de la Drôme. La Saleine en amont de Crest, la Lozière en aval.
(3) Monticule ou colline d’Adhémar
(4) Elle date de 1188
(5) Évêque de Die dans la seconde moitié du xvne siècle.
Il y a un esprit crestois comme il y a des mœurs et presque une cuisine crestoises. N’est-ce pas joli et piquant pour une aussi petite ville ? Mais nombre de vieilles cités causent de ces surprises à travers leur résignation et leur silence. Précisément, Crest, par sa manière d’être et de sentir, forme ce tout complet qu’agrémentent et illustrent pour l’observateur, les façons originales d’une race.
Donc, voyons un peu les hommes, après avoir effleuré les choses.
Quelle audace et quelle prescience chez ce Nicolas Barnaud, né ici vers 1530 et qui se met à courir l’Europe — le monde presque — autant par folie aventureuse que par crainte de brûlement! Médecin, il cherche la pierre philosophale. Cela fait rire aujourd’hui comme si notre science était définitive, comme si nous étions sûrs qu’on ne rira pas de nous demain. Mais l’alchimie est l’aïeule de notre chimie, aïeule vénérable et point tant radoteuse qu’on se l’imagine. Elle fut la première étincelle de la recherche : ce feu sacré qui brûle derrière tout front savant, et le grand œuvre, comme les travaux d’Hercule, a son sens merveilleux. Alchimistes, astrologues, sorciers même, tous disciples lointains et peut-être inconscients des initiés de Memphis et des collèges hiératiques de l’Orient, préparent dans leurs nuits mystérieuses, les miracles de la Microbiologie et les enchantements sidéraux de l’électricité. — Il faut leur en avoir de la reconnaissance.
Athée, auteur » d’un livre abominable dont le titre seul fait dresser les cheveux sur la tête « , » membre pourri » dont les synodes dauphinois demandent le » retranchement « , son temps n’a ménagé à Barnaud ni les accusations, ni les injures. Cela prouve seulement que notre philosophe, aussi loin de Genève que de Rome, planait de toute la hauteur de son indépendance, au-dessus de l’âme méchante des partis. Et c’est bien à cet esprit aux conceptions sans bornes, à cette âme égalitaire, que Socin, un des plus fiers et des plus purs révoltés du siècle, entendait rendre hommage en lui dédiant en 1595 une de ses œuvres.
Notre époque, trop dédaigneuse de la vieille science hermétique, eût sans doute complètement oublié Barnaud sans deux ouvrages qu’on lui attribue et où sa sagesse prophétique a pressenti nos destins et les formes sociales du pouvoir actuel. Rien n’égale la tranquille audace de l’auteur, qu’il traite de questions économiques ou politiques. Le roi, dit-il, est seulement premier et souverain serviteur du royaume qui n’a pour maître et seigneur que le peuple. Il faut vendre les biens du clergé, marier les prêtres, fondre les cloches. Et ce ne sont là que ses moindres vœux, car il demande encore l’accessibilité de tous aux emplois publics, l’impôt sur le revenu, le service militaire obligatoire… Que diront de plus les hommes de la Révolution ?
Selon les uns, Barnaud serait venu mourir en Dauphiné ; selon les autres, il aurait terminé en Espagne son inquiète et fiévreuse existence, entre 1600 et 1612.
Il faudrait, pour rendre ses véritables traits à cette curieuse figure, s’aider du XVIe siècle tout entier. Contentons nous de dire que sur ce vaste champ de bataille de la pensée, Barnaud s’est montré champion intrépide, frappant d’estoc et de taille.
Toutes les célébrités crestoises ne sont pas, il s’en faut, aussi imprévues, aussi originales. Mais la capitale des Poitiers a le bonheur rare d’avoir produit dans tous les genres. Jugez-en. — Au XVe siècle, Jean Rabot, né vers 1444, un des plus savants magistrats de son temps et que Louis XI, Charles VIII et Louis XII chargent de missions importantes. — Au XVIe et au XVIIe, les deux Allian [Pierre et François), l’un jurisconsulte » d’une capacité bien cogneue « , l’autre supérieur des Missions Etrangères et traducteur du Catalogue des saints de Lyon; Gaspard Rolland, secrétaire de Jean de Monluc, sorte d’Eminence grise du brillant homme d’Etat, et qui reçoit en récompense de ses services le titre recherché d’abbé de St-Ruf ; Jean Dragon, humaniste et pasteur, appelé quelquefois évêque de l’Eglise de Crest ; Pierre Arnoux, prieur de Plan-de-Baix et poète latin; Gaspard Benoit, avocat et docteur en droit, auteur d’une Déclaration contenant les justes causes de sa conversion à la foi catholique ; Michel Aubert, autre huguenot converti au catholicisme, régent à l’Université de Valence et agent des trois ordres du Dauphiné près la personne du roi ; Jacques Vincent, auteur de plusieurs traductions, et Jean Vincent, avocat au Parlement de Grenoble, ardent défenseur du tiers dans le procès des tailles; Bovet d’Arier, un des meilleurs élèves de Cujas, anobli en 1606 par Henri IV pour son courage et sa fidélité; le chanoine Guillaume Charency, auteur de « la Clef du sens littéral et moral de quelques psaumes de David »; Antoine de Pluvinel, l’un des plus fameux écuyers de l’Europe et le créateur des manèges en France ; Antoine Garcin ou Guercin, traducteur de Boccace et romancier à l’instar de l’Arioste; le médecin Guy de Passis, d’une famille florentine alliée, dit-on, aux Médicis, qui entrevoit la gloire de Vals et de Vichy dans l’eau merveilleuse de Bourdeaux en Dauphiné; j’ai gardé pour la bonne bouche ce drolatique David Rigaud, poète-drapier, parti de Crupies, son village natal, la balle sur le dos, ce qui ne l’empêche pas de faire son chemin, tout au contraire. Etabli à Crest, il y fait fortune. L’heureux homme et le gai philosophe ! Des gentilshommes l’admirent et lui donnent de l’ami, en échange peut-être — comme le note finement M. Brun-Durand — de marchandises prises à son comptoir et qu’ils oublient de payer, mais cela même sert sa réputation de drapier et de poète.
Le XVIIIe siècle semble quelque peu fatigué du grec et du latin, de l’âpre et longue dispute théologique. Il est à la fois moins subtil et plus pratique. A côté des avocats, professeurs et administrateurs, toujours en assez grand nombre : les deux Sibeud (Jean-Louis) et (Lucretius) ; Brohard (Claude-François) ; Dumont (Gabriel) et La Bretonnière (Philippe-Esprit de), c’est une satisfaction d’y voir des agronomes tels que Buffel du Vaure (Antoine), Faure-Biguet (Jean-Pierre), Rigaud de L’Isle (Michel-Martin) et Rigaud (Louis-Michel), deux descendants du poète-drapier. Il y a place aussi pour des personnages politiques : Daly (Pierre-Laurent), ancien fabricant de mouchoirs, de reps et de nanquinets ; Curnier (Jean-Charles-Antoine), commissaire du Directoire à Valence, et Gailhard (Marie-Charles-Antoine de), tour à tour représentant du peuple et fonctionnaire administratif, plus tard anobli par les Bourbons qui blasonnent ce Drômois : d’azur au dromadaire effaré d’or — armes parlantes s’il en fut. Un économiste aura l’idée des caisses de retraite pour la vieillesse et des premières assurances sur la vie, c’est Joachim Lafarge, mort en 1839. Des généraux, La Tour-du-Pin Montaubau, marquis de Soyans, Berlier et l’émule de Hoche, le brave Digonnet, soutiendront l’honneur des armées françaises.
Mais c’est surtout au XIXe siècle que l’âme crestoise se dilate, qu’elle nous dévoile avec des poètes qui ont su rester de leur pays, ses grâces naturelles, les coins fleuris de son intimité. J’ai pour cette renaissance locale une faiblesse de cœur, car elle est bonne matière à décentralisation et elle fortifie la liaison nécessaire entre les êtres et les choses de commune origine. Aussi je me contente d’énumérer les noms qui suivent, tout à fait en dehors d’elle : Dourille (Joseph), journaliste et historien ; les frères Dumont (Louis-Victor- Adrien) et (Aristide), l’un magistrat érudit, l’autre habile ingénieur ; Duseigneur (Edouard), dit Duseigneur-Kléber, qui a laissé une savante monographie du cocon et de nombreuses études sur la sériciculture; Claire de Chandeneux, pseudonyme d’Emma Bérenger, femme de lettres remarquable par la fantaisie et la sensibilité de ses dons, le délicat conteur aux fins morales du » Paris-Charmant » et du » Paris-Littéraire « ; le mathématicien Bouchet, du Bureau des Longitudes; le général du génie Bovet, ancien gouverneur de Belfort, et plus près de nous : M. Gustave Latune, bibliophile éclairé, Mme Nanny Adam, dont le pinceau tendre sait si bien s’approprier les couleurs languides et comme évanouies des crépuscules, M. Auguste Frizon, sculpteur, à qui Valence est redevable du génie de sa fontaine monumentale. Et je regagne en hâte les bords de la Drôme où, sous le regard complaisant et qui sait ? mystérieusement complice de la tour, germa et mûrit une littérature dont bientôt, dans les environs, chacun voulut avoir de la graine.
Il était temps. Le patois — car c’est du patois qu’il s’agit — n’en pouvait plus. Aussi, que de heurts, que d’assauts, que d’aventures sur le chemin du passé, ce chemin où l’histoire bronche à chaque pas contre des ruines ou des cadavres ! Jadis, les barbares, les révolutions, le latin — langue universelle. De nos jours, l’école, la caserne, le chemin de fer, la mode, la bêtise, géante qui ne connaît pas sa force, quand elle a fait ses classes. Montré au doigt, réduit à courir la montagne, ou bien à se galvauder dans la misère des quartiers louches, dans la fréquentation des pas-dengus (1), il roulait de pente en pente à l’égout argotique, menaçait de devenir le charme de la canaille, et ceux-là peut-être lui en voulaient le plus qui, feignant la tolérance, l’admettaient à leur table pour représenter la farce grasse ou la gaudriole salée. Juste à ce moment, des hommes, pour la plupart sortis du peuple, eurent pitié du vagabond, et de leurs bonnes, de leurs rudes mains de travail, lui préparèrent sa chambre au vieux logis du gai savoir. Un revirement s’est fait. Le patois a un domicile comme tout le monde et il arrive même que des dames à chapeau — alarmées naguère de ses allures et de son verbe haut — de loin, lui disent bonjour.
A Die, ce parler, chargé de substantifs en ec, a l’air bretonnant ; à Crest, il les a laissé choir dans la Drôme, mais il gronde encore, assourdi de tous les o qu’on a pu mettre à la place des a et partout, il roule des cailloux de ses torrents. Tel quel, il est souple pourtant, tout en images et parfois il rend des ondes mystérieuses et douces comme en ont le soir les cloches de campagne touchées par l’angélus…
Considérons dans son ensemble l’œuvre poétique des patoisants — le cycle drômois. Elle est saine et vigoureuse et rappelle par certains côtés la terre natale : sol difficile, mais où les noyers, hauts comme des temples, bombent par delà vignes et vergers leurs dômes majestueux, où dans les hermes, les frigolettes et les aspics, pâmés sous le soleil, exhalent leur âme excessive. Elle a des largeurs de vallée sur lesquelles passe en rafales la bise pénétrante et vive, de beaux pans de ciel où, à l’occasion se mutinent les nuées. Et les prairies aussi ne lui manquent pas, laculets de repos et de fraîcheur où l’on peut cueillir à brassées les fleurettes qui parlent d’amour : boutons d’or et marguerites.
Il y a là pour le moins deux douzaines de poètes ou chansonniers qui, s’ils ne sont pas tous de Crest ou de ses environs immédiats, regardent cette petite ville comme un foyer traditionnel de maintenance. Crest semble, en effet, avoir rayonné bien au-delà de son horizon, sur des terres d’où l’on tenterait vainement de l’apercevoir, et déterminé de la sorte, en faveur de la cause provinciale, bien des jeunes enthousiasmes, cela sans asservissement des personnalités.
Aucun de ces poètes, je pense, n’a voulu faire tort à la langue française. Comme le dit l’un deux : » est-ce une raison parce que nous avons deux yeux pour nous crever l’un ? Qu’au moins le patois nous soit un lien de race, ses contes et ses chansons un délassement d’esprit, en même temps qu’une raison d’aimer le terroir dauphinois. Qu’il ait place au feu et à la table, et nous nous tiendrons pour satisfaits. » Aucun, non plus, n’a voulu étonner, n’a cherché à faire de la science, pas même le vénérable abbé Moutier, curé d’Etoile, chez qui pourtant le poète se double d’un philologue accompli. La surprise ne fut pas mince quand on vit un beau matin, fixés sur le papier — comme du français — ces mots avec leurs pièces et avec leurs trous, que beaucoup avaient pris jusque-là pour des bohémiens ou des parasites. — Le patois, ça s’écrivait donc ! — Ainsi, des gens parlaient une langue sans le savoir, comme M. Jourdain.
A l’heure présente, on s’occupe avec une certaine passion des » théâtres populaires. » De généreux esprits, en réaction ouverte contre le mauvais goût et la niaiserie de la plupart des spectacles offerts à la foule, calomniée, jugée indigne, se font gloire d’aller au peuple et prétendent tirer de ses intimités profondes de quoi rénover ses mœurs, de quoi alléger sa peine par l’attrait d’une joie nouvelle. C’est ainsi que sont nés, à l’exemple des nombreux » Wolksthéater » de la rêveuse Allemagne où les paysans jouent surtout des mystères, les théâtres de Plonjean, en Bretagne, de la Motte St-Héray, en Poitou, et dans les agrestes Vosges, ceux de Ménil en Xaintois, de Gérardmer et surtout celui de Bussang, qui vient de rendre célèbre le nom de Maurice Pottecher. Mais l’idée ne date pas précisément d’hier et le crestois Roch Grivel la mettait en pratique voici bien près de cinquante ans. C’est, en effet, le 6 avril 1856, qu’il fit représenter pour la première fois sur le théâtre de sa ville natale : « Suzetto Trincolier », comédie en un acte et en vers. Tout de suite la foule fut prise, charmée et naturellement voulut davantage. Alors, il donna en 1857 : « Un moussu souquè fa » (un parvenu), qui offre quelques traits de ressemblance avec le Bourgeois gentilhomme ; en 1858 : « Lou réetour dé lo Colifournie », dont la commune prend à sa charge les frais d’impression ; enfin, en 1863 : « Lou Sourcier de Vaunaveys », qui s’attaque aux mystérieuses puissances des jeteurs de sorts, et à la crédulité du peuple des campagnes. Mais, il semble que « Lo Carcovelado », dont le titre rappelle un quartier lépreux du vieux Crest, ait fourni sa meilleure matière à cet instituteur d’art et d’idéal populaires. C’est un poème en deux chants où l’esprit et la gaieté débordent en des scènes surprenantes, en des histoires capables de faire oublier le boire et le manger. Enfant trouvé, né en 1816, Roch Grivel, dit M. Victor Colomb (2), n’avait reçu qu’une instruction élémentaire, mais grâce à un travail incessant et à des efforts inouïs, il était parvenu à connaître et à apprécier non seulement les poètes grecs et latins, mais encore les poètes étrangers, tels Dante, Milton, Shakespeare. Grivel était ouvrier tisserand et maniait aussi bien la navette que la plume ce qui n’est pas peu dire. Un monument a été élevé dans le cimetière communal par ses compatriotes à ce génie modeste et heureux.
Laurent Mognat (1829-1883), lui, n’a pas fait de théâtre et ainsi s’explique l’insignifiance de son action sur la foule qu’il n’a point pénétrée. Il a ses dévots pourtant qui le déclarent supérieur à Grivel pour le maniement de la langue, l’abondance et la vivacité des images. Son bagage patois — car il a laissé aussi un certain nombre de chants, d’à-propos, de romances en français — consiste principalement en contes et en fables, en couplets de circonstance, en petites pièces satiriques.
A côté de ces précurseurs, rangeons sous le vert platane de la poésie des champs : — Joseph Grivel, cousin de Roch, né le 16 novembre 18 16, et mort à Paris, dont les trop courts « Leisis Pouetiqueis », font regretter le nonchaloir de sa muse. L’excellent homme était ouvrier tailleur ; — Léopold Bouvat, artisan comme lui et qui n’avait pas son pareil pour ciseler un sonnet ; — Frédéric Jobert, mort à Montélimar où il était secrétaire en chef de la mairie, ce qui n’empêchait pas ses rêves mélancoliques et doux d’habiter les bords de la Drôme ; — L’abbé Blanc, auteur d’une alerte comédie en vers, « Lou mestre d’escolo ».
En 1885, paraît L’Armagna Doufinen. C’est, un moment, le tambour public des dauphinois, de nos félibres, inquiets non sans raison, d’entendre toujours parler du Languedoc, de la Provence, de l’Aquitaine. Jusque-là, il faut bien le dire, le félibrige dauphinois, avec ses individualités brillantes, certes, mais sans lien entre elles, sans commun souci d’avenir, n’a fait que courir la prétentaine. L’Armagna Doufinen bat le rappel. Il connaît sa foule, il sait comment et en quels carrefours on l’attire et on l’amasse, ce qui l’amuse et la part de vérité qu’on peut lui faire entendre. Et pour la première fois le pays bouge. D’ailleurs il n’est plus question de Crest seulement et les parlers de Livron, de Loriol, de Chabrillan, de Dieulefit, de Puygiron, voire de Mens en Trièves, viennent se ranger sous la même bannière. C’est le beau temps d’impatience et d’enthousiasme ou l’ abbé Moutier, Ernest Challamel, Morice Viel, Maurice Champavier, Gatien Almoric, d’autres encore, cueillent des palmes dans les concours et rêvent d’instaurer la renaissance littéraire partout ou fleurit le symbole du dauphin aurore et azur. Depuis, ah ! depuis… chacun a suivi sa chimère, et le bon almanach n’est plus, mais non pas le félibrige, comme vous l’allez voir.
Pour arriver à l’épanouissement complet de notre littérature dialectale, disait, en 1885, l’ abbé Moutier, il nous manque ces trois choses : un dictionnaire, une grammaire et une épopée. Un jour viendra, ajoutait-il, où nous posséderons ces trois œuvres de maître. Et le malicieux et vaillant cabiscol avait l’air d’attendre sous l’orme cette triple éclosion. Or, la grammaire et l’épopée parurent, mais elles étaient de lui, et voici qu’il prépare le dictionnaire ! Entre temps, et pour ne rien avoir à envier aux Catalans et aux Provençaux, il composait un chant de « la Coupe », la marseillaise du félibrige dauphinois.

Almoric, reprenant à son compte les idées de Grivel, fait du théâtre, et il puise tout bonnement comme ce dernier dans l’intarissable fonds populaire. Seulement, à la différence de Grivel, son théâtre tout rustique, se passe des artifices de la scène, et se trouve ainsi beaucoup plus près du peuple dont il a en vue l’éducation morale. Un dimanche, un jour de fête, soudain un tambour bat dans un village. C’est la Joyeuse troupe félibréenne des rives de Granette (3) qui s’annonce, qui va donner en plein air, avec des arbres pour de vrai sur la scène, un spectacle, une pièce de son répertoire, Les acteurs, des paysans, sont gens qui sentent ce qu’il disent et quelques-uns d’entre eux, hommes de rêve en même temps que de labeur terrestre, ont, comme cet Almoric — au nom d’une joliesse chimérique, n’est-ce pas — une réelle influence sociale. Il ont notamment développé, avec le concours d’un gentilhomme de haute valeur, qui ne craint pas d’afficher sa liaison avec la terre. M. de Gailhard-Bancel, le système des syndicats agricoles, si bien que le relèvement du sol et le relèvement des individus s’opère dans le même temps par des voies parallèles.
Ces courtes observations sur le mouvement littéraire dialectal m’amènent à rappeler pour finir les noms de deux crestois. Si M. J. Brun-Durand n’a rien écrit, que je sache, en langage vulgaire, et si Maurice Champavier n’a donné qu’un petit nombre de pièces patoises, ces deux écrivains n’en ont pas moins servi la cause provinciale aussi utilement que le plus obstiné mainteneur. Qui ne sait que M. Brun-Durand est un savant hors de pair, dont les ouvrages embrassent les connaissances les plus étendues et les plus variées ? A eux seuls ses dictionnaires topographique et biographique de la Drôme — deux monuments — rempliraient l’existence d’un bénédictin. Et comment les Dauphinois ne seraient-ils pas reconnaissants à Maurice Champavier d’avoir fréquenté dans ses contes, ses chroniques, ses rêveries, à peu près le même domaine, son Dauphiné ? Personne n’a mieux peint les gens de cette terre rude et magnifique, n’a mieux saisi le sens intime, la poésie des choses de la montagne. C’est tout à la fois un curieux et un poète, un vrai curieux et un vrai poète.
(1) Homme de rien dans le parler du pays.
(2) Les poètes patois du Dauphiné. — Roch Grivel.
(3) C’est le nom d’une rivière affluent de la Drôme et qui arrose Grane
Crest — « la plassa forte et imprenable » de la chronique albigeoise — était une des dix villes du Dauphiné dont les consuls siégeaient à la tête des députés du tiers-état dans les Etats-Généraux de cette province. C’était aussi le chef-lieu d’une subdélégation(1) de l’élection de Montélimar, comprenant 106 paroisses ou communautés, et comme nous l’avons vu, le siège d’une vi-sénéchaussée, depuis la suppression, en 1447, de l’ancienne cour majeure des Comtes de Valentinois et de Diois. C’était, en outre, le siège d’un gouvernement militaire dit de Crest-Ville et Tour, avec trois officiers spéciaux : un gouverneur, un commandant et un major. Chef-lieu d’un district ou arrondissement en 1790, la réorganisation de l’an VIII, pour ne pas trop l’humilier, l’a mis à la tête de deux cantons : Crest-Nord et Crest-Sud à qui trente communes obéissent. Crest-Nord, c’est la cité, sur la rive droite de la Drôme. De l’autre côté de l’eau, c’est le champ de foire, c’est un lent faubourg qui a toute la campagne à soi et ne se gêne nullement pour y prendre ses aises. Dans la verdure environnante, des villas curieuses et blanches regardent au travers de leurs grilles ce qui se passe sur la route, tandis qu’à l’écart, quelques demi-châteaux boudent à cette agglomération, et n’ont de politesses que pour la tour installée dans le paysage en maîtresse éternelle.
Pénétrons sans crainte comme sans hâte dans la ville dont nous venons, en manière d’hommage, d’énumérer les titres et qualités, Ses rues comprimées alignent encore assez de logis séniles, ouvrent assez de perspectives archaïques pour fournir au flâneur l’occasion d’y perdre plusieurs heures. Mais si l’on veut avoir l’idée rapide et complète de la ville, la vision d’un peuple dans son organisme d’autrefois, c’est à la tour qu’il faut tout d’abord songer. Un chemin y monte, par endroits, silencieux et claustral, tout au long pittoresque et roide. On franchit une porte en pierres rousses et qu’on dirait chaudes encore d’un incendie, et tout à coup, au delà d’un jardinet que j’ai vu plein de soucis et d’anémones, le donjon se dresse nu, carré, formidable. Sa beauté, c’est sa puissance, sa couleur, l’attitude grandiose qu’il a imposée pour toujours au groupe qu’il commande. Richelieu démolit en 1632 la citadelle et les remparts, et depuis, les maçons n’ont cessé de tailler à travers les vieux quartiers. N’importe, Crest ne peut changer sa physionomie, et son langage historique persiste comme son parler gavot. Comment ne pas s’intéresser à ces murailles qui étonnaient les anciens eux-mêmes ? Aymar du Rivail, familiarisé pourtant avec ces décors héroïques dans lesquels s’écoulait la vie à son époque, s’écrie devant notre ville : » Ce château l’emporte sur tous ceux que nous ayons jamais vu. » Demeure des Comtes, atelier monétaire, prison du roi qui s’en servait au XVIIe et au XVIIIe siècle comme d’une vulgaire Bastille, maison de correction, caserne, geôle militaire, prison où furent un instant renfermés en 1851 plus de trois cents hommes pour leur résistance au Coup d’Etat, la tour de Crest à dû peut-être à toutes ces vicissitudes de maintenir jusqu’à nous ses masses essentielles. Un immense escalier de bois auquel on donne plusieurs siècles, mène à ses différents étages. Du haut balcon qui couronne le faîte, ayant à ses pieds la plaine de la Drôme, en amont ses détours, en aval ses délires parmi des sables réverbérants, ses villages hauts perchés, semblables à des fauves à l’affût, ici près la ville entière précipitée en casse-cou jusqu’à la Drôme et que la chose a l’air d’amuser, toute une indolence qui s’accoude à la roche et qui se chauffe au soleil, la conque de la vallée emplie jusqu’aux bords, jusqu’aux arabesques mauves des collines, à l’horizon, par une atmosphère heureuse, le voyageur jubile dans ses yeux et dans son cœur, ce pendant que lui monte aux narines, avec l’odeur des cyprès, comme un vague et lointain arôme de force et de domination.
La grande rue — la grande route comme toujours — parallèle à la rivière, se ressent du rocher qui l’opprime. Elle en suit de si près la base que la ville haute avec ses ruelles, ses placettes, ses raidillons, ses impasses, littéralement s’y précipite et y tombe. Elle fait voir un escalier plein d’ombre ou plein de soleil suivant les heures, et qui semble l’illustration même de quelque conte de l’Orient halluciné. Aux beaux jours de leur grandeur, les Cordeliers en montaient ou en descendaient les cent trente quatre marches taillées dans le roc. Cette rampe, qui résonne aujourd’hui des pas plus doux des religieuses trinitaires, accédait il y a quatre ou cinq siècles, sous le nom de Degrés de Notre-Dame de Consolation, à une église que M. Brun-Durand considère comme la paroisse primitive.
La grande rue renferme toute la vie de Crest : hôtels, cafés, boutiques. Elle est assez étroite pour paraître animée, et si des remaniements fâcheux lui ont fait perdre sa physionomie ancienne, il lui reste, outre le fameux escalier, deux ou trois visages de bonnes vieilles maisons pour sourire au passant de toutes leurs rides. La même rue montre aussi l’hôtel de ville et l’église qui, de laideur pareille, ne se font l’un à l’autre aucun tort. Toutefois, on conserve à l’hôtel de ville quelques débris de valeur. Que l’on en découvre encore un certain nombre et l’on aura un de ces petits musées si propres à inspirer aux foules le respect des vieilles pierres. Il y a là le très précieux marbre de la charte des franchises de 1188, des sculptures du XVe et du XVIe siècle, les armoiries de la ville portant la date de 1530, et détachées d’une ancienne bâtisse, à l’angle de la rue de Rochefort et de la place des Ecoles, et il convient de mentionner surtout une superbe vue cavalière de la citadelle et du château, sculptée sur bois, qui ornait le tympan du portail de l’ancienne église.
La rue des Cuirateries présente une façade sculptée et une porte vermiculée qui ont du style.
J’ai dit le caractère capricant de la haute ville. Elle intéresse par son abandon et parce qu’elle tourne au pathétique d’une nécropole. Elle offre quelques vieilles maisons de grand air, où l’on sent l’aise, où persistent des habitudes abolies. Rustique et familiale est la fontaine de Saboury dont l’eau passe pour valoir du petit vin, mais le mot ne serait-il pas une invention de commères voulant se donner une raison d’être sobres et d’épargner?
Il n’y a pas de halle à Crest et c’est plaisir que de flâner certains jours sur la place où s’entassent dans le plus joli désordre, avec leurs grâces particulières, leurs couleurs or, leurs couleurs sang, leurs couleurs vertes, les beaux légumes de la vallée de la Drôme. Comme dans beaucoup d’endroits du Dauphiné, les Crestois enchantent parleur esprit effervescent, leurs manières rondes, le souci qu’ils mettent à bien traiter l’hôte que le ciel leur envoie. Chez eux, il faut craindre de trop boire et de trop manger. Ils ont leurs mets, leurs pâtisseries : les couves, les fouyasses, la défarde.
Sont-ce tripes à la mode de Die ou à la mode de Crest, cette défarde, « lo deifardo » que chante Gustave Bermond, un poète patois ? Grave débat. On en mange d’excellente à Crest, on en mange d’excellente à Die, mais Aouste prétend avoir le record. Tant mieux pour la patrie de Martial Moulin. Mais n’ai-je pas dit qu’ Aouste est un faubourg de Crest ?

une inscription publicitaire sur « les défardes aoustoises »
La capitale des Poitiers est fort active. Elle n’est pas comme Die dans l’ankylose de ses souvenirs. Dans ses fabriques de coutils crestois (vieille renommée), de couvertures de laine, de draps et molletons, de chaises, de ciment, de tuiles et de briques, elle occupe un nombre d’ouvriers relativement considérable. On y trouve aussi trois moulinages ou filatures de soie, un atelier de constructions mécaniques, une fabrique de conserves de pâtés de foie, auxquels les truffes excellentes des environs prêtent leur arôme. Mais certainement, l’industrie la plus curieuse est la fabrique de gobilles. Avant 1870, Nancy était la seule ville de France fabricant les mignonnes boules, si chères à nos jeux d’enfant. Un jour, le comptable d’un des établissements de ce genre, vint à Crest voir un ami, trouva le pays charmant et y fit de nombreuses promenades. Il découvrit de la sorte que le calcaire crestois était éminemment propre à fabriquer des gobilles. Acheter une carrière, s’installer là, fut pour le nancéen, à ce qu’on rapporte, l’affaire de quelques semaines. La carrière et la fabrique sont à Cobonne, village distant de sept kilomètres, sur le torrent de Scie. La gobille prospère également sur la rive gauche de la Drôme et dans les environs de Saou. On l’expédie en fûts, comme le plâtre.
(1) Division de l’organisation administrative avant la Révolution.
X
ENVIRONS DE CREST. — LA FORÊT DE SAOU. — ROCHECOURBE
ET ROCHECOLOMBE.— LE VILLAGE DE SAOU.
La tour de Crest n’arrête plus l’élan des cavaleries héroïques, mais qui douterait de son pouvoir à la considérer du haut de quelque tertre lointain ? Tout chemin par ces terres moutonnantes semble un ruban neuf dévidé par son caprice, et, humble sujette, l’amphi-théâtrale petite cité dessine au-dessous d’elle comme les lignes géométriques d’un socle sur lequel reposerait le monument sang et or.
En signalant Crest, le paysan qui chemine dit : la Tour. Rendons hommage à cette idée simple.

Parmi les curiosités que ces rubans de route attirent et rattachent, en quelque sorte, aux destins de la vieille forteresse, la Forêt de Saou, la plus célèbre, peut se conquérir en un jour. A quelques pas de Crest, à cinq lieues du Rhône, ces montagnes menant leur ronde éperdue, sans intervalle entre elles, sans échappée visible, montrent bien que parfois la nature a ses jeux. — qui sont formidables. Tout de même — et cela n’étonne pas peu — on force ce » rond « , on entre dans la » danse « , on s’insinue dans ce bassin fabuleusement retranché de la vie ambiante, mais par quels passages ! L’un, entaille du nord, dans la direction d’Aouste, c’est le Pas de Lausens; l’autre,fissure méridionale, vers le vénérable village de Saou, c’est le Pertuis de la Forêt ou simplement le Pertuis. Ce dernier, plus pratiqué, est aussi plus sensationnel. La pure Vèbre, eau-enfant, eau de cache-cache comme telle font du Royannais ou du Vercors, défend, en noyant son seuil, la porte de mystère.
Un mémoire de 1772, nous apprend que « l’entrée connue sous le nom de Pertuis est placée à environ 2000 toises de la poupe. » Ainsi nos pères identifiaient volontiers le site avec un vaisseau de haut bord, voguant de l’occident à l’orient. La proue, harmonieuse, façonnée en bravade à l’instar des galères, pointant un triple rostre à quelque 1600 mètres au-dessus des mers. La poupe, abaissée à 888 mètres, moins ouvragée, arrondie, massive, conforme à son objet, suivie du vert sillage des collines. Rochecourbe et Rochecolombe. Treize kilomètres au moins de l’une à l’autre. Trois au plus en largeur. Quatre mille et quelques centaines de toises entre bords, soit deux mille et tant d’hectares de superficie totale. Telle est à grands traits, la forêt de Saou où vint chasser plus d’une fois le futur Louis XI. On la compare aussi à une corbeille, et l’image n’est ni moins réelle, ni moins séduisante. Car, si extérieurement, les roches trop fières, ne présentent que pics et bastions infranchissables, elles perdent ce caractère à l’intérieur, offrent des bois, des jasses, des granges, de douillets alpages où, sans avoir à frémir du lynx ou du loup, fort communs jadis, bœufs, vaches, moutons et chèvres paissent le bonheur. Parfois, un cri rauque sillonne douloureusement le calme immense : c’est l’aigle dérangé à la vue d’un pâtre, ou bien la corneille qui conspue à sa manière le logis rococo enfoui dans les profondeurs de la » corbeille « . Ce château de carton, fardé, grimé, vieillot, trivial, incapable de laisser après soi une seule pierre honorable, fut longtemps un fief de Crémieux, l’hilarant commis-voyageur de la Défense nationale. Il l’avait baptisé la Villa Tibur (1), ce qui prouve à la rigueur ses humanités, et il y reçut un jour Gambetta. Si l’on s’en rapporte à la tradition, le tribun aurait escaladé Rochecourbe après Bonaparte, et souri lui aussi, en » voyant l’Europe à ses pieds « , à des rêves non moins léonins de liberté et de fraternité universelles. Crémieux, situant d’instinct les haltes de sa vie extraordinairement fiévreuse et dispersée entre ces monts étranges, dans cette cuve d’alpe où tout semble en retard sur le temps, ne penchait-il pas vers une sagesse inconnue de la plupart des politiciens ? A. Saou, l’on se souvient du bonhomme ami de tout le monde, — de l’évêque comme du dernier paysan, — brusque, généreux, remplissant à lui seul ce canton grave, et on lui pardonne Tibur pour sa liaison ingénue avec la montagne, pour les ponts qu’il a jetés et les chemins qu’il a ouverts.
Tibur contemple un fougueux assaut de hêtres. On l’appelle Bois-Vert. Sans lui la Forêt de Saou, Hercynie une et compacte encore dans la première moitié du Moyen-Age, et aujourd’hui hermes, pâtures, maquis, touffes de buis, bouquets de chênes, terres pelées et surtout roches vives, serait un non sens. Bois- Vert sauve les apparences. Au-delà, la belle desserte pratiquée par Crémieux à travers les fayards, n’est plus qu’un sentier, raturé bientôt par l’herbe des pacages, mais on aborde Rochecourbe, on met le pied sur la fameuse » proue » sculptée de rostres et armée en guerre.

On dit Rochecourbe(2) ou les Trois-Becs, la Parre, le Signal et le Pré-de-l’Ane désignant individuellement chaque pointe. La Parre (1562 m.) regarde Saillans et vaut le Pélion ; le Pré-de-1’Ane (1592 m.), vers Bourdeaux, égale l’Ossa; entre eux bondit le Signal, à peine moins élancé que ses frères. Mais la légende ne les a point dorés à l’égal des monts grecs d’où coule avec les sources divines la poésie éternelle. Et pourtant, à ce qu’on rapporte, Gargantian (3) fréquentait ces parages, lui qui choisit le Diois pour y empiler pic sur pic et serre sur serre afin de sauter dans le ciel. Un autre souvenir embellit Rochecourbe, virginal comme les mousselines que l’air lui donne à déchirer. C’est celui de Blanche de Lastic, la fille du seigneur de Saou. Elle avait un âne qu’elle préférait, dit-on, à la plus fine, à la plus luisante des haquenées.
Un jour, elle mourut, fauchée dans sa fleur, et l’âne averti par son instinct sûr, s’enfuit au moment où les populations en larmes menaient les funérailles, et traversant bois et rocs avec la rapidité de la flèche, vint s’abattre sans souffle sur la crête la plus haute, en plein éther bleu, tout près de l’âme candide de son amie. Et voilà comment ce nom de Pré-de-1’Ane ou Pas-de-1’Ane, offert depuis des siècles en hommage à la fidélité, dépasse sa signification banale.
Glandas, acropole sereine, est trop empêtrée d’avant-monts et ne se juge pas d’ensemble. Ventoux, magnifiquement isolé, n’est que carrure, La forêt de Saou a l’isolement avec des grâces mouvantes et des traits de femme. A distance, elle est plus qu’aucune autre montagne, souple, exquise, tendrement azurée. Vers Tain, en amont de Valence, on s’éjouit de surprendre à l’horizon ces lignes pures et harmonieuses qui vous accompagneront avec cérémonie vingt lieues durant, passé Donzère, passé Pierrelatte, jusqu’au point où le Rhône dit adieu à la terre dauphinoise, et l’on s’oublie à les poursuivre encore, comme l’ombre d’une amante ou d’une fée, alors qu’elles se sont pour toujours évanouies. Mais l’ascension, très facile, surtout enchante, car Rochecourbe est un » œil « , pour employer l’image orientale, et cet œil qui soupçonne Lyon en des limbes de brume d’où le fleuve soutire tout-à-coup son flot d’argent mat, surveille aussi la horde des monts, va-nu-pieds rués sur le Diois. A perte de vue, serres et rocs, courant à se dépasser, se défient, se heurtent, se broient, se piétinent. C’est la canaille du calcaire, nue, féroce, qui compte sur le vent lombard, fameux porteur d’eau, pour rapiécer ses guenilles, qui n’a rien à perdre et qui n’a peur de rien, qui secoue à les jeter par terre les pauvres, les faméliques villages hissés tant bien que mal sur sa rude échine. Couspeau (4), têtu comme une ligne droite, impassible comme une gendarmerie, l’affronte et en préserve la plaine.
On n’accorde pas assez de regards au grand fronton de l’occident, à Rochecolombe. Pareillement, ce bloc sévère vaut l’ascension. Il est l’effarement de la région sur laquelle il tombe tout-à-coup en arrêt, faisant lever devant soi des fermes, des hameaux, des bourgs, par centaines. Sur son flanc nord est une crevasse peu accessible. Un pauvre amoureux s’y vint » périr « . On l’appelle depuis lors la grotte de Brize, du nom de ce désespéré (5). Jadis,, la montagne était aussi le but d’un pèlerinage, mais quelle vieille du bas-pays, si vieille soit-elle, garde encore la mémoire de Colombe, une sainte sans bruit, vivant d’eau simple et de racines ? Sainte Colombe et saint Maurice, son frère, avaient, dit-on, choisi chacun le sommet d’une montagne pour y vivre dans la méditation et la prière. A de certaines fêtes, saint Maurice allumait sur les hauteurs qui dominent Dieulefit un feu de bois mort et d’herbes sèches, et sainte Colombe lui répondait de la même manière. Ne se voyant jamais ils s’entretenaient ainsi. Plus heureux que sainte Colombe dont l’oratoire ne laissera bientôt plus pierre sur pierre, saint Maurice est toujours à la mode. N’ai-je pas ouï dire que les protestants lui brûlent des cierges, les plus beaux cierges, des cierges gros comme ça ? Qu’on me trouve un saint plus brave, moins discuté ?
La Forêt de Saou est un lac évaporé. Que l’on ferme ses portes et, en quelques semaines, resplendira l’émeraude qu’elle a perdue, à l’exemple de tant de coupes d’alpe. Mais le temps n’est pas à de telles restitutions, et prosaïquement, depuis des centaines de siècles sans doute, la forêt s’égoutte dans la Drôme par le ruisseau du Pas de Lausens, et surtout dans le Roubion, autre affluent du Rhône, par la Vèbre, émissaire des neuf-dixièmes de son territoire. Des Romains, évidemment partis d’Aouste, ayant regardé par la fente du nord, finirent par se risquer dans l’enceinte miraculeuse, car on a reconnu leurs traces à des vestiges de routes près Tibur. A la rigueur même, on peut admettre, suivant l’opinion courante, qu’ils agrandirent le défilé ou Pas de Lausens et qu’ils le rendirent praticable dans une certaine mesure. Toutefois, malgré le bénéfice de cette exploration, la forêt demeure longtemps avec son mystère, car aucun acte n’en parle avant le XIVe siècle (6). Elle appartient alors aux comte de Valentinois. Puis elle passe au domaine delphinal. Concédée au chevalier de Bonnafau de Presque le 12 décembre 1772, » pour en jouir par lui, s’y croire successeur de sa Majesté, à titre d’inféodation et de propriété incommutable, avec toute justice, haute, moyenne et basse « , elle devient aussitôt l’objet d’un procès entre le concessionnaire qui poursuit la réunion de tout ce qui a pu être empiété sur ses limites, et les communes et particuliers qui le considèrent comme un usurpateur. Falquet-Travail succède à Bonnafau de Presque en 1780, mais à peine a-t-il pris possession que le procès recommence ou plutôt continue. Nous ne suivrons pas les plaideurs dans l’inextricable maquis où ils s’enfoncent sous le regard bigle des juges de la Drôme, de l’Ardèche et de Vaucluse, cependant le recours en cassation de Falquet-Travail contre le jugement hâtif et inique du tribunal de Vaucluse, ne peut être passé sous silence. Il est plein de la belle indignation d’un homme conscient de sa valeur, il dégage l’odeur forte de l’époque révolutionnaire. Il faudrait citer le document en entier. Notons seulement le passage où il est question de la Forêt de Saou. » La montagne connue sous le nom de Forêt de Saou était inaccessible, dit Falquet. Elle occupait un espace inutile dans le territoire français sous les rapports commerciaux. Il s’agissait de lui donner la vie. L’âge, les infirmités du citoyen Bonafaux ne s’y prêtaient pas, en même temps que les goûts d’un » vieux militaire étaient naturellement peu analogues à un pareil projet. J’étais jeune et j’ose dire laborieux, élevé dans une place qui m’attachant à l’intérêt public, avait dirigé constamment mon attention sur les projets qui pouvaient le servir, et fixé mon goût pour toutes les » connaissances industrielles : la Forêt de Saou valait pour moi ce qu’elle ne valait pas pour le citoyen Bonafaux ».
« Je crus qu’elle ne pouvait produire avantageusement que des combustibles et n’être vivifiée que par des manuel factures à feu ; mais sous ce rapport, elle me présentait des avantages rares.
« J’ai coupé le rocher le plus dur pour ouvrir une communication dont la possibilité même n’avait pas été conçue jusqu’à moi ; cette communication forme aujourd’hui une route départementale ». (la grande carte de Cassini de 1780 n’annonce pas le vestige d’une route. — Elle est tracée dans la petite carte de 1789).
« J’ai fait les travaux de découverte d’une mine de char » bon pour laquelle j’obtins un arrêt de concession particulière en 1784, et je l’ai exploitée pendant plusieurs années jusqu’au moment où nos travaux ont été détruits. »
« J’ai découvert et soumis aux épreuves : 1° une terre » argileuse, mise par les maîtres de l’art, dans un rapport officiel, au nombre des trois plus belles de France, et déclarée propre à tous les genres de poterie fine. — 2°Une espèce de kaolin. — 3° Un sable spathique, peut-être le plus blanc et le plus beau de France. (Des verriers saxons s’étaient engagés, en 1788, sur l’échantillon, à venir faire un établissement). — 4° Une terre d’alumine, où ce sel germe avec une fécondité qui peut en rendre l’extraction précieuse. J’ai enfin toujours travaillé et commencé plusieurs établissements utiles. «
Accroupie sur des trésors qu’on ne lui dispute point, la Forêt de Saou attend toujours le successeur de Falquet. Nul n’a repris les fouilles, nul n’a relevé les murs des fabriques. Avec tant soit peu de songe, on se croirait là dans le Camp de l’Eternel, comme désignaient ce lieu les huguenots, autant par amour des rapprochements bibliques que par une sorte de résignation navrée. Le mot marquait d’ailleurs admirablement l’abandon de leur cause entre les mains de Dieu. Ils étaient alors (7) poursuivis sans trêve par St-Ruth, maréchal de camp de Sa Majesté Très Chrétienne, à la tête de ses régiments de Cravattes et de Condé. Le Camp de l’Eternel, rempli des mystères d’Isabeau Vincent, la Bergère de Crest, le val où elle entendait des voix en gardant son troupeau, où, Débora laide et rousse, elle vidait au vent de révolte son sac à prophéties.
La population, d’une trentaine d’individus : fermiers, bergers, charbonniers troglodytes, est à peu près la même qu’autrefois.
En de telles chartreuses, la vie intérieure ne tire-t-elle pas doucement d’elle-même le rideau sur la vie extérieure? Une chose étonnera peut-être, c’est que les fils de saint Bruno n’aient jamais possédé ce domaine. Ils en eurent envie, paraît-il, il y a quelque temps, mais l’affaire leur échappa. Ces moines n’ont pas seulement connu et apprécié bien avant nous les sites les plus mystérieux de la terre dauphinoise, et joui en philosophes, en doux sauvages, des agréments de leurs cachettes, ils ont encore, ingénieurs habiles et admirables conservateurs des eaux et forêts, mis en quelque sorte la nature à point, préparé le régal pour nos sensations futures.
A son tour, un officier du Génie — le bon génie ! — visitait l’endroit, et pour un peu, la Forêt de Saou devenait champ de tir. La beauté de ce plan, par bonheur, ne séduisit pas tout le monde. Maintenant, d’autres projets se mitonnent. Les frères Silvestre, de Saou, dont la tendresse pour la Forêt me ferait croire au magnétisme de certains noms, les frères Silvestre qui ont appris par l’image ce coin de terre à leurs amis et connaissances, en joignant au besoin leur conviction émue aux ressources de l’art, ambitionnent pour lui les plus hautes destinées. A l’exemple de Falquet-Travail, ils y ont fait des découvertes et ont exploité notamment la terre de deux grottes, Beaume-Sourde et Beaume-Claire. Analogue à la terre de Sienne, ce produit (8), employé pour teindre les tissus en rouge, ne put résister au coup d’état provoqué dans l’industrie par les révélations de l’aniline. Ce dont souffrent surtout ces bons dauphinois, c’est de l’ingratitude des guides et des itinéraires officiels vis-à-vis de Saou — leur enfant gâté. Ils voudraient en faire une station estivale et leur imagination magnifique élève ici des hôtels et des sanatoires ; là, donne au jovial soleil de la Drôme le bleu d’un lac à baiser ; plus loin, fore la montagne pour y glisser en douceur l’indispensable chemin de fer.
On sort de la forêt de Saou comme d’un conte, l’esprit escorté par des visions que les roches, avec leurs attitudes fantastiques, leurs masques de peur rendent quasiment réelles, palpables. La Vèbre, que l’on suit tantôt de près, tantôt à une certaine distance, murmure ses vertus. Elles sont merveilleuses à l’égal de celles de la fontaine de Brocéliante. On dit encore d’un homme fort, qu’il a bu des eaux.de Vèbre et plonger un enfant nouveau-né dans cette onde cristalline, c’est le rendre inattaquable, voire invulnérable. Liserant d’un glissement clair le vert rude de prairies qui furent lac, puis marais (9), ce ruisseau court ensuite à la plaine embrasser le Roubion, son père morne et souvent colère.
« Il est défendu de trotter dans la ville de Saou ». On a envie de rire et pourtant comme il a raison cet avis municipal placardé au sein du plus vieillot, du plus pauvre carrefour! Le bruit, le mouvement, attristent comme un viol parmi les choses défuntes, et il m’a semblé que, d’elles mêmes, les bêtes respectaient à Saou ce silence des vieux pavés, des vieux murs, dont la mousse même ne veut plus; qu’elles sentaient obscurément la résignation des vieilles gens assis sur des chaises branlantes devant des portails las du heurtoir et de la moulure, ces portails dont les chatières démesurément agrandies servent d’embuscade à des matous élimés. Et partout, le rire frais de l’eau qui semble se moquer de ces vieilles choses, de ces rides ! ; – La ville de Saou, puisque ville il y a, possède les ruines intéressantes de l’abbaye de St-Tiers et du donjon de Lastic, une église très ancienne, de vieux logis, entre lesquels se distingue l’Hôtel d’Eurre, ex-maison forte, située pittoresquement au pied d’une formidable quille calcaire (10).
(1) Il acquit le domaine en 1850
(2) Ainsi nommé dès le commencement du XVIe s. M. Maurice Faure tient pour l’expression Roche aux corbeaux qu’il croit la primitive.
(3) Gargantua, le géant découvert par Rabelais dans nos contrées.
(4) Chaîne de montagne du Val-Bourdeaux (1585 m.)
(5) Son histoire a été racontée par Martial Moulin (Bouquet de Nouvelles)
(6) les plus anciens actes connus relatifs à la forêt de Saou portent les dates de I3I8 et de 1322.
(7) En 1685.
(8) La géodine
(9) Le Pré Roze.
(10) Cette ancienne » Bâtie » est actuellement la propriété de MM. Silvestre.

XI
DE CREST A LIVRON. — LA DROME ET L’OEUVRE DE RIGAUD DE L’ISLE — VAUNAVEYS ET EURRE. — ALLEX, SES CHATEAUX ET SES ILLUSTRATIONS. — RIVE GAUCHE : LES FÉLIBRES. — CHABRILLAN ET GRANE.
Entre le pont de Crest et le pont de Livron, qui soudent fort à propos les deux dernières contractions de la Drôme dans le calcaire, la surprise de rencontrer une région de bocages et de prairies est d’autant plus vive que la rivière accuse mieux ses traits de sécheresse. Elle atteint dans cette poche inférieure des largeurs telles qu’un crestois qui se vante n’oserait jamais les avouer devant un parisien : cinq cents, six cents mètres et plus. Dragées dures et sonores du galet, langues de sable inerte moirées par les grands souffles issus de la montagne, cuvettes de boue écaillées et même petits gours d’eau bleue où jouent des carpes méfiantes. A travers la solitude candide, un flot décharné rôde et pleure, le pauvre, sans apitoyer personne, car, tout là-bas, un grossier tombereau, lourd de gravats, s’apprête à lui passer sur le corps, et ses amies les bugadières, qui pourraient l’assister à ses derniers moments se sont laissées prendre aux grâces juvéniles d’un béai voisin.

Au XVIIIe siècle, ce désert qui coule avec je ne sais quel charme torride, était en quelque sorte illimité. Trop souvent, à gauche et surtout à droite, des terrains amphibies y ajoutaient le marais et la jungle, c’est-à-dire la pestilence et la misère, et ce sol, hésitant entre tous, semblait à jamais perdu pour l’homme quand Michel Martin-Rigaud de l’Isle (1) vint refréner le sans-gêne de la rivière et changer la face des choses. Divitavit pagum, frenans hoc aggere Drumam (2), dit une inscription de Grane où l’on pourrait voir sa propre devise. Né à Allex, les horizons de torpeur qu’il avait sous les yeux, en pesant sur sa jeunesse réfléchie et studieuse, déterminèrent vraisemblablement sa vocation. Le fait est qu’il passa toute sa vie dans sa terre de l’Isle dont le nom s’est étendu peu à peu à l’écharpe de plaine jadis usurpée par le gravier, la tourbière, la bourbe, l’oseraie, la saussaie. Quinze cents hectares environ, dont onze cents sur la seule rive droite, représentent cette conquête que Rigaud a eu le mérite d’entreprendre sinon de parachever, et c’est à peine si, en cherchant bien, on trouverait aujourd’hui quelques taches de boue, vestiges d’anciens bas-fonds, sur la traîne opulente de la vallée.
Ce patriarche de l’agriculture— pour le saluer du même titre que Delacroix(3) — procède de Craponne et d’Olivier de Serres. Il ne se borne pas, en effet, à créer un sol au moyen de digues et de canaux, il l’habille aussi et le pare de toutes sortes de cultures. Afin de propager l’industrie de la soie, il entretient de vastes pépinières de mûriers blancs et, vulgarisant de tout son pouvoir la pratiques des engrais et des prairies artificielles, il indique les plus sûrs moyens de parvenir à la prospérité agricole. Le domaine de l’Isle, agrandi et embelli en peu d’années, n’est pas seulement la ferme-modèle selon le cœur d’Olivier de Serres. C’est un véritable institut agronomique où l’agriculture a ses grands jours, ses assises solennelles. On s’y rend de toutes les parties du Dauphiné et les travailleurs des champs y reçoivent des récompenses proportionnées à leurs mérites, (4)
Assez unie, la rive droite avec ses châteaux ou demi-châteaux : Beauregard, Vallons, Duvaure, Courrier, l’Isle, la Garde, Allex, les Ramières, Pergaud, la Rolière, vise dans son ensemble à la grande propriété et ourle de riches cultures les communes d’Eurre et d’Allex, dont les agglomérations lointaines accompagnent le recul des collines. La Saleine, le Merdari, au vocable de vergogne, et la Riaille, sans compter la Vaure, gouttière artificielle, en sont les ruisseaux misérables et ils ne sauraient la vivifier sans les ponctions que l’on a fait subir à la Drôme en aval de Crest. Qui dit béal sous ce ciel brillant, dit verdure, jardins et douceur d’être. En remontant la Saleine jusqu’à sa tête orientale, on atteindrait Vaunaveys (Valnaves au XIIe siècle), autre village de ces versants fleuris. On croit qu’un rocher voisin, celui de St-Denis, simule le port d’un majestueux navire, d’où le nom donné à la vallée. Des javelots, des cassolettes et un Mercure nu, découverts dans les environs, permettent d’induire que le lieu fut accommodé à la romaine. De même Eurre, appelé Urre dans le pays, conformément à l’orthographe et à l’euphonie anciennes, et où l’on a voulu voir le mot horreum qui désigne un entrepôt, un magasin de subsistances militaires. Ce que l’on sait mieux, c’est qu’une tour de la forteresse aujourd’hui à terre, portait au Moyen Age le nom des Arnaud de Crest, rappelant ainsi leur possession. Le château passa ensuite aux mains de la puissante famille d’Urre qui donna aux habitants une charte de libertés. Claude d’Urre, seigneur du Puy Saint-Martin, fut gouverneur de Gênes sous Louis XII et François Ier. Son petit-fils Rostaing fut gouverneur de Cazal et de Montferrat et lieutenant général au gouvernement de Provence. Thierry, tige d’une autre branche, plus connu sous le nom de Tartarin, c’est-à-dire l’Intrépide était un des meilleurs compagnons d’armes de François Ier. Germain, appelé le capitaine Mollans par les contemporains, se distingua dans maintes campagnes et notamment en 1537, lors de l’expédition de Charles-Quint en Provence. Bertrand d’ Urre, seigneur de Brette, montra également une grande bravoure au cours de diverses entreprises militaires et on le cite également parmi les favoris de François Ier, Henri II et Charles IX.
C’est ici, aux portes de Crest et dans Crest même pour mieux dire, que s’affrontaient jadis Diois et Valentinois. Mais les deux diocèses s’y joignaient aussi, car Vaunaveys et Eurre étaient paroisses reconnaissant la crosse de l’évêque de Valence. En 1790, lors de la création du département, tout en tenant compte des anciennes divisions administratives et ecclésiastiques, on ouvrit la barrière au Diois qui semblait n’attendre que cette occasion pour échapper à ses montagnes, et on le laissa déborder dans la vallée inférieure jusqu’à mi-chemin d’Allex et de Livron. Loriol devint alors, le canton-tampon entre le nouvel arrondissement et le Rhône.
Allex (Alisium au Xe siècle, Aleusia et plus tard Alez et de Aleiio), vieux bourg sur la grand’route des Alpes, compte près de quinze cents habitants. Il se divisait autrefois en deux parties : le bourg Margerie et le bourg de l’Eglise, et il était un fief de l’évêque de Valence dont les droits furent confirmés comme de juste par l’empereur d’Allemagne. Pris et repris pendant les guerres de religion, il eut beaucoup à souffrir des représailles des partisans. En 1574, les huguenots y mirent à mort le curé Pierre Vions occupé à donner les cendres à ses ouailles, et l’on raconte qu’ayant gardé un autre prêtre durant une semaine ils finirent par le saigner comme un mouton devant la porte de l’église. La soldatesque quand elle ne se battait plus se livrait de bon cœur à ces divertissements de boucher.
Pas de monuments anciens. Des prieurés rustiques, couchés tout de leur long dans les champs et à peine reconnaissables à quelques pierres effritées. Dans l’église, sous le badigeon égalitaire, perce par endroits la franchise romane, cette architecture sobre, tolérante, si conforme à l’esprit et aux goûts des anciens dieux. En revanche, Allex, terrasse en belle vue, déroule devant soi le tapis le plus rare, parsemé de villas et de gentilhommières, soulevé d’assombrissants massifs d’aulnes, de frênes, d’ormes et de chênes. De maladroites restaurations ont fait perdre son grand caractère au château édifié ici au XVIIIe siècle par, les la Tour du Pin Gouvernet. L’Isle, où Rigaud est mort après quelque cinquante ans au service du bien public, n’a d’intéressant que l’inscription gravée (5) en son honneur par les populations reconnaissantes. Aux Ramières, propriété de M. de Gailhard-Bancel, tout est moderne sans vanité. L’air du pays se retrouve dans la demeure très simple, construite en molasse de Grane, cette pierre couleur feuille morte, raboteuse et piquée, qui ne semble jamais neuve et qui dore les granges comme d’un reflet du bon vieux temps. Je ne dirais rien de Vermenelle et d’Aiguebonne, fermes perdues parmi l’ondulation du plateau nord, si ce n’avaient été deux Bâties. Rostaing d’Urre, marquis de Treffort, tirait même son nom de la seconde de ces maisons-fortes, un petit fief à lui. Rochas peut-être trop engoué des hommes de guerre, consacre quelques lignes de biographie à Aiguebonne, mais il a complètement oublié son frère, Chaudebonne, né comme celui-ci à Allex, et figure autrement séduisante. M. Brun-Durand a consacré à Chaudebonne, galant coureur de ruelles et » le meilleur des amis de Madame de Rambouillet » une étude fort soignée, qui restera l’un des portraits les plus curieux de sa précieuse galerie.
Ajoutons à ces illustrations d’Allex, plusieurs membres de la famille des la Tour du Pin-Montauban : Lucretius Hector François, dit le Comte de Lachau, (1675-1730), maréchal de camp et gentilhomme de la chambre du roi ; Louis-Pierre, évêque de Toulon, et qui lors de la peste de cette ville, se montra le digne émule de Belzunce, et enfin Lucretius Henri François, neveu du précédent, qui mourut évêque de Riez en 1772.


(1) Déjà cité plus haut parmi les illustrations crestoises.
(2) » 11 enrichit le pays en réfrénant la Drôme par cette chaussée. «
(3) Statistique de la Drôme.
(4) Ces fêtes avaient lieu chaque année le jour de la Saint-Michel, 29 septembre, patron de Rigaud.
(5) Cette, maison était l’habitation ordinaire de M. Michel-Martin Rigaud de l’Isle, De son vivant il fut un excellent.citoyen, l’ami, des. hommes, et le père des pauvres. Ce marbre a été placé aux frais et par les soins de ses voisins de tous les ordres qui ont voulu rendre hommage à ses vertus et en conserver la mémoire. Il était né le 4 avril 1704 ; il est mort le 21 février 1782.

Sur quatre lieues de trajet, un chemin, un seul, pour passer de la rive droite sur la rive gauche. Souvent, des villageois, traversent à même le lit de la Drôme, pour couper court. Rien n’est paradoxal et joli comme ces blaudes d’azur féroce en marche dans la rivière chauffée à blanc. On songe aux caravanes, au Sahara, au mirage, d’ailleurs non décevant, car, à travers les sables, ce sont les rives verdoyantes qui le suscitent. Le chemin que l’on a eu le bon esprit de confier à un pont de cinq arches en pierre brûlée de Grane, relie Allex à ce bourg et trace ainsi dans sa plus grande largeur la coupe de la vallée. Il offre un développement de quatre kilomètres environ.


Cette rive gauche est plus agreste, plus mouvementée. Elle a aussi moins de plaine arrosable le long de la Drôme. A la parcourir on la trouverait remplie de cachettes pour bergers idylliques, de vallons d’églogue aux fontaines doucement murmurantes, de jardins et de bois suspendus. La plus belle fille de ses roches rousses s’appelle Granette, rivièrette aux bords délicieux, et fort rarement méchante. Quoi d’étonnant après cela qu’elle ait mis au monde la Joyeuse Troupe félibrêenne, dont j’évoquai tantôt les mérites et l’action salutaire. J’ai dit combien j’aimais ces butineurs de rêve qui n’ont pas cessé d’être agriculteurs, artisans ou pâtres et qui, en se jouant, acheminent le pays vers une sage décentralisation. Je pense, comme Almoric, que la remise en honneur du vieux langage peut être, dans une certaine mesure, la remise en honneur de la terre que nos aïeux fécondèrent de leurs sueurs.
Lou paysan amo sa terro
Que li semound toujour de pan
En bien trimant ;
Amo sa maison soulitairo
Amo veire soun viei cubert
Soun calabert.
Le paysan aime sa terre — qui lui donne toujours du pain,
— en bien trimant ; — Il aime sa maison solitaire — il aime à voir son vieux toit — son hangar.
Que n’aime-t-il pas ce paysan qui célèbre la toiture grise de son clocher — pas trop pointu — plus souvent tronqué — comme en dressent tant les vallées du Diois ?
…la tèuligno griso
De soun cluchiè pas bien pounchu
Plus lèu moutu.
Qui est faraud en même temps, qui se sent quelqu’un et a le courage de l’affirmer.
Lou paysan sus sa montagno
Ac’eis un rei sulide e fier
Pas rei d’allier ;
Un rei bouchas, un rei d’eigagno
Plus matinié que lou soulé,
Lou rei soulé.
Le paysan sur sa montagne, — c’est un roi solide et fier
— pas roi d’hier ! — Un roi agreste, un roi de rosée — plus matinal que le soleil — le roi soleil
Avec Divajeu (Deus adjuvat), situé en face de Crest et d’où descend jusqu’à la Drôme le ravin de Lambres, souvent opaque et toujours charmant, les communes de Chabrillan, et de Grane accaparent la rive gauche. Chabrillan, Chabreilhe au Moyen-âge et dans le langage populaire, était un fief des comtes de Valentinois. La terre achetée par Louis XI, fut presque aussitôt échangée contre le domaine de Pierrelatte, possédé par les Moreton. Ces derniers acquirent de si grands biens que les commères pensent flétrir encore certains dissipateurs en disant d’eux « qu’ils mangeraient la fortune à M. de Chabrillan « . Chabrelhe, un moment chef-lieu de canton du district de Crest, en 1790, a gardé l’aspect féodal. De la colline d’où dévalent follement ses maisons rousses, on jouit d’une belle vue sur le bassin de la Drôme et les monts de la Forêt de Saou empilés les uns sur les autres, à l’orient. Le château, à peu près complètement ruiné, protège de ses pans charitables l’épine et le chardon contre les vents du nord. L’église n’a pas même la pauvreté touchante de beaucoup de paroisses rurales. Par contre, la chapelle du cimetière, sous le vocable de St-Pierre, reste d’un prieuré d’Augustins, filiation de St-Thiers, a mérité d’être classée parmi les monuments historiques. C’est l’un des nombreux exemplaires du style roman campagnard en usage dans nos régions pendant trois siècles.
Au soulé don meijour (1)
lou chabrelhan bouligo.
Il n’est nullement question du village dans cette devise un peu singulière ; il s’agit ici d’un frelon assez commun sur les rives de la Drôme. Mais en la prenant pour emblème, Almoric n’a-t-il pas voulu symboliser du même coup son pays natal ?

Delacroix assure que le nom de Grane vient de Granée, nymphe des bois, par allusion aux forêts dont le territoire était couvert. D’autres, avec l’abbé Vincent, préfèrent le tirer de granum (grain, céréales), c’est-à-dire fertilité, abondance. Quelle que soit l’opinion suivie, notre bourgade peut s’en accroire. Les Comtes de Valentinois, qui avaient à Grane une de leurs résidences favorites, donnèrent en 1370 une charte de libertés aux habitants. Quarante-six ans plus tard, la forteresse était le théâtre d’un événement fort curieux et j’ai raconté comment l’évêque Jean de Poitiers, ami de Jean Sans Peur, s’y montra le digne émule du duc de Bourgogne. Son crime, d’ailleurs ne lui profita guère, car la terre entra dans le domaine delphinal en 1419. Comprise dans la dotation de Diane de Poitiers au siècle suivant, elle fit partie en 1642 du Duché de Valentinois constitué en faveur des princes de Monaco.
Grane a son importance. Nœud des routes qui mènent à Crest et à Loriol d’une part ; de l’autre â Allex, puis à Roynac et Marsanne par le pittoresque village de la Roche-sur-Grane et le col forestier de Tartaiguille (466 m.), c’est un passage, comme disent les ruraux, un centre, un point où la montagne — qui n’est plus l’Alpe, on l’entend bien — aime à prendre contact avec la plaine. Le bourg est propre, un peu dégingandé par tradition féodale et combien curieux avec son clocher armoricain, ses maisons chenues, sa tour aux tons chauds, pan de mur en bossage suspendu sur l’abîme ! Pour se rendre compte du choix heureux des Poitiers, il suffit d’escalader la fière colline qu’ils fortifièrent et qu’ils marquèrent de leurs mœurs. On voit des lierres vigoureux étreindre les murailles, des vignes se cramponner aux talus jonchés de débris, et l’on vous montre un espace vide qui porte le nom de Chambre de la Dame et qui fut, dit-on, l’appartement de Diane de Poitiers. On surveille de cette terrasse presque toute l’ancienne terre de Grane arrosée par Granette, Béonette, et encore un Merdari ; Combe-Maure, dont les manants jugés infidèles à cause de la brûlure de leurs traits, étaient frappés d’une sorte de flétrissure ; la forêt de Filan, si précieuse aux maîtres de céans ; ici près, Notre-Dame-d’Andéa, prieuré célèbre, dévoré peu à peu par les exigences d’une exploitation rurale.
Le clocher de Grane mérite l’attention. C’est une pièce rare et quasiment unique, je crois, dans un pays comme le nôtre si fortement imprégné de civilisation latine. Imaginez la plus trapue, la plus campagnarde des tours, pointant tout à coup dans le ciel la grâce effilée d’une flèche. Flanquez cette tour d’une tourelle guerrière du côté qui regarde la bise. Ornez cette flèche de crosses végétales et couronnez d’un lis le sommet ogival de ses fenêtres lilliputiennes. Enfin, baguez-la à mi-hauteur d’un anneau discret et amortissez d’une croix légère sa cime tout épanouie de bulbes, et vous aurez une idée de ce monument, à la fois grâce et rudesse, comme le moyen âge en a fait tant fleurir dans la lande bretonne. Il est fâcheux qu’un tire-ligne sans art ait empâté dans la maçonnerie, défiguré sous le badigeon le bel et léger octogone de la tourelle sous prétexte de consolidation. Veuf de son église depuis plus de trente ans, le clocher sert maintenant de beffroi communal. Des parties de celle-ci ont servi à construire un Hôtel de ville dont une porte basse, fort ancienne, est remarquable. Rien à dire de la nouvelle église bâtie sur un belvédère qui domine la vallée de la Drôme. Elle affirme, en dépit des tons agréables de la belle molasse exploitée ici, le néant pompeux de l’architecture religieuse de notre temps.
Bourg agricole et sans ambition, fier à bon droit de son hôtellerie réputée à plusieurs lieues à la ronde, Grane possède cependant trois filatures et moulinages de soie. Sa rivièrette y fait aussi mouvoir plusieurs artifices. Elle roule en moyenne un peu plus d’un mètre cube à la seconde, eau rieuse que gaspille la Drôme imbécile, comme si elle attendait d’autres tributs, comme si ce n’était pas son dernier affluent. Née à la Répara, Granette descend très rapidement par des ravins les territoires d’Auriples et d’Autichamp, se double d’un ruisseau au-dessous de la Roche-sur-Grane ; puis elle débouche en plaine où, moins pressée elle se mêle aux rondes enfantines des saules, aux farandoles éperdues des peupliers. Elle se perd enfin dans la Drôme en face d’Allex, après quinze kilomètres de cours.
(1) « Au soleil de midi, le chabrelhan prend son essor » (Devise de la Joyeuse Troupe félibréenne des rives de Granette)
XI
VUE DU RHÔNE. — LIVRON, SON ASPECT, SON HISTOIRE, SES CÉLÉBRITÉS. — LE PONT SUR LA DRÔME. —
LORIOL ET LE LORIOT. — LA FIN DE LA DRÔME. — CONCLUSION.
D’ici l’on entend respirer le Rhône.
Il faut venir de la montagne, il faut déboucher, comme nous faisons, de quelque long couloir de vallée, pour avoir la vision réelle de cette force lâchée à travers notre Sud-Est, bête en folie courant droit devant elle et dont s’écartent en mainte passe les collines éperdues. Le fleuve se révèle soudain dans la souveraineté de son rôle. On le sent l’élément actif de la région, le dispensateur, et tout bas on lui rend grâces. Et puis, il n’y a pas à dire, en dépit des préférences que Ton peut manifester, le Rhône c’est le Rhône. Nul fleuve, en France, n’a ses reins, sa fierté frémissante. Nul surtout, n’a vu ruisseler sur ses bords, depuis qu’il est une histoire, plus d’hommes de toutes couleurs en mal de gloire ou d’affaires.
Décor superbe et bien trop vieux jeu pour plaire aujourd’hui. Voyez plutôt. Le fleuve, ici desserré et gonflé d’îles, tend à s’épancher galamment avec la terre précieuse de ses alluvions anciennes. Au couchant, les falaises du Vivarais, lui impriment, toutes sinuosités, toutes fantaisies à part, une direction qu’il ne quittera plus. Entre ces roches méchantes, et romantiques certes, dont les.morsures dans le ciel de soie racontent les fureurs millénaires et nos avant-monts alpestres, beaucoup plus timides, qui se sauvent au Levant, il y a place pour un peuple. C’est l’immense plaine du Valentinois (1). Jalouse du Rhône, de son dieu, elle fuit avec lui tout là-bas vers une porte de mystère, happant vallons et plaines au passage. Ce n’est pas tout à fait la Provence, mais-ce n’est déjà plus le Dauphinc. En cherchant bien, on découvrirait à l’aisselle des collines fauves ou noires de la gueuse Ardèche le pâle olivier, tandis que, baignée de lumière, la plaine foisonne de couleur et de vie. Souvent le mistral miaule par l’espace clair et trousse hommes et choses. Le paysage, ainsi accoutumé aux révérences et orienté vers le midi, en garde plaisamment une sorte d’infirmité. Que d’arbres, que de mûriers surtout! Aussi cela peine fort, en juin, de voir pleurer seul parmi la nature en fête, le protégé d’Henri IV. On l’a dépouillé sans pitié de ses feuilles et, tout honteux à cause de sa tête ridicule, il s’incline devant le soleil qui peut tout et qui lui rendra sa parure. Encore que les Valentinois plaisantent sur leur accent leurs voisins de Montélimar, ils se rangent à l’occasion.du côté du soleil :
A Valence
Le midi commence,
chacun sait ça. Par exemple :
A Livron
Il est fanfaron,
ce midi en l’honneur duquel j’ajoute, tout en m’excusant, une réplique au vieil adage. Aussi bien c’est de la faute… aux nuées, oui, aux nuées. Que de fois je les ai surprises poussant vers la Grande-Bleue leurs lentes, leurs virginales théories ! Tout à coup, elles s’immobilisaient sans raison au-dessus de la rive droite de la Drôme, comme prises de crainte et une féerie se passait dans le ciel. D’une part, l’horizon doux et attristé d’un orage perpétré au loin ; de l’autre, le firmament libre et dur, exaltant dans un air de braise le chant des cigales en folie. De drame, point. Le plus souvent, les nuées, impuissantes et formidables, continuaient de monter en neige en présence de la terre promise. Livron est donc un de ces endroits assez singuliers où le nord et le midi se regardent en chiens de faïence. M. Lacroix, qui pousse vraiment la conciliation jusqu’au bout, appelle le pont de la Drôme un trait d’union entre ces deux entités.


Face au fleuve, deux monstres de pierre, d’inégale stature, et fort tronqués depuis, gardaient notre avenue d’Alpe. J’ai cité Livron et Loriol qui doivent dater de longtemps si l’on en juge par les avantages de leur double position sur la Drôme et sur le grand chemin des peuples. Mais des deux cités huguenotes, Livron a gardé seule l’air en dessous. Elle est aussi la plus célèbre.
Sagement, nous n’avons pas débaptisé cette ville, qui s’appelait ainsi dans la première moitié du XIIe siècle (2). L’abbé Moutier se demande si le mot ne vient pas de libra, en raison de la livre qui pouvait être exigée au passage de la Drôme. Il semble toutefois plus rationnel d’admettre que le lieu devint l’occasion du péage et n’eut pas par conséquent à lui faire cet emprunt. Aymar du Rivail y place l’antique Aeria que les textes situent, sans plus s’expliquer, sur une haute colline, dans la vallée du Rhône. D’autres affirment l’existence d’un oppidum celtique et même d’un camp romain. Entre ces différentes opinions, le choix est libre, comme Livron même où la croyance de la Réforme voyait un symbole d’affranchissement et de liberté.
Le Moyen Age. Notre petite ville, malgré son appareil formidable, n’est pas, heureusement, à l’abri du prodige. La légende, évadée des sylves ténébreuses du voisinage, sinon sortie de l’onde héroïque que hante le Drac, démon redouté (3), y pousse une jolie pointe bleue. Cette fois c’est un anglais à l’âme d’enfant, quoique maréchal du royaume d’Arles, le doux Gervais de Tilisbery(4), qui s’est laissé éblouir. Il y a, dit-il, à Livron, une tour merveilleuse, car les sentinelles qu’on y place, invinciblement charmées par un sommeil étrange, sont, chaque nuit, transportées par des génies au pied du coteau. A leur réveil, quand le lait des aubes se met à couler, chassant la peur, elles n’ont aucun souvenir de leur aventure. Gervais ajoute qu’il a été témoin de l’enchantement. En ce temps, on fréquentait beaucoup chez les trêves, chez les fées, et sans doute Maugiron fit cesser pour toujours le prodige en rasant les murailles en (585. Elles furent toutefois relevées par les protestants, et derechef abattues. En 1683, Louis XIII fit démolir le château qui avait jusque-là, tant bien que mal, résisté à toutes les révolutions. Désormais le monstre n’avait plus de tête.
Il y aurait beaucoup à dire de Livron, ancienne terre de l’évêque de Valence et dont l’église de St-Prix, érigée en collégiale, entretenait quatorze prêtres outre le curé. Pillé plus souvent qu’à son tour, même pour cette époque aux floraisons de sang (5), puis brûlé en 1350, il est sans doute des lieux célèbres à meilleur compte. Livron pourtant n’entre pas dans l’histoire avant la Réforme et même alors l’intérêt de sa chronique se concentre tout entier dans le fameux siège de 1574. Cette défense qui fut beaucoup mieux qu’un trait d’héroïsme, puisqu’elle fut un trait d’esprit, efface en effet, tous les événements qui précèdent. C’est un bibelot à placer dans les jeunes mémoires à côté des épisodes antiques que l’on apprend à vénérer.
On n’a pas oublié Jean de Montluc. Avec ce singulier prélat qui, la mitre en tête, parle et fait les gestes comme un ministre de la religion, le bourg, assez proche de Valence, et l’un des premiers influencés par les idées nouvelles, devient rapidement un des remparts de la Réforme. Catholiques et protestants de s’acharner à la possession de cette place, admirablement défendue par sa position naturelle et par un donjon qui ne le cède en rien à la tour de Crest. Lesdiguières y tient si fort, que pour la garder, dit-il, il y emploiera » jusques à sa propre vie. » Mais, de leur côté, Maugiron, Gordes et Henri III lui-même prétendent s’en servir pour faire un exemple.
Bien loin de désespérer les protestants, comme l’avait calculé sans doute Catherine, la Saint-Barthélémy ne fit qu’accroître leur audace et leur colère. Dès la nouvelle du massacre, Montbrun prompt comme la foudre, fait irruption dans la plaine, ramasse des partisans, fortifie des postes, proclame la liberté du commerce — autant dire la révolution. Tandis qu’il s’empare de Loriol, Mirabel, un de ses lieutenants, relève Livron démantelé par Gordes. Le Diois court aux armes. Partout la lutte s’annonce sans merci.
Il s’agit d’en finir avec les huguenots. A cet effet, Henri III, qui vient de succéder au falot et sombre Charles IX, rassemble à Lyon une véritable armée. Tout d’abord, elle emporte, pour se faire la main, quelques bourgades, et quand elle se croit suffisamment aguerrie, elle vient camper devant Livron, le morceau de résistance. Par bonheur, un Crestois, le brave Roysses ou Roesses, a eu le temps de se jeter dans la place. IL a en tout et pour tout un fauconneau, joujou d’artillerie quasiment inoffensif, mais chacun de ses quatre cents hommes en vaut dix. Et d’ailleurs, non seulement les citadins, mais encore les femmes s’en mêlent, Dieu donc semble avec lui. Au bout de quelques jours, la ville ayant reçu sans broncher 660 coups de canon, le duc de Montpensier, qui commande en chef les troupes royales, se replie sur Etoile, déjà découragé. Bellegarde lui succède. A son tour, » ce torrent de là fortune » (6) s’y épuise de rage et d’impuissance. En réponse à ses assauts, ne lui envoie-t-on pas des rébus ? C’est, suspendus au bout d’une pique : un fer à cheval, un chat et des moufles. — Maréchal, on ne prend pas un tel chat sans moufles. — L’injure est doublement cruelle car elle vise aussi Henri III qui se sent mal quand il voit un chat. Le roi, dans le fond, eût peut-être consenti à la paix, autant par ennui que par regret du Louvre et fringale de luxure, mais Montbrun, grisé par ses entreprises, n’entendait pas de cette oreille.
Durant sept mois, la ville fut investie par près de vingt mille reîtres Rien n’en put venir à bout, ni l’aboi meurtrier des canons, ni les assauts répétés. Enfin Henri III accourt d’Avignon dans une nuée odorante et rose de courtisans. Il pense tout réparer par sa présence. A cette vue, la population hâve et famélique n’y tient plus. Elle se précipite aux murailles et décharge sa bile en mots terribles sur le roi et son armée (7). Même, pendant que des coups s’échangent entre assaillants et assiégés, une vieille femme, assise sur le rempart, file tranquillement sa quenouille — farce inouïe !
Le roi, déjà poignardé par le ridicule, s’enfuit précipitamment. C’est de ce moment dit Sully, qu’on peut dater ses malheurs et son ignominie.
Ce Livron, vu de la plaine — car il y a aussi une ville basse — paraît encore joliment noir de peau, sinon conforme à sa prouesse. On y montera, ne fût-ce qu’en souvenir du fameux siège. Et d’ailleurs, ses rues sont assez scabreuses pour que, l’imagination aidant, l’on croie que les fumées de 1574 viennent à peine d’en sortir. Le cimetière, suspendu sur le bourg, lui rappelle trop qu’il n’est que poussière. Par exemple, retenez-en la vue que masquent à peine les cyprès incorruptibles, ces cyprès du midi d’autant plus beaux qu’ils se nourrissent de là mort. C’est la vallée du Rhône chevauchée par le fleuve fier, ses lônes d’un vert dense, ses terres qui respirent en ondulations infinies, ses vergers, ses vignes et ses bois, ses granges innombrables — commères trapues, le ventre au soleil, le dos dans le châle tiède des peupliers ou des sycomores, l’espace dru, rempli de la bonté du ciel. D’un côté, ce site féodal trempe dans la prairie ; de l’autre, il glisse brusquement jusqu’aux grèves de la Drôme. Les eaux affouillaient souvent ce talus rougeâtre et qui semble à vif. On les a disciplinées. Ce sont les nourrices ponctuelles, quoique machinales, d’un vignoble qu’elles trouvèrent un beau matin dans leur lit (8). Mais si la vigne renaît partout, le vin ne se reconnaît guère. Brézeme et La Rollière, dont on voit le château s’écarter au large, valaient presque l’ Hermitage aux yeux du connaisseur. Question de nuances dans le velours. Le crû qui a la prétention de les remplacer est évidemment estimable, mais il se ressent trop de sa roture.
L’industrie de Livron est assez active. On y compte quatre filatures de cocons ou moulinages de soie, un martinet à cuivre, trois fabriques d’instruments aratoires, une scierie de marbre, une tannerie et deux fabriques de tuiles et de briques. Le bourg commence à exporter ses savoureuses cerises printanières, recherchées à Londres et même en Allemagne.
Guillaume de Livron. archevêque de Vienne pendant vingt-deux ans (9) ; les familles Corbières de la Tour et La Rollière, dont les membres s’illustrèrent surtout dans les armes, sont originaires de cette localité. Suivant l’opinion commune, Jean de Mont lue, seigneur de Balagny, aurait également vu le jour sur les bords de la Drôme. Né du péché d’un évêque (10) avec une belle livronnaise, Anne Martin, que l’on fait abbesse de Soyons, ce Balagny fut, pour un bâtard, plutôt malheureux à la guerre. Mais son père, comme disent finement les Dauphinois, avait eu la chance de naître avant lui. Aussi devint-il prince de Cambrai et maréchal de France. Quant au prélat, ses tournées extra pastorales et ses vices se cachent à peine sous l’améthyste qui ne sait pas rougir. Cette figure, trop ternie, ne manque point de grandeur et il convient de lui faire place à travers la foule historique. Passons deux siècles. Talleyrand, c’est Montluc tout craché. Comme lui il boîte, il confirme, il revêt tous les costumes, il touche du doigt toutes les affaires. Seulement, l’évêque d’Autun dépasse de plusieurs mîtres l’évêque de Valence pour l’audace et la fourberie.
Rigoriste et austère comme un bon huguenot, Livron se dresse et s’ennuie à demi-lieue de sa gare principale. Ce n’est pas la première fois qu’un vieux bourg, voyant venir de loin le progrès avec ses grandes jambes, lui aura fait peur. A la longue toutefois, un chemin de fer, la ligne des Alpes, se coulant vers la Drôme, a fini par contourner la roche féodale et gagner le Diois étonné. Mais Livron, ne regarde même pas cette halte ridicule que l’on a déposée en courant sous un pont.
Ce pont, dû à l’ingénieur Bouchet (11) se porte comme le Pont-Neuf. Tel n’était pas celui de 1513, édifié sans doute avec trop de hâte, par des ingénieurs manquant des ressources indispensables à la construction d’un pont jeté sur une rivière aussi torrentielle que la Drôme L’ouvrage, qui d’ailleurs en remplaçait un autre ruiné par les inondations au Moyen Age, s’écroulait vers 1521.
Le pont actuel a trois arches, celle du milieu un peu plus ouverte pour permettre le dos d’âne, toujours si joli. .Ni ornement, ni-luxe, bien que les contemporains y aient dépensé, sans reproche, 1005000 livres, soit deux beaux millions de notre monnaie. La chose plaît par sa seule force, barrant d’un jubé blanc la nef de la vallée. Le 2 avril 1815, les gardes nationales de la- Drôme et l’armée royale venant du midi l’empourprèrent de sang en une cognade furieuse.
Le pont franchi, en vingt minutes on atteint Loriol dont le clocher pointe au-dessus des platanes de la route, comme une croix en tête d’une procession.
Moins peuplé et peut-être plus compact que son voisin de la rive droite, Loriol ne se donne pas l’air d’être de la religion. C’est un bourg d’apparence tout à fait moderne avec ses bonnes grosses maisons avenantes de propriétaires-cultivateurs ou de rentiers campagnards. Le jeu de boules y est en honneur et sur les places ombreuses, les discoboles en bras de chemise, nerveux et narquois, font des jaloux autant par leurs bons mots que par leur adresse. Est-ce une caractéristique du midi triomphant ? Le » fulobre » plus qu’à Livron abonde, s’agite, régale la rue avide de potins.
Si l’on a la curiosité de gravir la colline perforée de cavernes d’où le bourg a glissé peu à peu jusqu’à la plaine, le pied pourra broncher contre des pierres fauves, mais l’œil, en compensation, ne découvrira rien qui vaille, Antoine de Balsac lui-même, l’évêque de Valence dont Loriol fut le séjour préféré, n’y retrouverait plus l’emplacement du palais et de la prison édifiés par ses soins au XVe siècle, — les deux choses n’allaient guère alors l’une sans l’autre.
On sait que le château et les murailles furent rasées en 1581. Des ruelles de souffrance, sur lesquelles, sans façon, des étages ont sauté, sont tout ce qui reste de l’ancien Loriol, pelotonné comme tous les bourgs de l’époque, Une de ses rues n’a pas peur. Elle s’appelle tout bonnement rue d’Aurélien. Pur cabotinage municipal. Aurélien, sans doute, malgré son surnom aventureux (12), n’a jamais eu affaire ici, et peut-être vaut-il mieux, après tout, descendre d’un oiseau que d’un empereur. Qui ne sait en effet que le loriot (13), oriolus, le gentil oiselet à la livrée d’or, chante Loriol à plein gosier et figure dans ses armes ingénues ? Eh bien, les savants eux-mêmes sont sans égard pour cette étymologie charmante. L’un dérive Loriol d’Orreum, pour donner un frère à Eurre ; l’autre le fait surgir de Loron, d’un ruisseau où un merle ne trouverait pas à boire. Nous voilà bien avancés !
Terres jumelles du domaine de l’évêque de Valence, Loriol et Livron eurent des destinées pour ainsi dire identiques. A. toutes les époques de l’histoire, ces deux gardes du corps de notre vallée se font des signes à travers la Drôme, obéissent ou désobéissent aux mêmes maîtres. Quand Livron se déclare pour la Réforme, Loriol pour ne pas demeurer en reste, s’offre un pasteur et, à tour de rôle, les deux partis y jouent le drame au réel. On en connaît les péripéties et il n’est pas utile de les rappeler. A voir Loriol si neuf, si candide dans ses arbres, on ne se douterait guère qu’il a vécu. Il ne garde même pas rancune au chemin de fer de lui avoir soustrait une partie de ses moyens. Loriol était alors un plaisant et bruyant embarcadère de pataches jaune d’œuf, de cabriolets, de tapeculs, de carrioles de tous les âges et de toutes les formes. L’on vous y transportait pour tous pays chaque jour et à toute heure, en vous recommandant, sans doute, de prendre garde à la secousse.! Rien n’allait plus vite dans le département, et rien n’était plus économique. Ces carrioles, mon grand-oncle m’en parlait souvent en me racontant des histoires qui n’étaient pas toutes inventées. Elles étaient le tron (14), aimait-il à dire, le diable les emportait et Loriol soulevait de la poussière sur toutes les routes !
C’est un monopole qui ne reviendra plus. Mais le loriot d’or familier, posé sur la colline comme sur l’épaule de la contrée, chante toujours la terre et berce la peine du laboureur. Les descendants de l’oiselet symbolique se livrent donc surtout à l’agriculture et leurs terres légères, faciles, sont de celles qui payent. Avec cela, quand les cocons réussissent, on bâtit des granges qui ne sont pas toujours en Espagne.
Les établissements industriels comprennent : deux moulins, deux scieries de bois, deux tuileries et deux filatures de soie.
Jadis, dans la saison chaude, gens de Loriol et de Livron, principalement des femmes, allaient à la Gardette boire sans modération d’une eau purgative, afin d’obtenir, comme on dit. Des bois fort discrets dissimulaient, paraît-il, les effets impérieux de cette médecine naturelle. La source est délaissée et rien n’y marque la reconnaissance des ventres, mais le joli site de la Gardette, ancienne gentilhommière des Arbalestier, n’a rien perdu de sa grâce et de sa fraîcheur rustiques. Assez loin de ]à, dans la plaine quadrillée de pourettes et de haies vives, s’élève une autre demeure populaire. On la reconnaît aux beaux arbres qui l’enveloppent pudiquement dans leur mante. Saint-Fond évoque une face patiente et appliquée, un savant désintéressé qui, tout jeune, écoutait déjà les confidences de nos volcans et que la science salue comme l’un des pères de la géologie moderne. J’ai nommé Barthélémy Faujas, dit Faujas de Saint-Fond, professeur et administrateur du Jardin du Roi. Buffon lui avait légué son cervelet, relique fort propre à exalter une âme moins tourmentée que la sienne par les grands problèmes de la nature. Faujas, né à Montélimar le 19 mai 1741, aimait beaucoup Saint-Fond où il mourut le 18 juillet 1819 après avoir disposé lui-même sa sépulture dans la paix des grands arbres. On lui doit, outre de nombreux ouvrages spéciaux, la découverte de plusieurs mines, celle de La Voulte entre autres, ouverte à ses frais.
Quelques célébrités du crû méritent aussi une mention. A côté des Chancel (15) et des Blancard (16), braves généraux perdus dans le lac rouge de l’héroïsme, il suffit de citer cet âpre Lafaye, né à Loriol en 1610 et pasteur de son église en 1636. Son livre, L’Anti-moine, lancé comme un brûlot en pleine société catholique, dans un Etat à peine remis des troubles religieux et humilié au fond des conséquences de l’Edit de Nantes, devait le faire condamner à ramer toute sa vie sur les galères de Sa Majesté. Mais déjà Lafaye ramait pour son plaisir sur les eaux du Léman, et la Rome protestante, qui l’avait accueilli, eut sa dépouille (1679).
M. Brun-Durand donne également le jésuite Sautel (17) comme enfant de Loriol. En ce cas nous devons rendre hommage à l’un des derniers de nos poètes latins, au représentant endurci et attardé de ces vieilles écoles, qui n’estimaient rien d’honnête hors les productions dans la langue d’Homère ou de Virgile. Contemporain de Lafaye, le bon Père, à la différence du fougueux pasteur, dédaigne la controverse et ignore le maniement de ses flèches cruelles II voit tendre, il voit doux. Tout rose du baiser d’ Erato, il s’en va par les chemins du rêve cueillir la fleur capiteuse. C’est ainsi qu’il compose ses Lusus poetici allegorici… allegorici mot Jeux Poétiques, latineries ingénues, délicates et parfumées dans la manière d’Ovide. On y voit des abeilles tendrement secourables à l’homme, n’est-ce pas? distiller du miel dans le carquois de l’Amour pour que ses traits désormais ne blessent… et l’Amour ne se doute de rien.
La Drôme va mourir. Elle va mourir sans beauté, elle qui a imprimé au Diois ses grands gestes et qui lui a donné le meilleur d’elle-même. Elle va mourir à la façon de ces rivières paradoxales et ardentes qui semblent rouler avec leur flot la fatalité de l’Orient. Sous Loriol, elle est à l’abandon. Nul pont ne la saute et nul enfant ne joue sur ses rives incapables de sourire ; on s’étonne presque de la voir durer encore, tellement sa vallée se confond avec la vallée du Rhône. Ce n’est plus qu’un grand chemin de lumière que les digues accompagnent jusque là-bas par distraction sinon par politesse. Mançanarez; Rivière loufoque; Eau de la soif; Fleuve pour chameaux, on la ménage peu au passage, que l’on descende de la vallée par terre ou par eau.
— C’est çà la Drôme, ai-je ouï dire, qu’on la balaye !
— Pardon, riposte un autre, qu’on l’arrose tout d’abord !
— Eh ! tu es comme Drôme, crie la paysanne à son enfançon goulu dont le mourre jusqu’aux yeux se régale de confiture noire, tu as donc peur que terre te manque ?
Pauvre et bonne rivière, il ne lui manquait plus que d’être bafouée à l’égal d’un simple mortel ! Après cela, si elle ne nous devient pas tout à fait chère, c’est que nous n’avons aucune pitié, c’est que nous n’aimons ni la couleur, ni une belle gueuse. Depuis que nous vivons en compagnie de la Drôme, nous nous sommes fait un peu à son genre d’existence, à ses façons en dehors et un brin canailles. Dites, il ferait beau voir qu’un torrent comme celui-ci, en qui les nomades de la grand’route reconnaissent et saluent l’ami des vieux peuples, l’introducteur dans nos monts bourrus des premières humanités errantes, aille s’embarrasser de vertus bourgeoises. Cela est bon pour les cours d’eau sans tempérament. Nous lui pardonnerons aussi ses rapines, car elle est d’autre part assez naïve, assez prompte à s’ouvrir le flanc. Songez à toutes ses ponctions: canaux à Luc, à Die, à Saillans (18), à Crest, à Livron, à Loriol, béais qui lui soutirent le plus clair de sa vie sans jamais rien lui rendre, ou si peu de chose. On serait pauvre à moins. Encore un coup, nous ne lui en voudrons pas, sous le vain prétexte que le soleil, plus encore que l’eau, lui est nécessaire. Il lui en faut si peu d’onde pour charrier d’or, pour faire son Pactole! Voilà pourquoi, ce me semble, la cigale bohème, symbole de félibres et des fulobres, de poésie et de paresse, recherche l’ombre frivole de ses bords, les rameaux d’acacia ou de tremble que la moindre brise se fait un jeu d’émouvoir, La Drôme, contre toute apparence, tire beaucoup d’eau pure de ses calcaires poreux. Cinquante mètres cubes environ à la seconde en moyenne, d’après les statistiques. Bien de nos pesantes matrones du nord, en servitude et portant bateaux, se montreraient fières d’un pareil module. Mais en vain giclent les fontaines splendides dans cette urne décevante. La Drôme est un peu comme le tonneau des Danaïdes. A Livron, j’ai vu parfois son étiage immédiatement au-dessous de zéro, mais quel déluge par contre, lorsque le vent lombard a crevé sur les montagnes ! Dix huit cents mètres cubes à la seconde. La contrée en tumulte devant l’effroyable galopade d’un flot couleur de fiel hurlant à ses ponts, arrachant ses rivages. Un fleuve de quelques heures, ironique et vertigineux. L’eau en remontrerait à tous les larrons ensemble et nulle force humaine ne saurait arrêter dans ses exploits ce cambrioleur souple qui tout d’abord se glisse dans votre jardin comme s’il voulait vous éviter la peine de l’arroser, puis regarde sous la porte du logis, où il entre sans rien forcer. C’est ainsi qu’en 1856, les populations béantes assistèrent à leur propre déménagement. Aux sons horribles d’un orchestre combiné par le vent et par la vague : des commodes poursuivies par des moutons, des potirons convoités par des porcs, et des chaises, et des tables, et des troncs d’arbres tournaient sans répit sur le flot frénétique. Dans leur danse, tout à coup ces choses se joignaient, se collaient le temps d’une embrassade, puis se séparaient violemment se rejetaient l’une derrière l’autre comme pour on ne sait quelle diabolique farandole. Mais, hâtons-nous de le dire, l’Ardèche et de moindres torrents cévenols, ont bien d’autres crimes sur la conscience, car, outre que la Drôme est fort ample depuis Crest et pourrait quasi oient tenir le Rhône, ses délires s’espacent de plus en plus et sont de moins en moins funestes.
La Drôme se perd entre La Voulte et le Pouzin, villettes ardéchoises, par environ 90 mètres d’altitude. Le Rhône a parcouru 557 kilomètres. Il vient d’entraîner l’Erieux féroce (19) un peu au-dessous d’un gouffre bien connu des pêcheurs (20), et il s’apprête à réduire l’Onvèze de Privas — morne Seine de cette obscure capitale. Logiquement, il devrait passer presque au ras de Livron et de Loriol, dont les territoires constituent un champ traditionnel d’inondation. Cependant, il préfère infléchir à l’ouest, et, tel un bel animal jaloux, gronder dans les jupes grises de la chaîne cévenole, si bien que, sur une carte, notre rivière, sous l’effort d’un delta inscrit entre la ligne de Livron à La Voulte et la belle chaussée de Loriol au Pouzin, a Pair de l’acculer toute seule aux montagnes.
Et ainsi la Drôme rend l’âme en hurlant la soif.

Mon Torrent, je suppose, n’aura fait de tort à personne.. Il raconte la nature et ne vise pas à la science. Il dit ce que j’aime et ce que j’ai senti. En un mot, il sort tout entier de mes promenades dans une région de la vieille Gaule, miraculeusement ignorée. On trouve de tout dans cette nature inachevée : le désert qui fait peur, la foret qui apaise et laisse un goût de mystère, le serein pacage communautaire, enfin tous les types et toutes les tailles de la montagne. Encore que mon souhait drape ici et là bien des croupes nues, bien des vallons teigneux, repeuple et restaure, j’aime cette aridité et cette opulence, ce perpétuel contraste de vie et de mort. O les rochers enflammés, les nids d’aigle laissés par le Moyen âge à la garde du ciel bleu, et les fontaines jaillissantes et la mélodie verte des hêtres ! Souvent je songe à tout cela, puis ma pensée sourit. Elle vient de rencontrer la Drôme qui mène à la vallée terminale, à la grande plaine Sous-le-Vent, la Drôme sauvage qui a parfois toute la saveur d’une caricature…
A l’heure où la plupart des Français, imitant en cela les oiseaux, tendent aux migrations périodiques et fortifiantes, un pays pauvre et neuf, beau et rude comme celui-ci, ne devrait-il pas aimanter quelques cingles d’hommes sages, déserteurs de casinos et chercheurs de solitude ? Certes, sur ses hautes terrasses, sous ses hêtraies et sapinières suspendues dans les plis de ses. vallons, où l’eau jase comme une femme, la fatigue d’un peuple pourrait s’étirer. Mais qui sait? le privilège du Diois, c’est peut-être de demeurer un pays perdu.
Notes
(1) Elle commence à Tain pour finir à Lachamp-Condillac, soit une longueur de 53 kilomètres, d’un étranglement à un autre.
(2) Castrum Liberonis (en 1113) ; de Liurone (en 1157); Livro (1233) . Lyvron (1512).
3) Sorte de dragon qui passait pour fasciner les lavandières du Rhône et les attirer dans sa retraite au fond de l’eau.
(4) Gervais de Tilisbery ou de Tilbury vivait au XIIIe siècle à la cour de l’empereur Othon IV.
(5) Il s’agit de la fameuse guerre dite des Épiscopaux entre les comtes de Valentinois et les évêques de Valence, et qui dura plus de cent ans.
(6) Surnom du Maréchal de Bellegarde.
(7 Hau ! massacreurs, vous ne nous poignarderez pas dans nos lits comme vous avez fait l’amiral (Coligny). Amenez-nous ces mignons godronnès et parfumés, et ils apprendront à leurs dépens qu’il n’est pas si aisé qu’ils pensent de ravir l’honneur de nos femmes !
(8) Ce vignoble important, l’un des premiers traité par l’irrigation hivernale, appartient à M. Morin-Latour.
(9 De 1283 à 1 305.
(10) Il s’agit encore de Jean de Montluc, évêque de Valence et de Die, de 1553 à 1579, conseiller de Catherine de Médicis et plusieurs fois ambassadeur.
(11) Bouchet était en 1789 chef des turcies et levées de la Généralité d’Orléans.
(12) Aurelianus manus ad ferrum, Aurélien-Fer-en-Mains.
(13) Sorte de merle assez commun dans cette région. Son nom est. une onomatopée.
(14) Le tonnerre.
(15) Chancel (Jean Hugues Théophile), général, prit part à de nombreuses campagnes sous la République et sous l’empire.
(16) Blancard (Aimable), fils d’un député du Tiers-Etat du Dauphiné à l’Assemblée Constituante, fit les guerres de la Révolution de 1792 à l’an XI et devint lieutenant-général et baron de l’Empire. ;
(17) Sautel (Pierre Just), né le 12 mai 1613 à Loriol. Chalvet le fait naître à Romans et Rochas à Valence. Il entra de bonne heure dans la C » de Jésus et professa dans l’important collège de l’Ordre à Tournon. Il mourut en 1662.
(18) L’un des deux canaux de Saillans, appelé canal Souvion, a été creusé en 1830 et irrigue la rive gauche.
(19) L’Erieux (70 kilom.), affluent de la rive droite du Rhône, a roulé jusqu’à 4500 mètres cubes à la seconde.
(20) C’est l’abîme le plus profond du Rhône, 25 mètres au-dessous des plus basses eaux.
FÉLIX GRÉGOIRE
