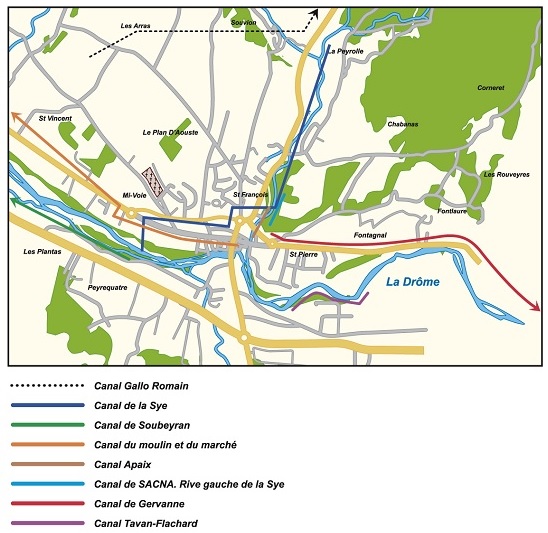Pendant deux heures visitez avec un accompagnateur le centre ancien du village d’Aouste sur Sye (26) en suivant 28 panonceaux explicatifs.
Bienvenue sur le parcours historique
- P 01 – Mausolée romain
- P 02 – Les quatre ponts
- P 03 – Le Petit Lavoir
- P 04 – Place des anges et l’hôpital
- P 05 – Rue de la synagogue – quartier des Enfers
- P 06 – Place des Trois Balcons
- P 07 – Place du Château-Citadelle
- P 08 – Rue des remparts
- P 09 – Vannes du canal Aouste – Crest
- P 10 – Halte-Garderie
- P 11 – Les Sapeurs-Pompiers
- P 12 – Ecole privée Saint Christophe
- P 13 – Station « Azur »
- P 14 – Les rues moyenâgeuses
- P 15 – Place Charmoy
- P 16 – L’Eglise Notre-Dame de l’Assomption
- P 17 – Rue des Moirans
- P 18 – Le Temple
- P 18 bis – Papeterie (en cours d’installation)
- P 19 – La fibre végétale – canal – lavoir
- P 19 – 1 – Le canal et les usines
- P 19 – 2 – La fresque SACNA – LEMBACEL
- P 20 – La résidence Blanchelaine
- P 21 – L’électricité à Aouste
- P 22 – Rue des moulins – Rochefort
- P 23 – Rue de la Croisière
- P 24 – Place de la Poste
- P 25 – Place de la mairie – Ecoles Jules Ferry
- P E1 – Canal Soubeyran
- P E2 – Canal Tavan-Flachard (en cours d’installation)
BIENVENUE A AOUSTE SUR SYE

Bienvenue à Aouste sur Sye, bienvenue sur le parcours de visite du centre historique !
26 panonceaux vous permettront de découvrir une cité habitée depuis plus de 2000 ans.
L’itinéraire est matérialisé par des clous au sol à l’effigie d’Auguste, empereur romain. La cité Augusta Vocontiorum lui fut dédicacée, vers 10 av JC. Le parcours vous conduira du début de notre ère jusqu’ au XX°siècle.

Que sa conduite impériale vous permette une enrichissante visite de cette ancienne étape postale et militaire !
Des informations complémentaires sont accessibles sur le site d’Histoire et Patrimoine Aoustois (histoire-et-patrimoine-aoustois.fr)
Un plan de visite est disponible en Mairie et dans les commerces locaux.
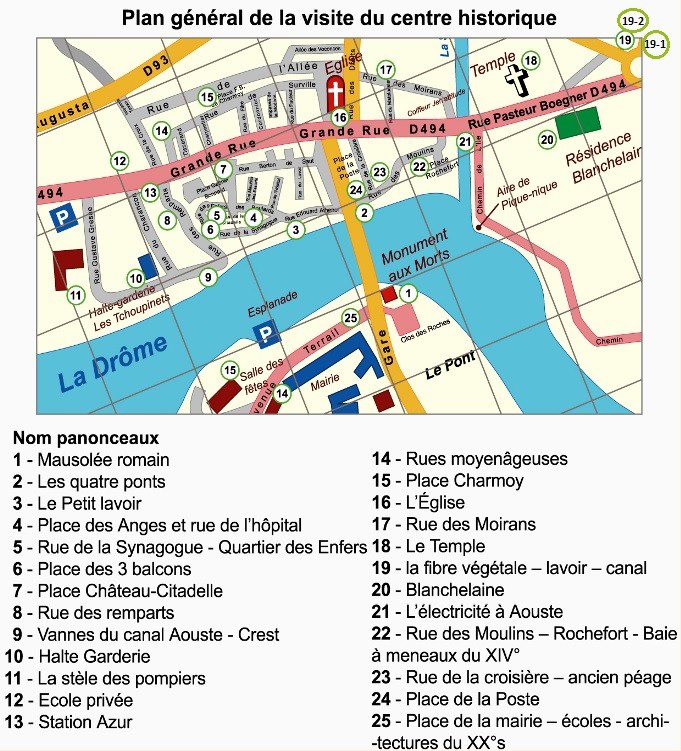
Départ du parcours au pont de la Drôme, près du Monument aux Morts , arrivée par la rue des Moulins


P 01 – MAUSOLEE ROMAIN

ANTIQUITE
Le mausolée mesurait 6 mètres de haut. Il est daté du début de notre ère, il a été taillé dans des pierres du sud du Vercors.
Ces éléments se trouvaient à l’origine au dessus du village actuel, à proximité de la voie romaine; ils ont été retirés de la Drôme et réutilisés pour renforcer le pont roman à la suite des nombreuses et violentes crues de la rivière.
Voici la traduction des inscriptions retrouvée : « Dionysus fils très pieux »« Cnaeus Julius a fait de son vivant »
Le terme « Dyonisus » traduit une influence grecque.

1° photo – vestige romain, socle de la voix centrale du calvaire d’Aouste, formant la partie précédente du vestige découvert par Monsieur Mathieu, en septembre 1952, au bord de la rivière de la Drôme : sur cette pierre une inscription en latin « D M Dionysi Fili ..?.. Vivus fecit ». [ce vestige (pierre de gauche sur la photo ci-dessus) est actuellement placé près du pont de Drôme].
2° photo – vestige romain découvert en septembre 1952, au bord de la rivière de la Drôme ; sur cette pierre une inscription en latin incomplète « Simi ? cn Julius
D’autres épitaphes sont répertoriées sur la commune comme celle ci-dessous, datée du début du 1er siècle, a été retrouvée dans le jardin d’un particulier.
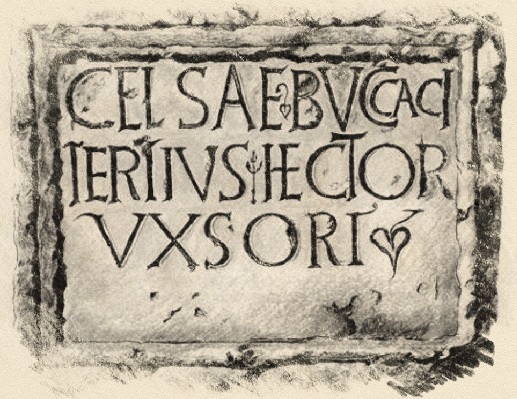

De nombreux autres objets sont le reflet de la vie de la cité
ainsi des sesterces à l’effigie d’Antonin le Pieux.
Quelques autres épitaphes et autels

Sur cet autel antique, auparavant situé derrière l’ancienne église paroissiale conservé ensuite dans une famille d’Aouste, l’inscription en latin suivante « D. M. Et quieti aeter Segudiae maxi Millae Frontia Marciane fil Et Cl. Prima nus gener Ponendum Curaverunt Et sub ascia Dedicaverunt » (Aux Dieux Mânes et à l’éternel repos de Segudia Maximilla. Sa fille Frontia Marciane et son gendre Claudius Primanus ont pris soin de placer ce monument et de le dédier sous « l’ascia (1) »
(1) « dédicace sous ascia » : « dédicace d’un mausolée – mis sous la protection d’un outil,gravé dans la pierre du mausolée, pour assurer son inviolabilité »
Autel antique : un cerf est sculpté sur l’une des faces du monument peut-être destiné à recevoir l’expression d’un vœu consacré à Diane.
Quartier Saint Alban, au sud d’Aouste, un autel au dessus du bassin d’une fontaine, élevé à Jupiter, orné d’une figure de la foudre à l’endroit touché par le tonnerre,les lieux frappés par la foudre étant considérés comme sacrés : détail de l’autel ; inscription en latin incomplète « I O M M. I. S E R V (IDVI Optimo Maximo, M. IuliusServatus) ». (A Jupiter très bon très grand, par Marcus Julius Servatus).

Plaque de marbre blanc (haut 18 cm, largeur 18 cm, épaisseur 4 cm) gravée sur deux faces, conservée au musée de Die. Sur la face A : « ici reposent en paix Rodanicus de bonne mémoire.. » et sur la face B : « sous cette épitaphe repose en paix Ferrola, de bonne mémoire qui a vécu … années ». VIe siècle.

Epitaphe de Gaius Julius Successus. Plaque trouvée dans un cabanon de vigneron,
servant de support à des récipients, conservée au Musée de Die.

Sur une tablette, conservée au musée Calvet d’Avignon, l’extrait d’une inscription en latin « Au nom du Christ, ici repose Ampelius, fidèle serviteur de Dieu et Singénia, qui ont vécu dans l’affection conjugale et la tendresse, 70 ans (?) environ, et sont demeurés tout ce temps dans la paix du Seigneur. Telle fut la pureté de leur vie que durant plus de 20 ans, l’épouse étrangère à son mari, persista dans l’observance d’une continuelle chasteté. Ampelius, de vénérable mémoire, est mort le 16 des calendes de décembre (16 novembre), sous le consulat de Festus et Marcianus. Singénia, de bon souvenir, a trépassé le 6 des calendes de janvier (25 décembre) l’année après le consulat de Victor » (472 ?).
P 02 – Les quatre ponts
Voir aussi : Construire des ponts sur la Drôme
De l’Antiquité à nos jours
Depuis le début de l’Antiquité, la traversée de la Drôme s’effectuait à gué ( vers l’actuelle salle des fêtes). Au début de notre ère, sur les voies Montélimar-Die et Vaison-Valence, les Romains et les Voconces construisent un grand pont de 4 mètres de largeur. Il reste une seule assise. Les colères de la Drôme l’ont détruit.
Après le pont romain, le Moyen-Âge verra la construction d’un nouveau pont, une pile était encore visible au début du XX° siècle. Vers 1860, un pont métallique fut édifié , il permit la création « d’une avenue vers la gare ». En 1940, pour arrêter la progression de l’armée allemande, le génie militaire français fit sauter ce pont, rendant aussi impossible tous les déplacements entre les deux rives de la Drôme. La construction actuelle, en béton armé, à une seule arche d’une portée de 64 mètres, date de 1946. En 1905
En 1905
 En 1910
En 1910
En 1930 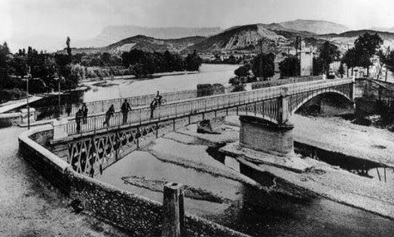
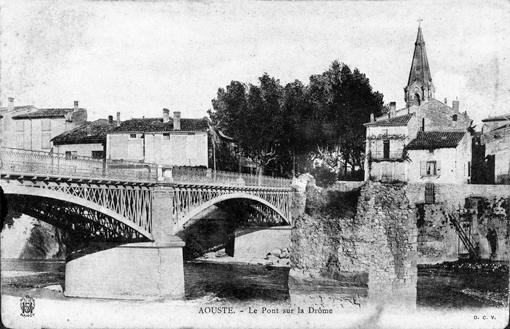
Où l’on aperçoit au premier plan la pile de l’ancien pont roman détruite dans les années 1950

En 1960
 Vestige du pont romain datant du Bas Empire
Vestige du pont romain datant du Bas Empire
Le pont métallique de type Eiffel, détruit le 24 juin 1940, par les troupes françaises pour stopper l’avancée de l’armée allemande


Le pont sera reconstruit de 1941 à 1947, en béton armé avec une seule arche de 65,20 m de portée.



Seconde passerelle provisoire sur la rivière de la Drôme, après la destruction du pont métallique, le 24 juin 1940, par les troupes françaises pour stopper l’avancée de l’armée allemande. La première passerelle construite face à la rue des Remparts a été emportée par une crue de la Drôme en octobre 1940.
Autres ponts d’Aouste

Le pont de Sye en 1913 côté aval

Coté amont


3 – Le Petit Lavoir
Voir aussi :
Afin de lutter contre les épidémies de choléra, variole, typhoïde, une loi du 5 février 1851 demande aux communes l’édification de lavoirs publics ; ces lavoirs couverts facilitent le travail des lavandières : elles peuvent laver et rincer le linge par tous les temps. Les lavoirs ont aussi un rôle social, c’est un lieu de rencontre et d’échange.

Quatre lavoirs ont été construits vers 1890 sur la commune d’Aouste
Le petit lavoir est édifié prés du canal Aouste – Crest


Des publicités d’époque …


Des photos d’objets obsolètes…


04 – Place des anges et rue de l’hôpital
Voir aussi :

Au dessus de vous se trouvent des angelots gravés sur la façade au XVIeme siècle. Les motifs et l’ornementation sont caractéristiques de la Renaissance et de ses inspirations antiques qu’incarnent Michel-Ange, Lescot, Goujon, Cousin… Leur situation dans la partie supérieure de la maison serait elle aussi, une allusion à certaines fresques et décorations des palais religieux de Mantoue ou Ferrare? Au-dessus des hommes et du propriétaire de la maison, les anges symboliseraient la liaison apaisée entre le ciel et la terre.

L’hôpital était installé dans cette rue. La porte d’entrée que vous apercevez à une vingtaine de mètres sur votre droite en était l’un des accès.
Durant les guerres de religion, cet hôpital fut agrandi, sur ordre de Louis XIII puis de Richelieu quelques années avant « la paix d’Alès » (1629).
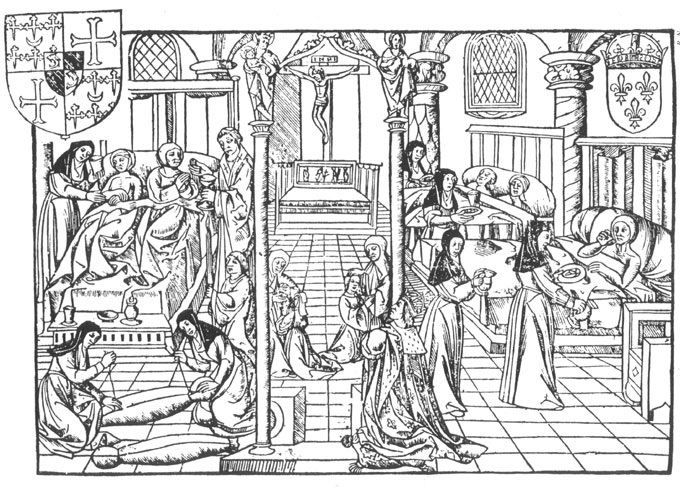

05 – Rue de la Synagogue – Quartier des Enfers
Moyen Âge
Vous entrez dans le quartier des enfers, le centre historique de l’époque moyenâgeuse « d’Aoste ». C’est au début du XIIeme siècle que fut construit près du village « d’Aoste », un château avec fortifications. Autour de la ville était établie une première barrière de protection faite de fossés ou de rivières, puis d’imposantes murailles en pierre formaient une seconde protection. L’accès se faisait par quatre portes. Quatre tourelles permettaient de surveiller les alentours et un donjon trônait dans le quartier des enfers.
Puis, le 15 Août 1146, cette place fut cédée à l’évêque de Die. Il s’engage alors autour de cette forteresse, 130 années de conflit entre les Poitiers, l’évêque de Valence et l’évêque de Die, trois forces rivales et égales possédant les terres voisines « d’Aoste ». En 1277, Amédée du Roussillon envahit le Royaume de Bourgogne et détruit les fortifications.
Au XIVéme et XVème siècle Aoste est une cité prospère vivant d’activités artisanales et de fabrication de canalisations en terre (bourneaux)(1). Cette richesse permit l’installation de banquiers, médecins.(2).. et favorisa la suppression de la dîme en 1550.

Les fortifications ont été ensuite reconstruites ou renforcées (entre autres par Lesdiguères, alors chef protestant).
Cette seconde vie des fortifications sera anéantie par les guerres de religions en 1626. Ce démantèlement a été exécuté sur ordre du roi Louis XIII et avec l’approbation tacite de Lesdiguières (alors chef catholique) suite à diverses accusations de trahison.
(1) Bourneaux

Dans la Drôme, tuyaux en terre cuite conduisant les eaux souterraines, de l’ancien français bournel (« conduite d’eau »)
(2) Médecins à Aouste au Moyen Âge
Dans les Archives de l’Isère, au folio B 4417-4418, on relève la mention d’un nommé Bon Crescas de Callone , médecin juif, qui, en 1361, passa un bail de quinze bêtes à laine, avec un habitant d’Aouste (Drôme) et, en 1413, un habitant de Divajeu (Drôme) loua en partie une maison qui lui avait appartenu.
06 – Place des trois balcons
Moyen Âge

Enserrée dans les remparts, cette place était un lieu très fréquenté : les rez de chaussée servaient de caves ou d’étables ; au nord, les habitations à l’étage étaient aussi exiguës. Il faut aussi s’imaginer la vie quotidienne ici, au Moyen Âge, sur cette place et dans les rues adjacentes: rues étroites sombres, boueuses, avec des animaux en liberté, sans eau courante, avec un ruisseau central et des détritus, et aussi des enfants qui jouent.…
Le balcon coté sud permettait d’accéder à l’étage d’un bâtiment appelé « synagogue » depuis le Moyen Âge. Celle-ci se trouvait prés de ce panneau.
En contournant les constructions par la rue des remparts, on aperçoit les encadrements en pierre de l’ouverture arrière de la synagogue. En 1227, la présence de Juifs est importante. Durant quatre siècles, médecins, commerçants et juristes juifs sont indiqués dans divers documents. A partir de 1350, les Juifs ont joué un rôle important dans l’histoire locale ; en 1473, un docteur en droit quitta « Aoste » pour exercer à Aix en Provence.


07 – Place du Château-Citadelle
Voir aussi :
Moyen Âge
Vous vous trouvez sur l’emplacement d’un vaste bâtiment : le château-citadelle d’Aouste. Avant 1789, ce bâtiment a été utilisé comme mairie-école, totalement délabré, il a été rasé à la fin du XXeme siècle ( 1986). Un pan de mur rappelle un passé mouvementé.
Située sur l’ancienne voie romaine, la citadelle d’Aouste servait aussi de lieu de garnison et d’entrepôt militaire pour les troupes qui firent étapes sur Aouste et les environs de 1651 à 1815. Ces troupes venues de diverses contrées d’Europe ( Italie, Ecosse…) étaient un fardeau pour la population qui devait loger et nourrir hommes et montures. Parfois les soudards pillaient les habitations…. ou le magasin militaire ! 7 à 8000 militaires se trouvèrent en cantonnement en 1626 (la population locale était inférieure à 1000 habitants) : les vendeurs de vin ont été souvent les seuls satisfaits !


08 – Rue des remparts
Voir aussi :
- Le sac d’Aoste, ou le « martyr de la tranquille petite cité d’Aouste »
- La démolition des remparts d’Aouste en 1626 (Récit de A. Maihlet)
- Un épisode peu connu des guerres dites de religion
- Maisons en hauteur
MOYEN ÂGE

Par une nuit glaciale du 23 Janvier 1626, les troupes du roi en attente pour l’Italie, dirigées par le comte de Sault, se présentèrent aux portes du château. Les consuls d’Aoste conscients des intentions de cette visite n’ouvrirent pas la porte aux 800 hommes des troupes royales renforcés par 200 à 300 « hors la loi » de Crest. Après plusieurs heures de lutte acharnée, alors que la cité était déjà en feu sous le poids des boulets et des flèches incendiaires, les portes du château cédèrent et une horde d’assassins et de pillards détruisirent la ville
Le démantèlement des fortifications se poursuivra les mois suivants ; ce fut «le martyr de la tranquille ville d’Aoste »
Seuls quelques vestiges témoignent de cette époque.

Prés de la rue de la synagogue se trouvait le lieu de culte qui serait ensuite devenu « la maison de l’évêque », (une baie géminée est visible rue des remparts). La maison de l’évêque fut aussi, en 1626, victime du pillage des troupes catholiques.
De 1146 à 1626 la ville d’Aoste était confinée entre de hauts remparts. Le long de cette rue sur la gauche en descendant, quelques protubérances de blocs de pierre des remparts laissent imaginer l’importance des murailles.
Les fortifications furent détruites en 1626, l’Edit de Nantes (1598) avait ramené une paix précaire. Louis XIII et Richelieu, soucieux d’asseoir le pouvoir royal, ordonnèrent la destruction des fortifications des bourgs trop peu respectueux de l’Edit. Une lettre de novembre 1622 énonçait ces bourgs. Aoste était sur la liste…

La tourelle en 1910, un des derniers vestiges des remparts qui ceinturaient Aouste. Située à l’angle
de la rue de la Croix et de la rue de l’Allée ; elle a été démolie en 1932.

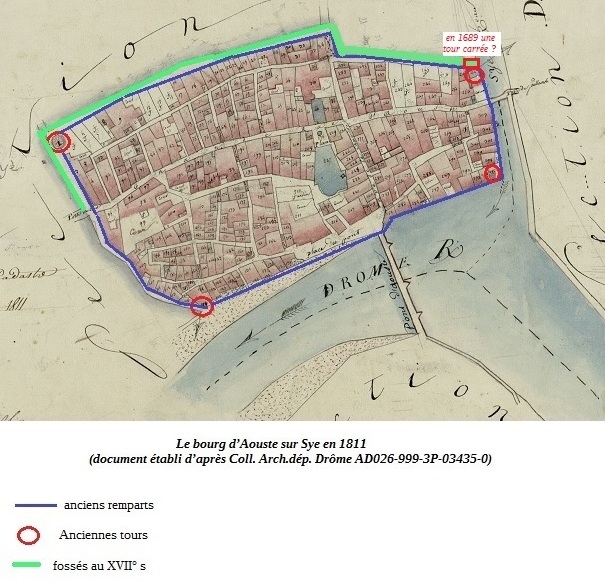
Maisons en Hauteur

Fernand Benoit, archiviste paléographe, archéologue et historien (1892-1969 ), explique que « son originalité consiste à placer les bêtes en bas, les hommes au-dessus ». Effectivement ce type d’habitation, qui se retrouve essentiellement dans un village, superpose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable-remise au rez-de-chaussée, un logement sur un ou deux étages, un grenier dans les combles. Elle était le type de maison réservée aux paysans villageois qui n’avaient que peu de bétail à loger, étant impossible dans un local aussi exigu de faire tenir des chevaux et un attelage.
Elle se retrouve aujourd’hui dans nombre de massifs montagneux ou plateaux de la Provence occidentale.
Ces maisons datent pour la plupart du XVIe siècle, période où les guerres de religion imposèrent de se retrancher derrière les fortifications du village. Celles-ci finies, il y eut un mouvement de sortie pour établir dans la périphérie de l’agglomération des « maisons à terre », plus aptes à recevoir des bâtiments annexes.
En effet, ce type d’habitation, regroupant gens et bêtes dans un village, ne pouvait que rester figé, toute extension lui étant interdite sauf en hauteur. Leur architecture est donc caractéristique : une façade étroite à une ou deux fenêtres, et une élévation ne pouvant dépasser quatre à cinq étages, grenier compris avec sa poulie extérieure pour hisser le fourrage. Actuellement, les seules transformations possibles – ces maisons ayant perdu leur statut agricole – sont d’installer un garage au rez-de-chaussée et de créer de nouvelles chambres au grenier. Pour celles qui ont été restaurées avec goût, on accède toujours à l’étage d’habitation par un escalier accolé à la façade

La présence de terrasse ou balcon était une constante. La terrasse servait, en priorité, au séchage des fruits et légumes suspendus à un fil de fer. Elle était appelée « trehla » quand elle accueillait une treille qui recouvrait une pergola rustique. Quand elle formait loggia, des colonnettes soutenant un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée galaria ou souleria.

Maisons à treille


Passage entre des maisons en hauteur.
09 – Vannes du canal Aouste-Crest
Renaissance
La construction du canal Aouste-Crest débute à l’époque de François 1er.
En 1507, afin de permettre le développement économique de Crest. le cardinal de Tournon ordonne la création d’un canal d’amenée d’eau vers les fabriques de Crest, certains mouliniers crestois sont mécontents de cette concurrence et le canal n’ entrera en service qu’en 1520. Il était alimenté par des barrages installés dans la Drôme, barrages qu’il fallait recréer à chaque crue ; son débit était régulé par diverses vannes de décharge encore visibles, il traversait toute la ville de Crest et se terminait vers Eurre. Cet ancien canal, propriété de la commune de Crest, a été utilisé pour l’ arrosage jusqu’en 1975 . Au niveau de la vanne, on peut constater l’important enfoncement du lit de la Drôme depuis cette époque.
D’autres vannes sont visibles : en amont du pont, à proximité de la MJC Nini Chaize et vers Drôme-Canoë.




10 – Halte-garderie
EPOQUE CONTEMPORAINE

La halte-garderie, construite par la Communauté de Communes du Crestois en 2003 sur un terrain cédé par la commune, a longtemps été gérée par une association . C’est « un bâtiment basse consommation » en « monobriques, chanvre et béton de chanvre » , répertorié « architecture remarquable ».
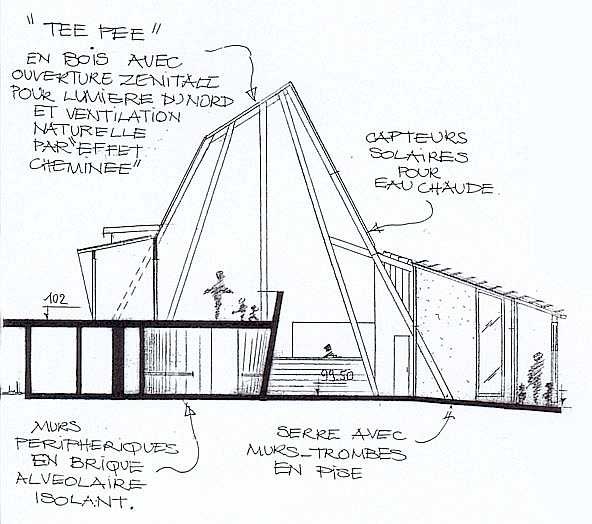
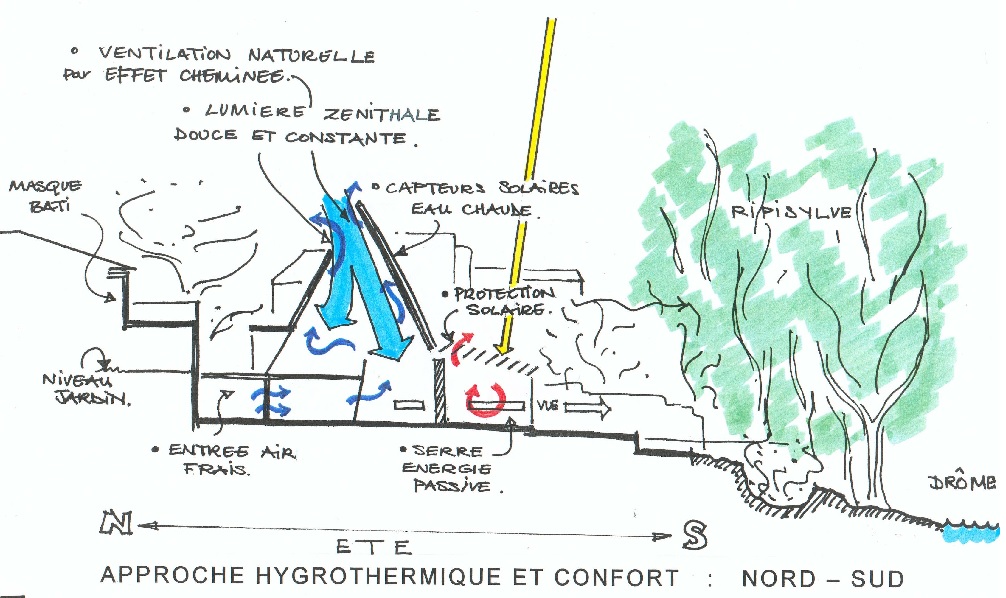
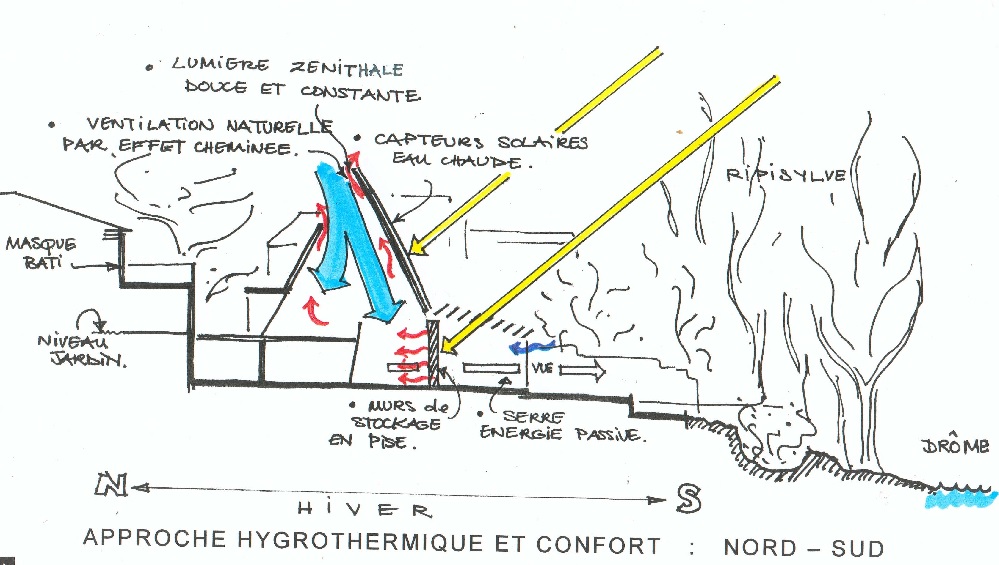
11 – Les sapeurs pompiers
Voir aussi les articles :
- De la section de la Garde Nationale aux Sapeurs Pompiers
- Société de secours mutuels
- Histoire de la caserne des sapeurs pompiers d’Aouste
Article extrait du livre : « Aouste sur Sye … au fil du temps » édité par l’Association Histoire et Patrimoine Aoustois
Fondée pendant la Révolution, la garde nationale était une milice armée.
En 1839 alors que le corps de sapeurs pompiers n’est pas encore créé, la commune fait l’acquisition d’une pompe à feu pour la somme de 1315 francs. Financée par un don volontaire des habitants de 900 francs, le solde sera voté lors de la réunion du conseil municipal du 14 mai 1839. Ce premier matériel sera remisé dans un local situé à proximité du bureau de poste actuel.
A partir de 1845, les gardes nationaux ont aussi une mission de sapeurs pompiers (particulièrement pour la protection des tissages et papeteries) . Le corps des sapeurs pompiers aoustois est créé le 15 mai 1846, il compte 56 engagés.
En 1877, les gardes nationaux-pompiers doivent rendre leurs armes. Le 12 juin 1877, érection en société de » Secours Mutuel des Sapeurs Pompiers ».
En 1976, sous la conduite de Gaston Buis, chef de corps, les sapeurs pompiers participent bénévolement à la construction du rez-de-chaussée de leur caserne (bureau-salle de réunion,, sanitaire et 4 garages). Au fil du temps la toiture-terrasse se détériore et il faut envisager des travaux de protection. Avec la participation financière de l’Amicale des Sapeurs Pompiers, la collectivité décide l’aménagement d’un 1er étage : sanitaires, bureau et grande salle de réunion laissant disponible le rez-de-chaussée pour le secteur opérationnel et permettant les formations départementales. Après 168 ans de services rendus aux populations et regroupement des Centres de Secours, les locaux sont affectés au Centre Social Nini Chaize et agrandis en 2017. Le bâtiment conserve son nom « Gaston Buis ».



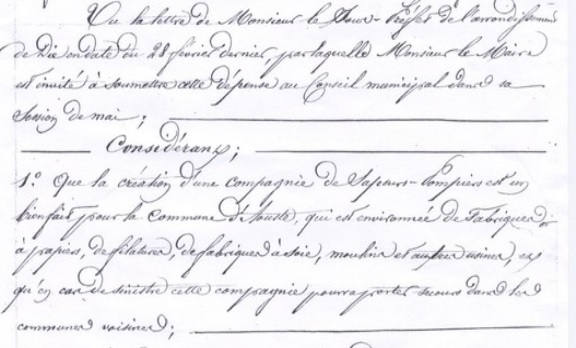
De la section de la Garde Nationale aux Sapeurs Pompiers

Les sapeurs-pompiers dans la garde nationale 1831 à 1870.
Fondée sous la Révolution, la garde nationale est une milice armée. Elle est constituée de citoyens, régie par des règles très particulières pour défendre le régime en place. C’est une « formidable organisation provisoire, sans règlement et sans législation fixe ». Jusqu’en 1871, elle sera tour à tour reconstituée, dissoute, mise en veilleuse.
Louis-Philippe réorganisant la garde nationale y fait entrer les sapeurs-pompiers : « Partout où il n’existe pas de corps soldé de sapeurs-pompiers, il sera, autant que possible, formé par la conseil de recensement des compagnies ou subdivision de compagnie de sapeurs-pompiers volontaires, faisant partie de la garde nationale. Elles seront composées principalement d’anciens officiers et soldats du génie militaire, d’officiers et agents des ponts et chaussées et des mines, et d’ouvriers d’art » (loi du 22 mars 1831).
De 1831 à 1871, les pompiers seront des gardes nationaux, et, dans de nombreuses communes, tous les gardes nationaux seront pompiers.
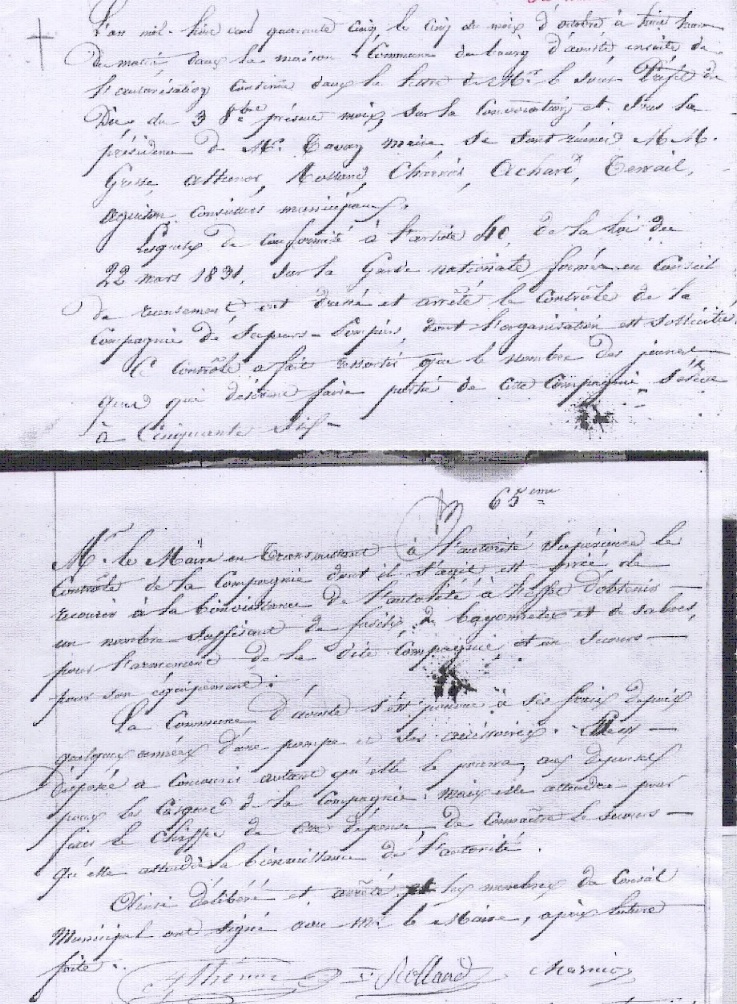
Les sapeurs pompiers à Aouste (1839-2013) :
14 mai 1839 : la commune acquiert une pompe à feu pour la somme de 1 315 francs. Une souscription a rapporté la somme à 915 francs. Par délibération du 14 mai 1839, le conseil municipal sous la présidence d’Antoine Tavan, maire, sollicite le préfet pour l’engagement d’une dépense supplémentaire de 400 francs afin de compléter « le payement d’un objet si précieux pour la commune ». Celle-ci est remisée place de la Poste.
1845 : du 14 au 21 septembre est mis en place le registre de recrutement pour la création du corps de sapeurs pompiers. Le nombre des engagés devra être au minimum de 31, il sera de 56. En tête de ce registre nous pouvons lire « Par leur signature, ils auront contracté l’engagement de s’habiller à leur frais dans les trois mois qui suivront la sanction de l’autorité administrative pour l’organisation de la compagnie et se conformer dès l’organisation au règlement adopté par la compagnie de pompiers de la ville de Crest, sauf ultérieurement à modifier ce règlement, s’il y a lieu, pour le mettre en harmonie avec les besoins de la localité ».
Le 5 octobre 1845 sous la présidence de M. Tavan, maire, se sont réunis M.Gresse, Rolland, Achard, Terrail, Aguiton, conseillers municipaux ; « en conformité à l’article 40, de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale formée en conseil de recensement, ont dressé et arrêté le contrôle de la Compagnie de Sapeurs-Pompiers dont l’organisation est sollicitée . M. Le maire en transmettant à l’autorité supérieure le contrôle de la compagnie est prié de recourir à la bienveillance de l’autorité à l’effet d’obtenir un nombre suffisant de fusils, de bayonnettes et de sabres pour l’armement de la dite compagnie et un secours pour son équipement ».
15 mai 1846 : Le conseil municipal réuni le 15 mai « à effet de voter l’imposition nécessaire pour faire face aux dépenses extraordinaires pour frais relatifs à la création de la compagnie de sapeurs pompiers. Afin de compléter leur équipement et considérant que de grands sacrifices ont été effectués par les sapeurs pompiers pour leur habillement, il est de toute justice de leur venir en aide par le vote d’une subvention exceptionnelle de 900 francs ».
1877 : Le 12 juin approbation de création de la société de secours mutuel des sapeurs pompiers d’Aouste. Le 22 octobre, le Préfet de la Drôme demande au maire d’Aouste de remettre à l’arsenal de Valence, 70 fusils et 61 sabres provenant du désarmement de la compagnie de sapeurs pompiers de la commune.
1926 : adhésion à l’union départementale de la Drôme.
1934 : mobilisation du conseil municipal et de la population pour l’achat d’une moto-pompe.
1938 : achat par la commune d’un véhicule d’occasion pouvant transporter huit hommes. En octobre de la même année les sapeurs pompiers quittent le local de la Poste et investissent le sous-sol de la salle des fêtes.
1941 : réduction de la fréquence des manœuvres en raison des restrictions et pour la première fois on peut donner l’alerte grâce au téléphone (N° appel : le 10 ancêtre du 18).
1944 : suppression des manœuvres par manque de carburant et création d’une caisse de retraite des sapeurs pompiers.
1945 : en raison des restrictions de l’après-guerre aucune festivité ne sera célébrée à l’occasion du centenaire. Les sapeurs pompiers sont réquisitionnés pour laver le coffrage du pont.
1951 : le téléphone est installé aux frais de la commune au domicile de Henri Planchon chef de corps.
1952 : la sirène électrique achetée par la commune sera installée sur le fronton de la salle des fêtes.
1954 : achat du premier matériel de respiration artificielle de marque Panis.
1954 : le premier CCI (Camion Citerne Incendie) équipe les sapeurs pompiers (véhicule de marque Laffly doté d’une pompe de grande puissance (débit de120 m3).

1968 : achat FPT Citroën (Fourgon Pompe Tonne). Destiné en premier lieu aux équipements des Jeux Olympique d’hiver de Grenoble, ce véhicule transportant 3 500 litres d’eau est acquit par la commune.
1970 : le corps des sapeurs pompiers se dote d’un véhicule Renault type Estafette financé par l’amicale. Il sera aménagé « en premier secours ».
1976 : après deux années de travaux, les sapeurs pompiers prennent possession de leurs locaux rue G. Gresse. La participation financière de l’amicale, de la commune et l’engagement physique des personnels ont permis cette réalisation.
1980 : Par délibération, le conseil municipal valide l’acquisition de matériel de « désincarcération » et une demande de « liaison téléphonique spécialisée » permettant une meilleure alerte des secours. Le déclenchement de la sirène s’effectuera depuis le centre de secours.
1982 : achat du véhicule Dodge 6X6 en remplacement du Dodge 4X4 âgé de près de 40 ans (Seconde Guerre Mondiale).
1988 : Avec la participation financière de l’amicale des sapeurs pompiers, débutent les travaux de construction des locaux au dessus des garages.
1991 : achat du CCF 2000 Thomas (Camion Citerne pour Feux Forêts).
1991-1992 : L’aménagement intérieur des locaux du 1er étage est effectué.
1994 : le centre de secours est nommé « Gaston Buis ». Celui-ci, soutenu par Gabriel Bonnard, est à l’origine de la construction des locaux rue Gresse. Son engagement à la cause des sapeurs pompiers est ainsi reconnu.
1996 : mise en place de la départementalisation. Les locaux du premier étage sont réquisitionnés par la mairie au profit de l’entreprise Prolitec. Les 6 et 7 juillet célébration des 150 ans d’existence.

2006 : délibération municipale favorable au regroupement des centres de Aouste et de Crest.
5 décembre 2013 : les portes se ferment une dernière fois après 168 ans d’histoire.
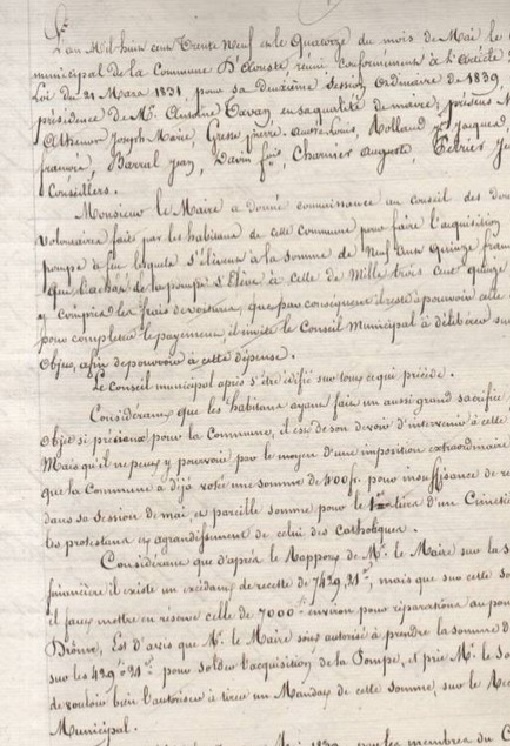
Les Chefs de Corps des Sapeurs Pompiers d’Aouste de 1845 à 2013
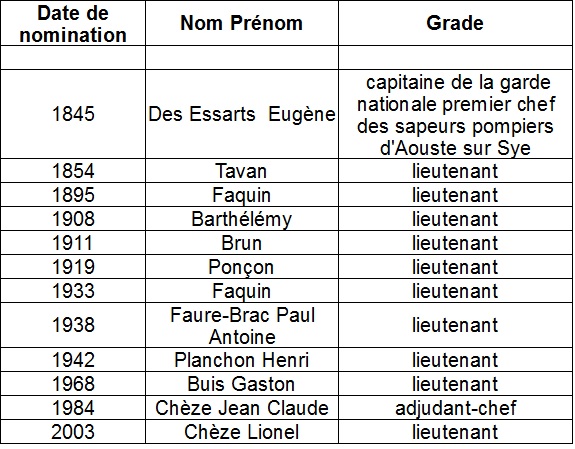
Jean Claude Cheze

Moyennant une cotisation modeste, la société de secours mutuel assure à ses membres une prestation en cas de maladie (remboursement médicaux, pharmaceutiques). Si les réserves financières le permettent, une pension de retraite pourra être versée.
Le 12 juin 1877 la subdivision des sapeurs pompiers d’Aouste s’est réunie, à l’effet de s’ériger en société de « Secours Mutuel des Sapeurs Pompiers », l’effectif est alors de 58 membres. Qui en était président ? Gustave Gresse ?
Chaque sapeur pompier possède un livret individuel dans lequel figure:
1°) le règlement de la société
2°) le signalement (âge, taille, cheveux, front, sourcils, yeux, bouche, nez, barbe, menton, visage, teint et signes particuliers)
3°) les renseignements (lieu de naissance, date de sa naissance, domicile, profession, date d’admission dans la société, date de la délivrance du livret et le nombre de pages composant le livret, y compris le règlement)
4°) cachet de la société et signature du président

Jean Claude Cheze
Histoire de la caserne des sapeurs pompiers d’Aouste
Au XIXe siècle Aouste est une cité prospère et, en 1839, alors que le corps de sapeurs pompiers n’est pas encore créé, la commune fait l’acquisition d’une pompe à feu pour la somme de 1315 francs. Financée par un don volontaire des habitants de 915 francs, le solde sera voté lors de la réunion du conseil municipal du 14 mai 1839. Ce premier matériel est remisé dans un local situé à proximité du bureau de poste actuel ; il sera utilisé durant près d’un siècle. Quelques années plus tard, en 1845, le corps de sapeurs pompiers est créé.
De 1934 à 1938 beaucoup d’évolutions avec l’acquisition d’une moto pompe, d’un véhicule pour le déplacement de 8 hommes permettant aussi la traction de la pompe et aménagement des garages au sous sol de la salle des fêtes.
En 1976 , sous la conduite de Gaston Buis, chef de corps, les sapeurs pompiers participent bénévolement à la construction de leur caserne, un rez de chaussée ( bureau-salle de réunion, sanitaire et 4 garages). Au fil du temps la toiture terrasse se détériore et il faut envisager des travaux de protection. De 1988 à 1992, avec la participation financière de l’Amicale des Sapeurs Pompiers, la collectivité décide l’aménagement d’ un 1er étage : sanitaires, bureau et grande salle de réunion laissant disponible le rez de chaussée pour le secteur opérationnel et permettant les formations départementales.
Une autre salle est édifiée perpendiculairement, à la fin du XXe s.
Le début du XXIe s voit l’installation du Centre Social « Nini Chaize » à l’étage.
Les 168 ans de services rendus aux populations et le regroupement des Centres de Secours à Crest annihilent la présence d’une compagnie de Sapeurs Pompiers à Aouste en décembre 2013. Les locaux sont affectés au Centre Social « Nini Chaize ».
L’année 2017 voit la rénovation et la restructuration de la caserne Gaston Buis avec l’agrandissement du Centre Social et la création de nouveaux locaux pour les associations.





12 – Ecole privée Saint Christophe
Voir aussi : Enseignement congrégationiste et privé, école du quartier Saint-Christophe
Epoque contemporaine
Le bâtiment du quartier Saint Christophe est le reflet des évolutions de l’enseignement et de l’architecture au milieu du XIXeme siècle, géré par les sœurs de Sainte Marthe en 1843, il est bâti sur un vaste jardin et certaines ouvertures sont des réminiscences des baies ogivales.
C’est un bâtiment de deux étages , avec une chapelle dédiée à Sainte Philomène, deux cours: une au nord avec jardin l’autre au sud. En 1843, 4 religieuses gèrent l’école avec pensionnat ; de la fin du XIXeme siècle à 1980, l’école sera dotée d’une classe maternelle. Elle ferme vers 1983, elle abrita ensuite un restaurant et fut rachetée par la commune en 2001.


13 – Station Azur
Voir aussi : le maréchal-ferrant
Epoque contemporaine
Vous vous trouvez face à un lieu qui reflète aussi l’évolution du village; l’atelier du maréchal-ferrant a été remplacé par une station d’essence en 1950.
Le ferrage avait pour fonction la protection du pied du bœuf ou du cheval de trait. On sait par des écrits et des fouilles archéologiques que les Grecs et les Romains protégeaient déjà les pieds des chevaux. C’est au début du Moyen Âge que se vulgarise l’usage du fer cloué, en Europe occidentale.
Le maréchal-ferrant devait aussi savoir forger l’essentiel des outils agricoles.
Vers 1945, le maréchal-ferrant vend aussi de la graisse, huiles, cordes, ficelles carburants ;une pompe à essence se trouvait ici en façade, le pétrole utilisé pour l’éclairage étant distribué dans un autre lieu.
Le bâtiment a été édifié vers 1950, la façade blanche et la retonde sont le reflet des recherches architecturales caractéristiques de nombreuses stations-services dans la vallée du Rhône .
Au sud des maisons se trouvaient l’ église Saint Christophe et son cimetière utilisé jusqu’en 1885 (plan du nouveau cimetière établi en 1883).



Maréchal-ferrant et Station-service Azur

Cette structure, architecture industrielle du milieu du XXème siècle, a été construite en lieu et place d’une maréchalerie et reflète aussi l’évolution du village.Jusqu’à 1950, on trouvait ici l’atelier du maréchal ferrant.
Le ferrage avait pour fonction la protection du pied du bœuf , du cheval de trait et autres équidés et à s’occuper de leur parage. Le ferrage des bovins de trait n’est plus pratiqué.
On sait par des écrits et des fouilles archéologique que les grecs protégeaient les pieds des chevaux par des pièces de cuir, les Romains utilisaient l’hipposandale – lanières de cuir maintenant des plaques métalliques aux bords relevés pour épouser le bord des sabots,- c’est au début du Moyen Âge que se vulgarise l’usage du fer cloué, en Europe occidentale .Les techniques de forge évolueront au cours des ages, le ferrage des bœufs étant plus délicat que celui des chevaux de trait,
Le maréchal ferrant devait aussi savoir confectionner l’essentiel des outils agricoles, pioches, pics, charrues…
Vers 1945, les évolutions des techniques devenues plus rapides, le maréchal-ferrant vend aussi de la graisses, huiles, cordes, ficelles carburants,. une pompe à essence se trouvait ici en façade, le pétrole utilisé pour l’éclairage étant distribué dans un autre lieu. Le bâtiment a été édifié vers 1950, la façade blanche et la retonde sont le reflet des recherches architecturales caractéristiques de nombreuses stations-services dans la vallée du Rhône.
Fin du XXeme siècle , les supermarchés ont éliminé les petites stations et leurs artisans.


14 – Les rues moyenâgeuses
Voir aussi l’article en fin d’article:
MOYEN ÂGE
Si vous observez les façades de la rue Chapoutat, de la Grand Rue, vous pouvez voir que ces maisons traduisent la présence de commerces disparus à la fin du XXeme siècle rappelant nombre d’artisans : cordonnier, tisserand, matelassier, modiste.
La rue de Surville garde encore le souvenir du Moyen Age: outre les galets qui caractérisent les façades vous pouvez observer les ouvertures des maisons ( portes et fenêtres) ainsi qu’une échoppe. Remarquez aussi le travail des pierres aux angles de certaines rues.



Des fenêtres




Modiste
Le modiste imagine un modèle de chapeau, esquisse des dessins puis crée le patron. Il choisit les matériaux à utiliser (feutre, mousseline, lainage, fourrure, paille, sisal, etc.). Le modiste ne conçoit pas toujours le design de ses chapeaux ; parfois, il part du croquis d’un couturier ou d’un styliste.
Dans son atelier, le modiste adapte sa technique à la matière qu’il travaille. Le feutre est moulé sur une forme en bois et façonné à la vapeur à l’aide d’un fer à repasser, d’un fer polonais ou à coque. Le chapeau de paille est conçu à partir d’une tresse de paille. La fourrure est coupée à partir du patron, puis cousue à la machine et à la main. Le sisal, utilisé surtout pour les cérémonies, permet au modiste de sculpter son ouvrage en créant des volumes en trois dimensions.
Les finitions (ganses, surpiqûres) sont réalisées à la main. Les garnitures : voilettes, rubans, plumes, fleurs, perles… viennent ensuite parfaire la coiffe.
Dans sa boutique, le modiste vend sa collection originale mais aussi des articles classiques fabriqués dans des chapelleries industrielles. Il guide les clients vers tel ou tel modèle en fonction de leurs goûts, de leur physionomie et des tendances de la mode.

Bottiers et cordonniers
Les bottiers et les cordonniers appartenaient à la même corporation. Ils avaient le droit de faire et vendre des souliers, bottes, bottines, etc. L’histoire de la chaussure est presque aussi vieille que celle du monde, et pendant le cours des siècles les formes des souliers et des bottes ont, comme chacun le sait, varié à l’infini.
Citons les chaussures à la poulaine, à pointes si longues qu’on les rattachait aux genoux ; les patins, les souliers à crevés, à bouffettes ornées de perles, de grains d’or et de touffes de rubans telles qu’on les porta sous Louis XIV et sous Louis XV ; les souliers à talons rouges réservés à la noblesse ; les souliers à boucles, etc.
Les bottes, dont l’usage se généralisa lorsque l’armure fut abandonnée, prirent, elles aussi, les formes et les noms les plus divers : bottes à chaudron, à la houssarde, à l’anglaise, etc. Par suite de son usage de plus en plus répandu, la botte devint un des termes de comparaison les plus fréquents ; il suffit de mentionner les locutions : Haut comme ma botte ; A propos de bottes ; Y laisser ses bottes ; Mettre du foin dans ses bottes ; S’en soucier comme de ses vieilles bottes ; etc.
A Venise, au seizième siècle, il y eut un ordre de la Botte, de même qu’il y a en Angleterre l’ordre du Bain. Chacun connaît l’usage que Bassompierre fit un jour de sa botte, en y buvant ce qu’on peut bien nommer cette fois le coup de l’étrier. L’absolutisme royal parut même un jour s’incarner dans une paire de bottes : ce fut en bottes de chasse et le fouet à la main que Louis XIV vint signifier ses volontés au Parlement de Paris. Le soulier eut toujours quelque chose de plus pacifique et de plus mondain.

Dessin de Sellier, d’après Abraham Bosse
C’étaient de véritables chefs-d’œuvre que les souliers qui étaient portés à la cour de France sous l’ancienne monarchie. Aussi vit-on Louis XIV honorer le mérite de la corporation des cordonniers dans la personne du sieur Lestage, établi à Bordeaux à l’enseigne du Loup botté, et qui fut à la fois un poète habile et un cordonnier renommé. Louis XIV le nomma cordonnier royal et lui donna des armes parlantes : d’azur à la botte d’or, couronnée de même, avec une fleur de lys de chaque côté.
Ces chaussures si élégantes avaient pourtant certains défauts, elles étaient souvent peu commodes. Ce n’était pas sans raison, par exemple, qu’au XVIIIe siècle les chaussures de femmes inspiraient les réflexions suivantes : « Les divers mouvements des os du pied, qui donnent tant de facilité pour la marche et que l’on voit très libres dans l’état naturel, se perdent d’ordinaire par la mauvaise manière de chausser les pieds. La chaussure haute des femmes change tout à fait la conformation naturelle des os, rend leurs pieds cambrés, voûtés et incapables de s’aplatir : elle leur ôte la facilité de la marche ; elles ont de la peine à marcher longtemps, même par un chemin uni, surtout à marcher vite, étant obligées alors de se balancer à peu près comme les canards, ou de tenir les genoux plus ou moins pliés ou soulevés, pour ne pas heurter des talons de leur chaussure contre terre. Les souliers trop étroits ou trop courts, chaussures si fort à la mode chez les femmes, les blessant souvent, il arrive que, pour modérer la douleur elles se jettent les unes en devant, les autres en arrière, les unes sur un côté, les autres sur l’autre, ce qui non seulement préjudicie à leur taille et à la grâce de leur démarche, mais leur cause des cors qui ne guérissent jamais. »
Les cordonniers formèrent de tout temps, par suite de l’utilité générale de leur profession, une corporation nombreuse et puissante. Elle comptait à Paris, vers la fin du dix-huitième siècle, plus de 1800 maîtres. Elle avait à sa tête un syndic, un doyen, et deux maîtres des maîtres ; elle était encore gouvernée par deux jurés de cuir tanné, appelés aussi jurés du marteau, deux jurés de la chambre, quatre jurés de la visitation royale, et douze petits jurés. Il y avait encore trois lotisseurs, trois gardes de la halle, et un clerc. Le syndic, qui était le chef suprême de la communauté, était élu annuellement et n’était qu’une seule fois rééligible. Les maîtres des maîtres et les jurés restaient deux ans en charge, mais ils étaient réélus par moitié chaque année. Ces élections avaient lieu le lendemain de la Saint-Louis dans la halle aux cuirs, et en présence du procureur du roi ou de son substitut. Les gardes de la halle, qui étaient qualifiés prud’hommes, étaient nommés à vie et étaient tenus de fournir un cautionnement.
Les maîtres cordonniers jouissaient du droit d’étaler leur marchandise, le mercredi et le samedi, aux premiers des sept piliers des halles de la tonnellerie, à commencer par le premier qui était adjacent à la rue Saint-Honoré. Les fripiers leur ayant intenté un procès à ce sujet, le Parlement intervint, et, par un arrêt du 7 septembre 1671, maintint les cordonniers dans la possession de leur droit traditionnel, mais en ordonnant, avec beaucoup d’équité, qu’aucun maître tenant boutique à Paris ne pourrait vendre à la halle aucun ouvrage de son métier, et que seuls les pauvres maîtres non tenant boutique auraient le droit d’étalage, aux conditions néanmoins qu’ils seraient nommés par la communauté, que leurs noms y seraient enregistrés ; qu’à chaque pilier il y aurait deux pauvres maîtres ; qu’ils ne pourraient changer de place qu’une autre ne fût vacante par mort ou reprise de boutique ; qu’ils seraient sujets à la visite des jurés de leur communauté ainsi qu’aux amendes et peines communes aux autres maîtres, en cas de contravention aux statuts et règlements.
Comme tous les statuts et règlements des diverses corporations, ceux des cordonniers étaient assez compliqués. Ils remontaient au temps de Charles VIII (1491), mais ils furent souvent depuis lors l’objet de notables modifications.
Les cordonniers étaient placés « sous les confrairies des glorieux saint Crespin et saint Crespinien. » Pour être reçu à la maîtrise, il fallait avoir été apprenti chez les maîtres de la ville et avoir fait publiquement le chef-d’oeuvre, à l’exception des fils de maître qui n’étaient pas tenus à des obligations aussi strictes. Au sein de la corporation des cordonniers comme des autres corporations, il se forma peu à peu, par suite de cette disposition, une sorte d’aristocratie. Il en était ainsi non seulement à Paris, mais en province.
Voici un extrait des statuts de la ville du Mans ; cet extrait indiquera suffisamment le privilège des fils de maîtres cordonniers : « Et au regard de la création de ceulx qui voudront estre maistres dudit mestier ; et ce fait feront leur rapport à justice de la suffisance ou insuffisance du dict compagnon qui aura besongné devant eulx ; et s’il est trouvé suffisant, il sera créé maistre, en paiant premièrement dix livres tournois et quatre livres de cire pour le droit de confrairie, et leur dîner, etc.
« Quant à la création de la maistrise des enfans des maistres dudict mestiers, les fils d’iceux maistres nez et procédez en loyal mariage pourront estre passez maistres sans qu’ils soient tenus tailler leur chef-d’oeuvre devant les maistres jurez, et pourront iceulx enfans présenter leur chef-d’oeuvre en affirmant par serment qu’ils l’auront taillé d’eux-mesmes et sans fraude ; et ce faisant, sy ledit chef-d’oeuvre est trouvé suffisant par les maistres jurez, il sera receu ; et seront les dicts enfans de maistres créés maistres en paiant premièrement à la confrayrie quatre livres de cire, et aux maistres jurez chacun cinq sols tournois (au lieu de dix livres tournois) et leur disner seullement. »

de cordonnier au XVIIIe siècle
Le compagnon étranger qui épousait la veuve ou la fille d’un maître gagnait la franchise par cinq années de service et pouvait être admis à l’épreuve du chef-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir plus d’une boutique dans la Cet apprenti devait rester chez son patron au moins quatre ans. Tous les maîtres, même les privilégiés, qui vendaient leurs ouvrages aux marchands des halles, étaient tenus de marquer des deux premières lettres de leur nom les souliers sur leur quartier en dedans, les bottes en dedans de la genouillère, et les mules sur la première semelle du talon.
Les compagnons qui avaient contracté un engagement avec un maître ne pouvaient le quitter trois semaines avant les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et la Toussaint, sans doute parce que ces époques étaient celles où les cordonniers, alors comme aujourd’hui, avaient le plus d’ouvrage ; pendant le cours de l’année, les compagnons devaient prévenir leurs maîtres huit jours à l’avance qu’ils désiraient les quitter. Un garçon qui quittait son maître pour s’établir ne pouvait prendre une boutique dans le quartier qu’il avait quitté.
Telles étaient les principales clauses des statuts applicables à tous les cordonniers de la capitale, sauf à une compagnie religieuse de frères cordonniers qui était venue s’établir à Paris vers le milieu du dix-septième siècle, et qui, placée sous la protection spéciale du clergé, n’était pas astreinte aux visites des jurés.
Rapportons l’anecdote relative au peintre grec Apelle qui, ayant profité des critiques d’un cordonnier au sujet de la manière dont les personnages de ses tableaux étaient chaussés, fit à ce cordonnier, qui s’ enhardissait jusqu’à lui adresser des observations au sujet de sa peinture elle-même une réponse qui, traduite en latin, est devenu proverbiale : Ne saler ultra calceam (Cordonnier, pas au delà de la chaussure). Les cordonniers ne suivirent pas toujours ce conseil, et l’on n’a pas à le regretter. Fox, fondateur des quakers, commença par être cordonnier. Linné, l’illustre botaniste, fut apprenti cordonnier ; afin de pouvoir s’acheter des livres, il raccommodait les souliers de ses camarades de l’Université d’Upsal. Le célèbre érudit Balduin avait été cordonnier à Amiens. Jean-Baptiste Rousseau était le fils d’un cordonnier et fut lui-même apprenti cordonnier ; il eut la faiblesse de rougir de sa naissance et prit le nom de Verniettes, où ses adversaires trouvèrent l’anagramme Tu te renies.
La communauté des cordonniers fournit même un souverain pontife à la catholicité ; ce fut Jean Pantaléon, qui, en 1261, fut élu pape sous le nom d’Urbain IV. On rapporte qu’en mémoire de son origine il décida que la chaire de l’église de Saint-Urbain à Troyes où il était né, fût, aux grande fêtes, parée d’un tapis représentant la boutique de son père avec tous ses instruments.
Dans les diverses villes, les communautés de cordonniers avaient en général des armoiries ; c’étaient souvent des armes parlantes. A Douai, par exemple, ils portaient « d’azur à un compas de cordonnier d’or posé en pal dans un soulier aussi d’or. » Au Mans, « d’argent à une botte de sable. » A Grasse, « de gueules à un couteau à pied d’argent emmanché d’or posé à dextre, et un tranchet aussi d’argent emmanché d’or à sénestre, l’un et l’autre en pal. » Ailleurs, comme à Laval, les armoiries représentaient les patrons de la communauté, saint Crépin et saint Crépinien. Dans d’autres endroits, à Bapaume, par exemple, où elles étaient « de sinople à un chef écartelé d’or et de sable », ces armoiries n’avaient rien de particulier.
Les communautés avaient aussi leurs sceaux : ils représentaient, en général, une botte, un soulier, un soulier la poulaine, etc. Le mot cordonnier s’écrivait autrefois cordouanier, de cordouan, qui signifiait, dans le vieux français, cuir de Cordoue, ville célèbre par ses tanneries. Les cordonniers eurent souvent des démêlés avec les savetiers, qui prétendaient former avec eux une seule et même corporation ; mais presque toujours les savetiers se virent déboutés de cette prétention, et la communauté des maîtres carreleurs-savetiers demeura distincte de celle des maîtres cordonniers.
Le matelassier, de la laine au matelas
Le matelassier a installé son métier à carder sur la place du village et s’est mis au travail. Déjà, la laine, nettoyée de ses impuretés après être passée sous cette étrange planche munie de gros clous et mue par la main de l’homme, s’amoncelle. Il y en aura bientôt assez pour confectionner un matelas.
Dans le temps, le matelassier utilisait une cardeuse à main car elle préserve la laine, la rend plus souple, plus soyeuse. Elle ne casse pas la fibre comme le ferait une cardeuse électrique que l’on utilise que pour la laine usagée, car alors elle est plus efficace ».
La confection d’un matelas occupe une journée entière. Après le cardage qui dure de une heure et demi à deux heures, vient le moment important du remplissage de la toile : le matelas est mis en forme et la laine doit être harmonieusement répartie pour un bon équilibrage et assurer par la suite le meilleur confort possible. Il faut 21 à 22 kg de laine pour un matelas deux places.
Cette seconde phase achevée, il passe au long travail de couture des bourrelets qui maintiendront la laine sur les côtés et contribueront à l’esthétique du matelas. Enfin, dernière opération, le capitonnage permet de maintenir la laine à l’intérieur même du matelas, à l’aide de deux capitons de tissus reliés par un fil. On en coud 24 paires pour un matelas de 140 cm.
En fait, rien n’a changé dans la façon de faire depuis des générations, seule l’esthétique a été améliorée. La toile rayée a été remplacée par de la toile damassée (à fleurs) ; les coloris se sont diversifiés. Le matelassier mise aussi sur la qualité de son travail, en augmentant le nombre de capitons, en réalisant des bourrelets plus fins et en utilisant de la laine de meilleure qualité que celle utilisée par nos ancêtres.
Un matelas en laine, on le garde toute sa vie ; il suffit de le refaire tous les quinze ans environ . La réfection de vieux matelas représente d’ailleurs une part importante de son emploi du temps, bien plus importante que celle consacrée à la confection. Il peut fabriquer aussi à la demande des sommiers tapissiers (ressorts, cordage et ouate).
Tisserand
Un tisserand est un artisan qui tisse divers types de fils pour en faire des étoffes. En tapisserie, le tisserand est un créateur d’œuvres textiles, tissées, qui en assure lui-même le tissage.
Certaines traces indiquent que les premiers tisserands remontent au Paléolithique. Les tisserands du Néolithique nous ont laissé des textiles qui ont été retrouvés, par exemple, en Suisse, dans les vestiges d’habitations sur pilotis, ou dans les fouilles de Fayum, en Égypte. À l’époque sumérienne, ce sont des femmes, esclaves qui pratiquaient ce métier. Elles lavaient la laine dans de l’eau chaude savonneuse puis la séchaient. Ensuite, elles battaient les fibres pour en retirer la poussière avant de carder la laine qui était ensuite blanchie et filée. Les fileuses assemblaient les fibres et les torsadaient soit en les frottant entre les paumes de leurs mains soit en utilisant une quenouille. Les esclaves travaillaient ensuite par groupe de trois sur un métier à tisser où elles tendaient les fils puis les croisaient alternativement par dessus et par dessous à angle droit. Dans les campagnes françaises, les tisserands (dit tisserand en toile) sont beaucoup présents jusqu’à la fin du XIXe siècle.
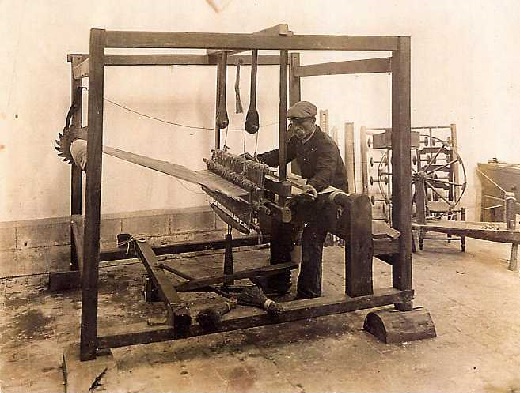
15 – Place Charmoy
Voir aussi :
XIXeme SIECLE
De 1423 à 1860, la sériciculture a été une activité importante dans la vallée de la Drôme, le climat méditerranéen, la minutie des agriculteurs, permettent d’importantes productions; puis diverses maladies, le développement du transport maritime depuis la Chine, la concurrence de nouvelles fibres et la suppression des aides financières amènent la fin du travail de la soie en 1968.
Sur cette place, une grande maison à plusieurs étages, rappelle le rôle de la culture des mûriers dans la vallée de la Drôme, c’est une magnanerie pour « l’éducation des vers à soie ». A la fin du XIXeme siècle, ce bâtiment servit de presbytère protestant, depuis cette époque aussi, une fontaine apporte l’eau potable au quartier.
La place Charmoy honore ce conseiller d’état de l’empereur de Russie Alexandre 1° professeur de persan et de turc à Saint Petersbourg de 1817 à 1836, correspondant des sociétés asiatiques de Paris et Londres. François Bernard Charmoy a joué un grand rôle auprès du tsar pour l’influence culturelle de la Russie sur le Proche Orient, il est décédé à Aouste en 1868.



16 – L’Église Notre-Dame de l’Assomption
Voir aussi :
EPOQUE CONTEMPORAINE
Les matériaux composant l’église contemporaine ont de nombreuses origines :
- Les bases de la façade, les contreforts et les piliers intérieurs sont en pierre de Chomérac.
- Sur ces bases, la bâtisse est en pierre de St Paul.
- Les voûtes, les arceaux et les nervures sont en pierre de Mirabel et Blacons.
- Les piliers du clocher sont en pierre de Tarascon. La flèche est en pierre d’Arles.
- A l’intérieur, les colonnes des autels sont en marbre des Alpes Maritimes, des Pyrénées et de Constantinople.
- Les vitraux ont été réalisés à Lyon.
- L’abside de l’église est considérée comme « une des plus élégantes » dessinée par l’architecte lyonnais Bossan bâtisseur de Fourvière, Ars, La Louvesc… . Celui-ci définissait ainsi son travail d’architecte:« c’est du style greco-romano-gothico !». Bossan a, ici, travaillé avec le cabinet d’architecte Rey de Valence .
- De vives couleurs caractérisent un imposant chemin de croix.
- Les portes en chêne datent du XVIIeme siècle.
La construction a coûté 272 649 francs (de 1870), en partie payée par un emprunt obligatoire.
En 1987, l’église a retrouvé ses couleurs originelles.

l’église Notre Dame de l’Assomption, le jour de la
Libération en 1945
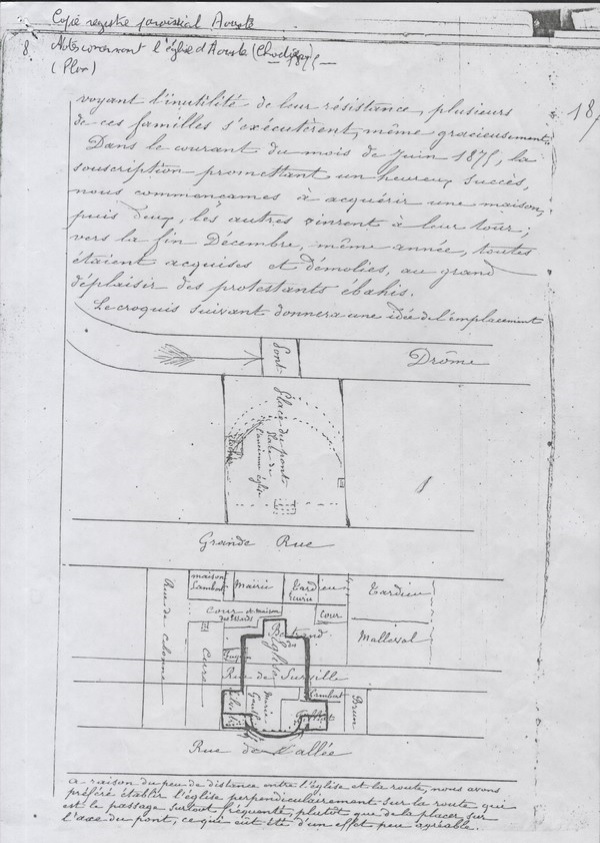
Voir aussi les documents :
1- Documents transmis par M. J. Béranger : « recueil de notes concernant l’église d’Aouste » .
« notes concernant la réparation de l’église d’Aouste 1989 ».
2 – Document transmis par L Sacilotto à la mairie d’Aouste :
« Décompte général des travaux de construction de l’église paroissiale et du clocher ».
3 – Aouste : archives révolutionnaires et 1L 1.
4 – Archives Communales Aouste MN 24.
5 – Abbé A.Vincent, Aoste, Imprimerie M. Aurel, 1856, réimpression Lacour éditeur, Nîmes,1890.
6 – « état financier-nouvelle cure » document de M. Baudoin.
17 – Rue des Moirans
Voir aussi :
- Le tissage
- Le moulin à foulon, premier moulin de l’industrie textile lainière
- Le cardeur
- Corporations de métiers au Moyen Âge
- Des métiers autrefois…
Les murs de droite de la rue étaient, jusqu’en 1622, les fortifications. Au Moyen Âge les fabricants de feutre ( la moire ou « moère » devenue mohair), les tisserands, les foulons, les cardeurs, les imprimeurs sur étoffe et les teinturiers étaient regroupés dans cette rue. A partir de 1450, le feutre servira au séchage des feuilles de papier. De grandes pièces de feutres tournant de manière continue entre des rouleaux sont utilisées dans les machines à papier pour éponger l’eau de la pâte à papier et transformer cette pâte pour former la feuille de papier. Avant le XVIIeme siècle la moire qualifiait un tissu en poil de chèvre.
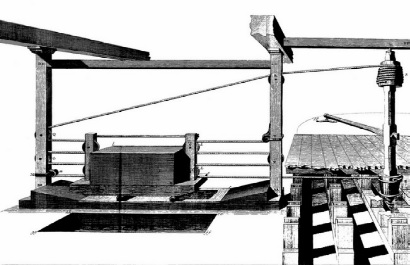

18 – le Temple
Voir aussi :
- Autour de Marc Boegner jeune pasteur de 1905 à 1911
- Sur les pas des « religionnaires fugitifs aoustois »
- Les Pasteurs ayant officié à Aouste
EPOQUE CONTEMPORAINE
Successivement à l’Edit de Nantes, signé en 1598, qui reconnaissait le droit de culte à la religion protestante, les temples ont fait leur apparition. De nombreux temples ont été détruits après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, qui avait octroyé le droit d’exercice du culte aux protestants. En 1791, la liberté de culte est rétablie .
En ce qui concerne le temple d’Aouste, c’est le 13 Août 1833 que fut délivrée l’autorisation royale de construire le temple sur le terrain de M. Latune. Le devis s’élevait à 9218 f. Une aide du « Ministère de la justice et des cultes » de deux fois 1500f et une fois 600f a été perçue pour sa construction.
Le bâtiment très simple est de forme rectangulaire de 9 m sur 16 m ; 8,2 m de hauteur sous plafond, il n’a pas nécessité de plan détaillé,. Le temple devait accueillir 300 personnes assises.
Le temple sera fonctionnel en 1836.
Quatre pasteurs célèbres ont marqué l’histoire locale :
– Daniel Charmier brillant orateur au milieu de XVIIeme siècle, ami du pasteur aoustois De La Faye (fils)
– Tommy Fallot: initiateur de « Christianisme social » à la fin du XIXeme siècle. 70 ans plus tard, son neveu rappelait que « De ses paroissiens pour la plupart modestes cultivateurs ou, à Aouste, ouvriers d’une papeterie ou de fabriques de soie, une communauté fraternelle »
– Marc Boegner, neveu du pasteur Fallot, académicien, a débuté son ministère à Aouste en 1905. « Il a été l’une des plus grandes figures du protestantisme français, l’un des principaux ouvriers du mouvement œcuménique ».
–
Roger Chapal , pasteur de 1936 à 1946, il protégea les Juifs, aida les Résistants avant de composer, avec talent, des chants et de la musique religieuse très connus.


1683/1906 Les temples à Aouste sur Sye
Située sur les importantes voies de communication entre Provence et Dauphiné, assez facilement accessible depuis l’Italie, la Drôme a, de tous temps, été influencée par de grands mouvements d’idées. Les cathares et les vaudois y ont déjà critiqué la théologie catholique. à partir de 1550, les guerres de religion marquèrent l’histoire locale, avec entre autres, la destruction des monastères et couvents par le duc de Montbrun. Dans le Valentinois, le début des guerres religieuses pourrait être daté de 1562 avec la prise de la ville par le Baron des Adrets. L’Édit de Nantes (1598) semble être un compromis très politique rapidement mis à mal par la prise de pouvoir de Louis XIII.
Vers 1675, en France, malgré les brimades, les vexations, les restrictions de célébration du culte (comme les interdictions de sonnerie de cloches) et les exclusions de responsabilités politiques, la population protestante était encore nombreuse ; des Aoustois se souvenaient encore du séjour du pasteur Daniel Charmier officiant en 1659, brillant orateur et gendre d’un éminent théologien genevois. à partir de 1681, la discrimination prend de nouveaux aspects, avec une requête à l’Intendant royal pour obtenir que « la recette des tailles soit donnée à un catholique et non à un réformé » (1). En mars 1681, quelques catholiques, aidés par des cavaliers, envahissent et saccagent le temple, jettent le mobilier et la Bible à la rivière, leurs actes seront impunis. Les protestants sont progressivement exclus de toutes les fonctions officielles. En 1681 et 1682, à Aouste, les curés, châtelains, consuls et notables « certifient pourtant la vie paisible des religionnaires » (1).
En 1683, sur ordre de Daniel de Cosnac intriguant évêque de Valence (à l’âge de 24 ans !) et aumônier de Monsieur, frère du roi, les temples d’Aouste, Montclar, Vercheny, Bouvière, Saillans sont détruits (deux ans avant l’édit de Fontainebleau révoquant l’édit de Nantes).
à Aouste, on renforcera la surveillance de la cité pour « pour empêcher les surprises qu’il pourrait arriver sur les bruits des assemblées que les nouveaux convertis font en divers endroits » (22 février 1689) et le consul dresse aussi procès verbal « contre ceux qui ont lu à haute voix, dans une maison particulière, les psaumes et prières des anciens de la religion réformée ». Le 9 mai 1689, l’Intendant oblige les nouveaux convertis à envoyer leurs enfants aux écoles catholiques et « l’emplacement du temple d’Aouste sera donné à la commune pour bâtir l’église neuve » (1)…
Tout est fait pour éradiquer le protestantisme : impôts supplémentaires, exclusions professionnelles (santé, éducation, administration, etc.), interdiction des livres religieux, interdiction de culte, surveillance et dénonciations, destruction du temple, obligation d’éducation catholique, cimetières distincts, sans parler des adjurations forcées sous peine de pendaison. Ainsi à Aouste, de 1678 à 1767, près de cent familles y seront contraintes (abjuration des personnes de quinze ans jusqu’à quatre-vingt-dix ans). Sur la région de Crest, les dragonnades débutent en 1683 pour se terminer en 1694. Deux Aoustois ayant refusé de se convertir ont été condamnés aux galères ; le tailleur Antoine Rialle y est resté de 1745 à 1773, il a été libéré après abjuration. En 1736, le procès verbal de visite par Joseph de Cosnac, évêque et petit-neveu du précédent évêque, indique qu’à Aouste il y a « une population catholique de 160 familles et 80 nouveaux convertis ». Malgré les risques, les difficultés, les peines encourues (envoi aux galères, condamnation à mort), certains protestants refusent de renier leur foi. Très influencés par la petite prophétesse de Saoû, Isabeau Vincent, ils se réfugient au Désert, fuient en Suisse, en Allemagne ou en Hollande : cette guerre civile a fait dire à Michelet qu’il n’y a « rien de semblable dans toute l’Histoire du monde ». Les archives communales (disposant d’une partie des archives paroissiales antérieures à la Révolution) conservent une affiche signée Jean Antoine Jomaron, Conseiller du Roy et trésorier de France à Grenoble, cette affiche « à apposer à la porte de l’église paroissiale d’Aouste » est datée de 1746 : elle indique les «Biens des religionnaires fugitifs à affermer ». Quatre noms de « religionnaires » y figurent : Pierre Chabert, Anne Brachet, Suzanne Point, Charles Guérin… (1) : « Désastre politique, moral et économique ».
Il faudra attendre 1795 pour que la liberté de culte soit rétablie en France, le Concordat de 1802 organiser aussi le culte protestant.
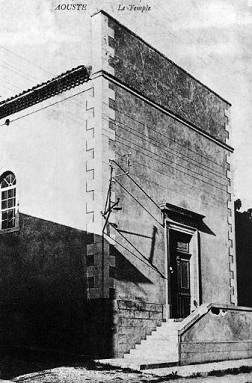
Divers textes, à partir de 1834, traduisent les étapes de la construction du temple actuel :
En 1835 le consistoire de Crest demande au Ministère des cultes et de la justice la construction d’un temple en bordure de la route royale 93 reliant Valence à Sisteron, l’autorisation royale est datée du 13 août 1835.
Le terrain (3 ares 2 centiares) a été cédé par M. Latune, papetier habitant à Crest, pour la somme de 520 francs.
Le devis estimatif note aussi :
« Le temple doit contenir 300 personnes assises, …dimensions : 16 mètres de longueur, 8 mètres de largeur, hauteur sous plafond de 8 mètres …. La construction est si simple qu’on juge inutile d’en faire un plan ».
La souscription volontaire a rapporté la somme de 4232 francs, le devis est de 9218 francs.
En 1836 et 1837, « les secours d’état fournis par le garde des sceaux, Ministre de la justice, secrétaire d’état et de la justice et des cultes » s’élèvent à deux fois 1500 francs (2).
En 1838, autre « secours d’état » de 600 francs (2).
1856 : 251 habitants sur 1254 sont de religion réformée (3) et, en 1861, 300 réformés sur 1215 habitants (4).
La construction fut suivie par le premier pasteur nommé à Aouste, Pierre Servières, né à Nîmes le 30 mai 1808. Il était connu pour « sa moralité, sa piété, sa conduite, ses talents oratoires, et sa doctrine ». Il fut installé dans sa nouvelle paroisse le 20 juin 1834. Il desservait alors Mirabel-et-Blacons, Piégros-la-Clastre, Lambres, Divajeu, Chabrillan, Auriples, Soyans, Francillon, Puy-Saint-Marin, Saoû et Célas. Quelques années plus tard, le pasteur d’Aouste a seulement en charge les communes de Mirabel-et-Blacons, Saoû, Puy-Saint-Martin, Grâne (5).
Par ailleurs, l’exercice des cultes religieux est strictement contrôlé par le préfet, que ce soit la célébration des fêtes officielles, la composition du conseil presbytéral, les indemnités de logement ou la réfection des peintures (5). C’est ainsi qu’une lettre du sous-préfet de Die demande en 1844 à la mairie d’Aouste, de fixer à 300 francs l’indemnité de logement du pasteur, compte tenu que le prêtre résident perçoit, « depuis un temps immémorial » une indemnité de logement de 200 francs et que le pasteur doit se déplacer dans diverses communes : Aouste réglera 125 francs, Mirabel 50, Saoû 75, Puy-Saint-Martin et Grâne 25 chacune (6).
Les deux pasteurs les plus connus qui ont desservi le temple d’Aouste sont Tommy Fallot de 1895 à 1904 – le promoteur du Christianisme social et de la lutte pour le relèvement de la morale publique – et son neveu Marc Boegner qui, de 1905 à 1911, sera l’apôtre de l’unité des chrétiens (7).
Suite à la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, le président du consistoire de Crest, M. Faure, transférera le 23 mai 1906 à l’Association dite Église Réformée d’Aouste représentée par M. Boegner et M. Latune Charles « les biens mobiliers et immobiliers » ; biens répertoriés dans l’inventaire effectué par M. Fontaine inspecteur des domaines à Valence.
Sources :
(1) – Archives Communales Aouste : 1594-1790 : BB 19 et GG 10.
(2) – Copies d’actes originaux et du devis détaillé de la construction.
(3) – Abbé Vincent, Aoste, imprimerie M. Aurel, 1856, (réimpression 1990, C.Lacour Nîmes).
(4) – Archives départementales : recensements Aouste 2MI 2842/R1.
(5) – Courriers concernant les cultes : Archives Communales : MN 24.
(6) – Délibération Conseil Municipal 22 septembre 1844.
(7) – Voir infra l’étude effectuée par l’association Histoire et Patrimoine Aoustois.
A Consulter :
- Relevés d’abjurations des protestants d’Aouste :
- http:// huguenots-France.org/France/dauphine/aouste/abjurations.htm
- http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/religieux/ednantrevocation/htm
- Eugène Arnaud : Histoire des protestants de Crest, Ed. Grassart, Paris, 1875
- Mémoires de frères Gay de Die pour servir l’histoire des guerres religieuses en Dauphiné au XVIe s : Gallica.bnf.fr
Voir aussi la liste nominative, les motifs et les communes d’origine des condamnés aux galères : Musée du Désert, le mas Soubeyran à Mialet (30) et Musée du Protestantisme à Poët-Laval (26)
René Descours
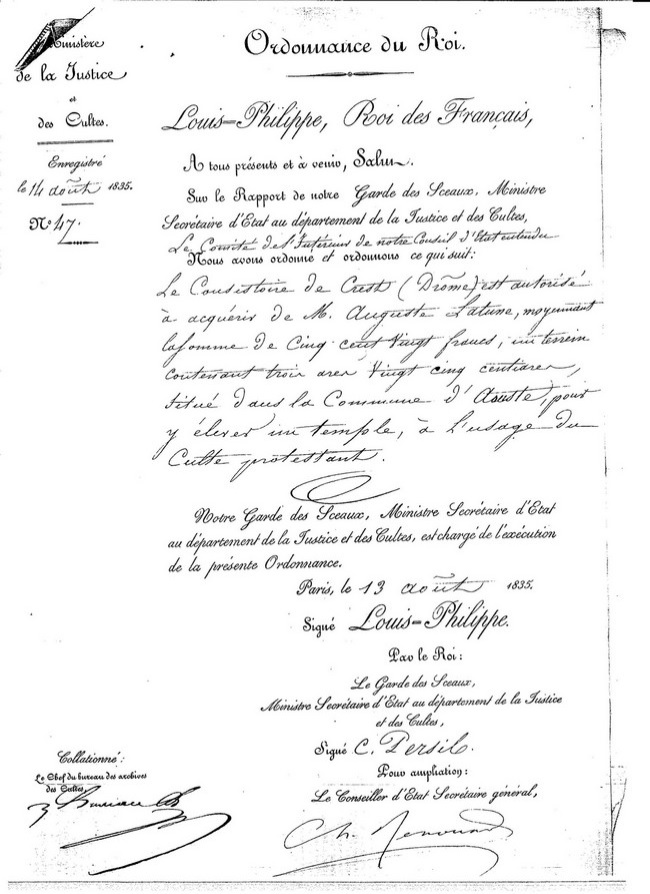
Les Pasteurs ayant officié à Aouste
Le Dauphiné est une des régions de France où le protestantisme a laissé des traces profondes. La Drôme avait une tradition de contestation au pouvoir catholique. De ce fait la Drôme adhère aisément à la Réforme. Dès 1549, la Réforme est prêchée à Valence, à l’église des Cordeliers avec le soutien de l’évêque Jean de Montluc, à Montélimar et Romans
Dans la vallée de la Drôme, pour ce qui la concerne, Aouste était primitivement, au même titre que Euure, une annexe de Crest. Eurre sera adjointe à Aouste en 1671 avant d’être une église particulière.
Comme pasteurs officiant sur Crest-Aouste-Eurre nous trouvons :
- Laurent Vidal 1561,
- Arnaud Casaubon 1562-1568, puis 1570 -1572 (résidant à Eurre),
- Adrien Chamier I 1593 (à Eurre),
- Jacques Barbier 1594,
- Jean de Saignes 1600-1605,
- De 1605 à 1606 Crest était dépourvue de pasteur
- David Agard de Chateaudouble (par intérim) 1606,
- André Guérin 1607-1611,
- Jacques Crespe 1611,
- noble Dragon de Choméane 1612-1613,
- Josué Rossel le fils 1614-1616,
- Alexandre de Vinay 1617-1622,
- Jean Petit 1622 (ou 1626)-1630,
- Alexandre d’Ize ou d’Yze 1635-1642,
- Ennemond Reynaud 1660-1671,
- Isaac Sagnol, dit Lacroix, 1680-1683,
- Charles Gounon 1683
L’église d’Aouste fut longtemps, avec Eurre, une simple annexe de Crest. Dès 1620 elle possédait un temple, et en 1630 le conseil communal lui céda une partie du cimetière commun jusqu’à ce qu’elle fût pourvue d’un autre lieu pour enterrer ses morts. En 1660, elle avait un pasteur en propre Le même conseil ayant émis en 1646 la prétention de faire concourir les protestants à l’entretien de l’instituteur catholique, ces derniers s’y refusèrent, en faisant remarquer que déjà ils supportaient à eux seuls toute la charge de leur régent. Les commissaires exécuteurs de l’édit de Nantes de 1664 se divisèrent sur le maintien du droit d’exercice de l’église d’Aouste ; mais elle put en jouir jusqu’au 17 janvier 1684, alors que le conseil du roi , statuant sur le procès-verbal de partage des commissaires, ordonna la suppression de l’église.
Le 30 mars de la même année 1681, les catholiques d’Aouste, soutenus par quelques cavaliers de la compagnie du capitaine Longpré, se portèrent également de nuit contre le temple, en brisèrent les portes, enlevèrent les bancs, le tapis qui recouvrait la chaire, la Bible et les registres du consistoire et jetèrent le tout dans la Drôme, après avoir démoli une partie ds la muraille de l’édifice. Le marquis de Ruvigny, député général des églises réformées en cour, en porta plainte au roi, qui, prenant sa requête en considération, ordonna, par un arrêt du conseil du 19 mai 1681, que, par les juges du lieu, il serait informé de ces faits et le procès fait et parfait aux coupables, et fit en même temps « très-expresses défenses à toutes personnes de méfaire ni médire contre lesdits de la R. P. R., sur les peines portées par lesdits édits « . Mais ce n’était là qu’une vaine démonstration, à laquelle il ne fut donné aucune suite.
Dès que les protestants eurent appris le triste sort réservé à leur église, ils se mirent en devoir, craignant que leur temple ne fût rasé, d’en descendre la cloche pour la cacher en lieu sûr. Les consuls d’Aouste, qui leur étaient hostiles, les sommèrent sur l’heure d’attendre les ordres de l’intendant avant de disposer de leur cloche, et peu après il leur fut enjoint de la porter à la maison de ville. En 1683, sur ordre de Daniel de Cosnac intriguant évêque de Valence, les temples d’Aouste, Montclar, Vercheny, Bouvière, Saillans sont détruits. L’emplacement du temple, qui avait été adjugé avec les autres biens du consistoire à l’hôpital de Grenoble après la révocation de l’édit de Nantes, fut vendu par ce dernier, le 16 mars 1695 , à un nommé Gaspard, pour le prix de 30 livres. Mais comme l’intendant Bouchu avait, paraît-il, fait don dès 1687, de la part du roi, de cet emplacement aux catholiques pour bâtir une nouvelle église, le conseil communal en réclama la propriété à Gaspard, qui fut sans doute obligé de céder et de perdre ses 30 livres et les constructions qu’il avait déjà élevées sur ledit emplacement. En 1687 Aouste avait 70 familles protestantes et 60 en 1736. Piégros, qui s’y rattachait, en avait 6 à la première date. Cobonne faisait aussi partie de l’église d’Aouste.
Pasteurs :
- Daniel Chamier le fils en 1659
- Théodore de La Faye 1660,
- Abraham Achard 1664 ,
- Isaac Sagnol dit Lacroix 1664.
- Faisan 1671-1672,
- Entre 1672 et 1683 le pasteur de Crest officiait-il ?
- Ranc Alexandre le père dit Lacombe en 1775
- entre 1775 et 1883 ?
A la suite de la révocation de l’édit de Nantes (1685), et, à partir de 1715, les pasteurs ont dû quitter la France. Sous l’impulsion d’Antoine Court, un nouveau corps pastoral se constitue progressivement. Les pasteurs du Désert vont exercer leur ministère dans la clandestinité et au risque de leur vie. Les édits successifs de Louis XIV, confirmés par Louis XV dans sa déclaration de mai 1724 , prévoient la peine de mort pour les pasteurs ou prédicants qui tiendraient des assemblées interdites. L’application varie selon les périodes et selon les régions. Des vagues de persécution suivent des périodes de calme relatif. A partir de 1760, une période de tranquillité relative voit croître rapidement le nombre des pasteurs
Le 13 novembre 1833, Aouste est érigée en poste officiel et se voit rattacher Saou, Auriples, Soyans, Chabrillan, Celas, Mirabel et Blacons, Piégros La Clastre, Lambres, Divajeu, Francillon, Puy st martin comme annexes jusqu’au 18 avril 1846. Le premier titulaire fut P Servière né à Nimes le 30 mai1808.
- Servière Pierre 1834 – 1865
- Brun Pierre Edouard 1865 – 1867
- Roux Léon 1867 – 1871
- Gillouin Emile 1871 -1899
- Fallot Thomas (Tomy) 1899 – 1904
- Rambaud Jules 1905
- Marc Boegner 1905 -1911
- Roger Chapal 1936 -1946
Depuis 2017, le temple d’Aouste est désaffecté, le village ne possède plus de pasteur en titre, et de ce fait les offices sont assurés par le pasteur de Crest.

18 bis – Papeterie (en cours d’installation)
Cette fresque réalisée en 2017 sur un bâtiment d’usine, résume des décennies d’histoire humaine et industrielle.
Deux canaux alimentaient l’entreprise :
La Sye
Le canal de la Sye, rive gauche, dont on aperçoit encore le bassin où se déposaient les impuretés et permettait ainsi la fabrication d’un papier de qualité.
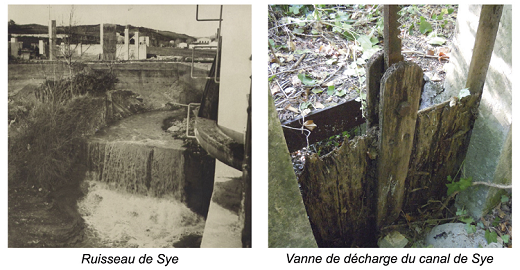
La Gervanne
Le canal de la Gervanne qui, après un parcours d’environ 5 kms, actionnait une turbine fournissant la force motrice de l’entreprise ainsi que l’électricité de la maison du directeur.On aperçoit sur notre droite la vanne de décharge de ce canal.

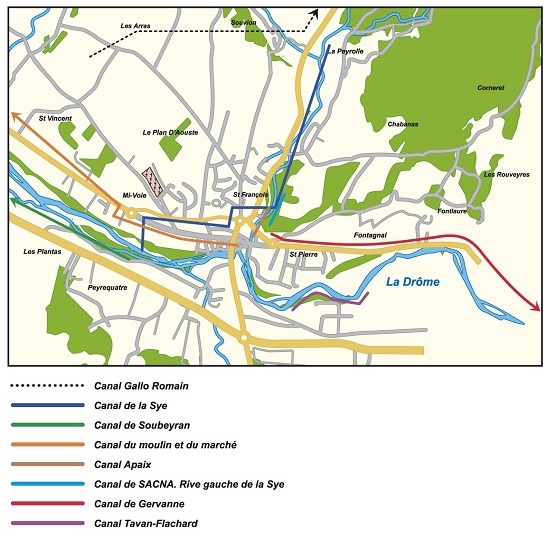
19 – la fibre végétale – lavoir – canal
Voir aussi :
- Un document relatant la fabrication du papier en 1884
- Mémoire de papetier à Aouste de 1685 – 2011
- Le moulin à foulon, premier moulin de l’industrie textile lainière
- La fabrication du papier
La région de Crest est depuis le XVIIeme siècle un secteur de production de papier.
De 1685 à 2011, de nombreux aoustois ont travaillé dans la fabrication du papier. (Voir la fabrication du papier en 1884).
Avant le XVIIeme siècle, à Aouste, l’activité principale était le foulage des draps tissés en lin. Le foulage consistait en une compression des draps entre deux cylindres afin de rendre la fibre plus solide.
En 1850, deux papeteries employaient une part importante des actifs. Elles étaient implantées à la Pialle et à Lembacel (Ici). La fabrication de papier en feuille à feuille était assurée. Les feuilles séchaient, étendues sur des fils. L’excellent qualité « Registre d’Aouste » était recherchée par certains imprimeurs lyonnais.
Puis au début du XXeme siècle, le mode de fabrication du papier en continu apparaît. Et c’est en 1926 que les premiers sacs papiers industriels voient le jour à Aouste (brevet Fisch).
Jusqu’en 1969, l’usine assurait la fabrication du papier et sa transformation en sacs. A cette date la papeterie s’arrête laissant place à la production de sacs de petite et moyenne contenance. Les sacs ont toujours été au centre de la production, l’évolution des marchés a induit de très nombreux perfectionnements techniques, comme l’intégration de poignées sur les sacs ou bien l’impression en quadrichromie.
L’usine ferme en 2011 suite à la mondialisation.
On voit aussi que l’usine utilisait les canaux, comme force motrice et moyen de lutte contre les incendies destructeurs (1911). Aouste-sur-Sye s’est construite et développée autour de l’eau et des canaux. Le premier canal construit à l’époque romaine alimentait villas et cultures. A partir du milieu du XVeme siècle, cinq canaux seront utilisés par les entreprises. La force hydraulique actionnait aussi une usine de billes, un moulinage, un tissage. Agriculteurs et jardiniers profitent de cette ressource. Sont encore visibles diverses prises d’eau, vannes et chutes.
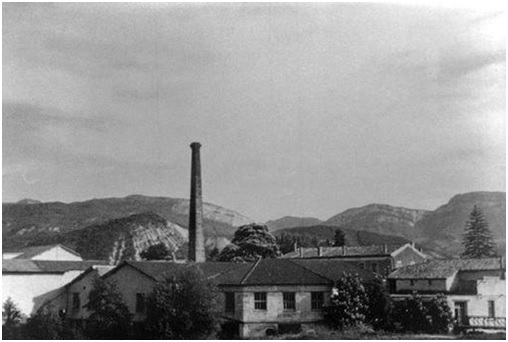

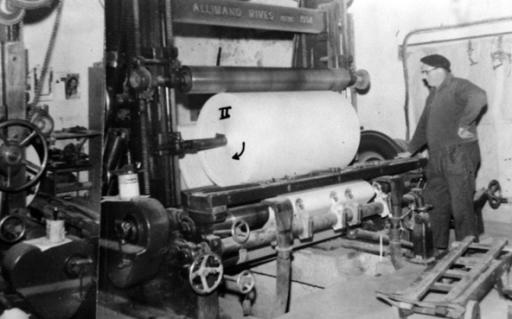
19 – 1- Le canal et les usines
Voir aussi :
- Moulinages de la Sye Emile Rey
- L’usine à billes Barral
- Le moulinage
- La machine à papier et la pâte à papier
- L’usine à billes(deuxième article)
- Le moulinage (deuxième article)
Voir aussi en fin d’ articles
On voit aussi que l’usine utilisait les canaux, comme force motrice. Aouste-sur-Sye s’est construite et développée autour de l’eau et des canaux. A partir du milieu du XVeme siècle, cinq canaux seront utilisés par les entreprises. La force hydraulique actionnait deux papeteries (La Pialle et SACNA-Lembacel), une usine de billes (actuellement sise sur la commune de Mirabel-et-Blacons), un moulinage (Moulinages de la Sye Emile Rey), une usine de tissage (Ets Flachard). Agriculteurs et jardiniers profitent de cette ressource. Sont encore visibles diverses prises d’eau, vannes et chutes.
De même, sur le canal de Gervanne, un lavoir public a été mis en service en 1891



L’usine à billes

Quel enfant n’a pas joué aux billes à la récré ? Même à l’ère du jeu vidéo, tous les petits garçons (et les filles aussi) ont joué ou joueront aux billes à un moment ou à un autre de leur enfance.
Il y a déjà quelques temps que les cours de récréation ne résonnent plus du doux cliquetis des jeux de billes et que les poches des écoliers ne sont plus boursouflées par les agates et les calots mais plutôt par les tablettes de jeux vidéo. Les billes indispensables compagnons de poches ! Autres temps, autres mœurs !
La fabrication des billes est essentiellement industrielle. Seuls trois artisans exercent encore et leurs séries sont de fait des pièces rarissimes. Elles sont très recherchées par les collectionneurs, autre facette du jeu de billes.
Il est presque sûr maintenant que la fabrication « industriel » de bille en pierre débutât en Allemagne (pour l’Europe continentale) au début du XIXe siècle, ces fabriques étant d’abord d’anciens moulins meunier reconvertie en « chiquerie » quand le grain venait à manquer, ainsi le moulin continuer de tourner même durant les mortes saisons.
Les disques des presses étaient en calcaire coquillé tailler par des « rhabilleurs de soleil » avant d’être supplanté par des disques à sillons en fonte. Ce disque, qu’il soit en silex ou en fonte, est rainurés par des séries de sillons concentriques de profondeur identique. La rotation était actionnée par un moyeux légèrement excentré pour imprimer un mouvement elliptique au disque.
La roche sous forme de strate fine de sédiment pouvant facilement être débité de la carrière, elle était le plus souvent en calcaire tendre. Le taillage du cube était effectué au marteau (type Polka) en suivant les lignes de fracture, les plaques de pierre étaient débitées en barrettes puis en cubes. La constance dans la taille du cube était très importante pour la suite des opérations d’usinage.Les cubes étaient ensuite calibrés sur le site de la fabrication avant d’être usinés sous la presse.
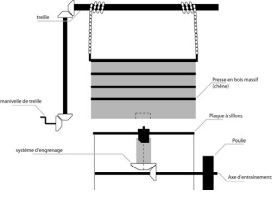

Le temps d’usinage pouvez varier suivant la dureté de la pierre et le nombre de cubes (1h à 3h). Sur une presse on pouvait usiner de 100 unités pour des biscayens à 900 unités pour des mini-billes.
Pour la petite histoire, les « billistes » travaillaient avec un oiseau chanteur dans la pièce, lorsque ils entendaient l’oiseau chanter, on pouvait lever la presse, changer et tourner les cubes.
La fournée étant terminée, les billes étaient ensuite triées sur une table à couloir. Les billes biscornues ou auxquelles manque un fragment sont éliminées à la main avant coloration. 20 à 30 % des billes étaient défectueuses et devait donc être séparées des billes de qualité.
Ensuite, les billes étaient stockées en attendant la coloration.

La coloration est faite sur des grands plateaux circulaire en bois (sans doute …) , les pigments était étaler sur le plateau inférieur et les billes était poser par dessus. Une autre plaque venait plaquer les billes sur celle inférieur. Ensuite une rotation relativement rapide faisait rouler les billes sur la poudre, la friction et la pression provoque un échauffement qui permettez aux pigments d’imprégner la pierre « à cœur ».
L’usine à billes dans la Drôme
Avant 1870, Nancy était la seule ville de France où l’on fabriquai des billes qu’on appelait alors « gobilles ». La fabrique de billes va commencer dans le Drôme.. En 1871, Alexandre Barral marchand de draps à Cobonne se rendît au bord du Rhin et débaucha les habitants d’un village entier d’Alsaciens qui refusaient le joug Prussien, et acceptèrent de s’installer dans la Drôme. A l’origine, il s’agissait d’une société familiale créée en 1876.
« … un jour, le comptable d’un des établissements de ce genre vint à Crest voir un ami, trouva le pays charmant et y fit de nombreuses promenades . Il découvrit de la sorte que le calcaire crestois était éminemment propre à fabriquer des gobilles. Acheter une carrière, s’installer là, fut pour le nancéen , à ce qu’on rapporte , l’affaire de quelques semaines. La fabrique de billes de monsieur Alexandre Barral se trouvait au pied du vieux village. A la veillée, les paysans des alentours taillaient des dés de pierre qu’ils apportaient à l’usine dans de gros sacs en jute. Ces sacs étaient aussi parfois transportés par le chemin de fer. Ces dés étaient disposés sur des disques rainurés et calibrés qui tournaient sous un plot de bois dur (cormier, poirier…), arrosés d’eau et de silice pour les arrondir et les polir. L’usine à billes qui employait une vingtaine de personnes ferma ses portes en 1928.» « …Enfin un jeu original, celle des grévistes et des manifestants de 1934 qui lançaient des billes sous les sabots des chevaux de la Garde.» (Pierre Palengat).
Une autre anecdote: les disques rainurés, une fois usagés, étaient utilisés devant les entrées des maisons comme décrottoirs ou grattoirs par les maîtresses de maison.
En 1876, il décidait de créer l’usine à billes et confiait l’affaire à ses deux fils Joseph et Léopold qui s’investirent et mobilisèrent les Alsaciens pour casser les pierres en petits cubes afin de fabriquer les billes et les calots. Une fois acheminées à l’usine, ces quantités de petits blocs étaient placés sur des presses à sillons qui tournaient en sens inverse. Elles tournaient très longtemps pour arriver à une forme parfaitement ronde et calibrée. C’était la bille entière.


L’usine était florissante, elle comptait une vingtaine d’employés et tournait jours et nuits. Plusieurs générations de Barral se succédèrent pour pérenniser cette petite usine unique en son genre. En 1914, la pénurie d’eau contraînt les frères Barral à transférer l’usine à Mirabel et Blacons, quartier Bellevue (quartier de Aouste jusqu’en 1946), au bord du canal de la Gervanne. Les eaux du canal faisaient fonctionner les turbines. Dans les années 30, la fabrication des billes en pierre, devenue trop onéreuse, est abandonnée au profit de la bille en terre. En argile aggloméré, elles étaient cuites dans de grands fours chauffés au bois puis au coke. La pénurie d’énergie pendant la seconde guerre mondiale imposa l’arrêt de la cuisson.
Les propriétaires (les frères Barral) travaillèrent à la fabrique de billes en pierre jusqu’en 1928, date à laquelle ils se sont orientés vers les billes en terre cuite. Celle-ci cesse en 1935 et durant la Seconde Guerre mondiale, la pénurie de combustible conduisant à abandonner la cuisson. Les billes sont désormais fabriquées avec un mélange de chaux et de ciment artificiel, mais on continue de les appeler « billes en terre » . L’usine tourne toujours mais fabrique dès lors des billes faites d’un mélange de chaux et de ciment artificiel, mais on continue de les appeler « billes en terre ». Face à la concurrence des billes en verre d’origine asiatique et américaine, les Barral sont contraints de fermer l’usine en 1984.
Une nouvelle technique de fabrication (reprise et améliorée aujourd’hui) voyait le jour : un noyau d’abord fabriqué en argile était ensuite aggloméré avec de la chaux et du ciment dans de grosses bétonnières appelées « Courges ». Il fallait environ 7 heures pour atteindre le diamètre définitif. Après plusieurs semaines de séchage sur des trémies, elles passaient au polissage avant d’être peintes et pour certaines, recevoir une couche de vernis et être de nouveau séchées pour être emballées et expédiées. A l’époque, près d’un million de billes étaient fabriquées chaque semaine.
Au milieu des années 80, la concurrence des billes en verre d’Asie ou d’Amérique, beaucoup moins coûteuses, fît nettement ralentir la production et aboutir à la fermeture de l’usine en 1984.

De 1985 à 1998, la bille reste présente dans la région, et donc en France, uniquement sous la forme d’un musée qui lui est dédié, exploité par la famille Guilhot, propriétaire du bâtiment. En 1998, Mr Desbois relance la production de billes en terre en créant la société « Billes et Traditions », mais elle ferme onze ans plus tard, fin février 2009, en raison de difficultés économiques
L’usine de la famille Barral, qui était devenue un musée, va renaître de ses cendres en 1999 grâce à la passion d’un homme pour cette petite boule de terre, et devient ainsi la dernière fabrique de billes en terre de France, et peut-être même du monde. Après un déménagement à Crest (Drôme), la production est repartie, avec le même procédé de fabrication que l’usine Barral en 1940.
L’usine (machines et savoir-faire) est rachetée en mars 2009 par Mr Yves Renou ; il s’installe à Saint Maurice les Brousses, en Haute Vienne, près de Limoges, en créant la société « Billes en Brousse ». Cette fabrique est aujourd’hui labellisée comme « Entreprise du patrimoine vivant ».
Au sein du bâtiment d’origine à Mirabel-et-Blacons, le musée de la bille est aujourd’hui géré par l’association « L’Usine à Billes », qui a pour but sa réhabilitation et la rénovation du bâtiment. Il retrace l’histoire des fabriques drômoises (Saoû, Cobonne et Mirabel-et-Blacons) qui ont été les principales usines françaises de billes à jouer. En 1930 il existait aussi une fabrique de billes à Saou .
Aujourd’hui, face aux billes asiatiques sans âme, un passionné a redonné vie aux billes en terre d’autrefois. Des billes chargées d’histoire à offrir aux petits et aux plus grands.
La fabrication des billes en terre
La fabrication des billes nécessite essentiellement une bétonneuse, qui intervient à plusieurs étapes de la fabrication. Le procédé de fabrication est resté inchangé. Au départ, la bille n’est qu’un grain de sable, gros comme tous les grains de sable, mais protégé par une gangue (« une peau ») d’argile. L’ensemble est de la taille d’une granule d’homéopathie. On met quelques poignées dans une bétonnière, dite également « coucourde » ou courge. Avant elles étaient entraînées par un moulin à eau et maintenant par un moteur électrique. Et à mesure que les grains de sable gainés d’argile roulent dans la machine, on rajoute un mélange de chaux et de ciment, un peu d’eau, on laisse encore et encore tourner l’ensemble, pendant huit heures, et on assiste à la création de billes.


Ce n’est pas simple. Il faut déjà régulièrement transvaser une partie de ces petites billes sombres en formation dans d’autres bétonnières voisines, car en grossissant, elles prennent de plus en plus de volume, et donc de place. Une fois qu’elles ont atteint la bonne taille, les billes sèchent de manière naturelle pendant plusieurs semaines. Elles étaient brunes, elles deviennent grises. Puis il faut les lisser, enlever les aspérités qui les hérissent encore : elles vont recommencer à tourner dans une bétonnière, avec un peu d’eau. La dernière étape est celle de la couleur. Les billes vont tremper dans des bains de couleur : un seul si elles sont monochromes, plusieurs bains successifs pour se couvrir de tâches multicolores.

Depuis le début de la fabrication, c’est donc 5 opérations qui sont effectuées pour réaliser un bel objet. Dixit Mr Guilhot : « 8 à 9 heures de fabrication, et encore, si l’on part du noyau de la bille (qui est secret de famille) jusqu’à la coloration et le vernissage en passant par le temps de séchage, c’est 4 à 6 semaines » qu’il faut pour faire une bille parfaite.





Le Moulinage
Cette activité est une des étapes préliminaires au tissage des étoffes de soie; lesquelles sont produites par des entreprises de tissage de grande renommée, notamment de la région lyonnaise. La fabrication de ces tissus haut de gamme est destinée à des secteurs d’activités très différents (haute couture, ameublement et passementerie et aussi restauration des tentures et mobiliers des monuments historiques).
C’est une opération qui consiste à tordre sur lui-même un fil textile ( soie ou autres) sur un certain nombre de tours par mètre. Elle se fait à l’aide d’une machine appelée « moulin ». Le moulinage n’est qu’une étape concernant le long traitement du fil de soie. Le moulinage est l’industrie qui prend les fils grège à la sortie de la filature et les transforme en fils ouvrés qui seront propres à remplir les différents emplois que leur demanderont les industries utilisatrices.
Grâce à cette opération, on augmente sa résistance et on modifie son aspect. La torsion renforce le fil, on régularise sa section et selon la torsion donnée, le fil obtient plus de résistance, de solidité, d’élasticité et de durée selon l’intensité donnée à la torsion, les tissus constitués prennent un aspect très variable.
Le meilleur système de torsion consiste à déplacer le fil d’une bobine à une autre, à condition que le support receveur tourne moins vite que le support distributeur et que les axes de rotation des deux bobines soient perpendiculaires. La torsion est d’autant plus forte que la différence de vitesse de rotation est grande.
Après la filature qui consiste à dévider le cocon et à réunir plusieurs fils de soie pour lui donner un calibre suffisant, intervient le moulinage. Ce travail permet de consolider le fil et d’obtenir différentes qualités (organsin, crêpe, voile…). Il comprend quatre différentes opérations :
– La première opération est le mouillage qui consiste à assouplir et lubrifier le grès de la soie pour qu’elle se laisse travailler plus facilement et n’use pas les organes du métier. L’eau sera nécessaire pour apporter au fil toute son élasticité et aussi éliminer l’électricité statique qui se forme par frottement de la soie sur les métiers. Pour cette opération, les flottes sont immergées dans un bain tiède de savon neutre et d’huile végétale.
– La deuxième opération est le dévidage qui consiste à enrouler le fil d’une flotte placée sur une tavelle (sorte de roue légère en bois) sur une bobine horizontale appelée roquet.. Ensuite la torsion sur le fil simple se fait sur un « moulin ».
– La troisième opération est le doublage qui consiste à assembler sur une même bobine les fils des roquets. Plusieurs fils grèges ou ouvrés sont mis côte à côte pour obtenir un nouveau fil ayant la grosseur de tous les composants.
– La quatrième opération est le moulinage qui consiste à donner à un ou plusieurs fils un certain nombre de torsions par mètre pour consolider le fil et permettre la fabrication ultérieure de différents tissus.
Enfin le fil est conditionné, à l’issue de l’ouvraison, en flottes identiques à celles de l’arrivée. C’est le flottage : La soie ouvrée, après avoir été tordue, doit être mise en écheveaux ou flottes sur les flotteurs. Quand les flottes sont terminées, elles sont « cappiées » pour éviter que les fils ne s’embrouillent. Puis elles sont retirées du « guindre » et enfilées sur une cheville où elles sont pliées en « matteaux ».

Un ultime contrôle est effectué par un « trieur » dans un endroit fortement éclairé avant l’expédition de la flotte ouvrée.
L’usine assurant cette opération de torsion est appelée « moulinage ». Ces usines étaient de longue bâtisses situées majoritairement près des cours d’eau.
Le moulinage est généralement constitué d’un bâtiment allongé, en fond de vallée, et éclairé d’étroites fenêtres régulières, flanqué d’un canal acheminant l’eau de la rivière qui fournit la force motrice. L’habitation du moulinier et celle du contremaître ainsi que les bureaux et les entrepôts se situent au rez-de-chaussée, côté route. Les chambres ou les dortoirs des ouvrières sont à l’étage. La » fabrique « , ses moulins et ses banques, est installée au sous-sol. C’est une vaste salle à demi enterrée pour maintenir les conditions atmosphériques nécessaires au travail de la soie soit une température de 25° et 85% d’humidité.






19-2 – Fresque SACNA-LEMBACEL

Cette immense fresque de 200 m2 réalisée en octobre 2017 sur trois façades nécessita 25 kgs de peinture acrylique. Le collectif d’artistes graffeurs « Sorry Graffiti » en a effectué l’élaboration, en soulignant, de manière chronologique, les moments forts de l’histoire de l’usine : orner les murs de l’ancienne usine Lembacel, sacherie et imprimerie avec la volonté d’inscrire cette activité industrielle locale dans le temps et à la vue de tous. C’est un hommage à l’histoire papetière et humaine qui s’est exercée à Aouste de 1850 à 2010. Elle perpétue la mémoire de ceux qui ont contribué à l’évolution de l’entreprise. Les transformations et les conditions de travail sont ici schématisées, la présentation des divers logos rappelle aussi les mutations industrielles : la fabrication du papier, ensuite la sacherie de grande, moyenne et petite contenance et, enfin le développement de l’impression.
Cette usine a marqué l’histoire d’ Aouste et de la vallée. Un personnage a retenu l’attention d’anciens employés, c’est celui de Norbert Vallin ( portrait ) : en 1981, il a désapprouvé les responsables nationaux de l’entreprise et a ainsi sauvé le travail d’une quarantaine de personnes à Aouste, ceci …pour une trentaine d’années. Jusqu’à ce que l’entreprise soit intégrée dans un très grand groupe international.
XVeme s. : Papeteries Montgolfier, Jean Montgolfier avait ramené de Damas, au XIIeme s. le secret de la fabrication du papier
Avant 1600 : Présence de foulons à Aouste
1685 : Développement de la fabrication de papier
1729 : Papeterie sur la Sye
1733 : Papeterie Achard
1830 : Papeterie Peloux – début de l’industrie papetière d’ Aouste
1882 : Papeterie Filliat frères
Début XXeme s. : Fabrication papier velin « registre d’Aouste »
1926 : Première fabrique de sacs papier en France
1926 : Création du système à valve pour remplissage automatique des sacs de ciment et encollage des fonds de sac – Brevet Fisch
1927 : Création de la Sacna (Sac National)
1928 : Fabrication des sacs de grande contenance (60cm x140cm)
1965 : Intégration au groupe Lafarge Emballage
1971 : Fin de l’activité papier, démolition de la cheminée et modernisation des machines
1981 : Naissance de Lembacel
1985/1986 : Nouvel équipement (impression sur 7 couleurs et nouveau brevet)
1994 : Rachat par Smurfit
2010 : Rachat par Mondi et décision de fermeture

Deux artistes de « Sorry graffitti » à l’œuvre (le travail de préparation a été élaboré
à partir de diverses rencontres avec des anciens employé de l »usine)

Façade ouest – la fresque – « en pied » de fresque , le bleu rappelle le rôle des canaux dans l’économie locale








Façade Ouest – 6° Vue – Machine à coudre les fonds de sacs-papier

20 – Blanchelaine
Devant vous se dresse une maison bourgeoise du XIXème siècle édifiée en retrait de la route par Charles Antoine Tavan.
La façade du bâtiment d’origine est en galets de la Drôme. Les ouvertures avec encadrements en pierres taillées ont été conservées ainsi que le parc de 7000m2 au sud, avec une vue sur la rivière et Roche Colombe.
Emile Loubet, maire de Montélimar, président du Sénat, 8eme président de la République (1899-1906) y a souvent séjourné.
Propriété de l’Union Départementale des Associations Familiales depuis 1981, elle a été une maison« mère-enfant » puis une Maison Familiale de vacances. Depuis 1986, c’ est une résidence pour personnes âgées.
La bâtisse a été rénovée et agrandie en 1996 et 2016.


LES MÉTAMORPHOSES DE LA RÉSIDENCE BLANCHELAINE
En 1862 a été construite dans un parc de 7000 m2 à l’est du village d’Aouste, entre la route impériale 93 (actuellement RD 93) et la Drôme, une demeure bourgeoise. Cette bâtisse comporte trois niveaux percés de sept ouvertures, la façade est en magnifiques galets et les appartements sont desservis par un couloir central, l’accès se fait en retrait de la route. Le bâtiment au sud donne sur un immense parc arboré jouissant d’un beau point de vue sur la rivière et, au loin, le massif de Trois Becs.
Le premier propriétaire est Charles Antoine Tavan, (banquier à Crest et industriel de la soierie à Aouste sur Sye), celui ci, en 1905 le revend à M et Me Girardon pour 25000 francs. En 1946, l’UDAF, nouvellement créée loue le château de Blanchelaine à Mercurol. Elle déménage «la maison de repos Blanchelaine» à Aouste en 1953. 1955 voit les héritiers de la famille Girardon céder leur bien à l’association Blanchelaine pour 4.300 000 francs. Celle-ci, ayant obtenu l’agrément de la Sécurité sociale, transforme les services en maison de repos mère-enfant, activité qui cessera en 1980. Le 15 décembre 1981, l’UDAF de la Drôme rachète la maison ( 541 918 francs) pour y installer une Maison Familiale de Vacances avec accueil de personnes âgées en hiver, ceci jusqu’en 1985. Dés 1983, l’arrivée d’un jeune directeur a fait évoluer l’image de la maison, Thierry Werlhin veut créer un lieu où il fait bon vivre, une maison ouverte sur le village d’Aouste, intégrée à la vie sociale.
En 1986, l’accueil de personnes âgées devient la seule activité avec hébergement permanent et temporaire. La volonté du directeur est aussi de maintenir les personnes le plus longtemps dans l’établissement , même lorsqu’elle sont devenues très dépendantes. Des études portant sur les années 1982 à 1990 ont montré qu’au niveau du canton, en moyennes annuelles, 66 personnes étaient âgées de plus de 75 ans et ce chiffre allait augmentant . Les années 1995 et 1996 sont alors marquées par d’importants travaux de restructuration , de mises aux normes et d’agrandissement avec accueil de jour, service de restauration pour retraités et salle polyvalente disponible pour associations ou particuliers; le coût des travaux dépassant les 6.000.000 francs, une subvention de 300.000 francs fut versée à l’UDAF par la commune.
Située au cœur du village d’Aouste, la résidence Blanchelaine dispose de vingt huit chambres individuelles. Avec sept nouvelles chambres, la résidence Blanchelaine s’est agrandie, modernisée, restructurée en 2016/2017 et continue à offrir des services variés et adaptés à chaque cas particulier, ceci en liaison avec d’autres associations locales comme le club des anciens, la MJC, l’école ou le prêt de salle aux associations….. Cette volonté d’ouverture sur la vie du village comme les soirées chants, ou l’accueil du carnaval constitue aussi un élément important du bien être des résidents. La taille modeste de cet établissement y garantit un accueil individualisé et convivial.
René Descours

Extrait de « AOUSTE-SUR-SYE … au fil du temps » p 236-237: Association Histoire et Patrimoine Aoustois .éd. Le Crestois 2015 (rééd. 2017)
Sources
- Historique de la résidence Blanchelaine : Mme Souvion UDAF Drôme 1996
- Documents de M Werlhin ( directeur de 1983 à 2010)
- Archives communales 1W3
21 – L’électricité à Aouste
Voir aussi les documents en fin d’article :

Dans cette rue, le long de la Sye, se trouvait un minotier, M. Fernand Apaix qui, afin de moudre le blé, utilisait la force motrice de l’eau ; il eut l’idée de produire aussi de l’électricité. Ayant une production électrique supérieure à ses besoins, il proposa à la municipalité de fournir de l’électricité pour l’éclairage du bourg depuis « le coucher du soleil jusqu’à minuit. L’électricité pourra également servir pour les commerces, la gare, le juge de paix, et les particuliers qui en feront la demande ».
Ainsi, en 1894, Aouste figure parmi les premières communes électrifiées en France avant Lyon et Marseille.
L’électricité

Il y a cent ans l’électricité à Aouste …
Alors que l’éclairage électrique en était encore à ses débuts dans notre pays, alors que les rues de Marseille ne connaissaient encore que les lampes à gaz et que Lyon se préparait à ses premières « illuminations », Aouste était l’une des premières communes de France à connaître l’électrification… voici tout juste un siècle !
« La municipalité de la ville d’Aouste et M. Luc Court, Cie Électriciens Constructeurs à Lyon, vous prient d’assister au banquet qui sera donné le dimanche 25 novembre 1894, dans les salles de l’ hôtel Sylvestre, à l’ occasion de la fête de l’ inauguration de l’ éclairage électrique », telle est l’invitation que reçurent certains Aoustois en cette fin de siècle dernier pour fêter un événement d’importance : l’avènement de la « fée électricité » dans les rues de la cité, mais aussi chez quelques particuliers.
La décision avait été prise le 19 avril de cette même année, au cours d’une séance extraordinaire du conseil municipal et sur proposition du maire M. Gresse. Celui-ci, en effet, fort opportunément avait obtenu de M. Apaix, propriétaire d’une usine à Aouste qu’il consacrât une partie de la force motrice dont il dispose, à donner un éclairage électrique à notre bourg. Il demandait à ses conseillers l’autorisation de signer le traité qu’il avait établi entre lui-même et Frédéric Apaix, meunier à Crest, agissant pour son compte.
Une concession pour 20 ans
En réalité, l’usine aoustoise était une minoterie, tenue par Fernand Apaix, fils de Frédéric, grand-père de Michèle Apaix,. Celui-ci, né le 31 décembre 1853, faisait fonctionner avec plusieurs ouvriers, le moulin situé en aval du pont de Sye (rive droite du ruisseau de Sye). Ces bâtiments devaient appartenir plus tard aux usines textiles Flachard, qui les achetèrent pour y aménager des appartements pour leurs ouvriers.
En 1894 M. Apaix obtenait de la municipalité le droit exclusif d’établir sur ou sous les voies publiques tous conducteurs ou appareils quelconques lui permettant la distribution de l’électricité, soit pour l’éclairage public ou particulier, soit pour tous usages quelconques auxquels peut être employée l’énergie électrique. Cette concession était faite pour une durée de vingt ans. Fernand Apaix produisait en effet pour ses propres besoins l’électricité qu’il obtenait grâce à une roue à aubes et une génératrice. Il venait de s’engager dans une voie qui ne devait pas lui apporter que des avantages, et être même, selon son propre frère, cause de désagrément.
Il était en effet tenu d’établir une canalisation distributrice dans les voies désignées sur le plan et la ville pouvait exiger l’établissement d’un réseau complémentaire. Il était chargé de pourvoir à l’éclairage municipal, celui des voies et des places publiques et celui des bâtiments communaux, par l’emploi des lampes Edison ou tout autre modèle équivalent. De plus, sauf cas de force majeure, le concessionnaire sera tenu d’assurer « la marche de l’éclairage depuis le coucher du soleil jusqu’à minuit ». Depuis 4 heures du soir en janvier et 7 heures du soir en juin en reculant progressivement l’heure du début.

Des conditions draconiennes…
Le prix de l’éclairage était fixé à 32 francs par an et par lampe de seize bougies, le remplacement des lampes mises hors service par le passage du courant étant à la charge du concessionnaire, le nombre de lampes est fixé au minimum à 25 ». La ville avait quand même à sa charge les consoles ou candélabres ainsi que les formalités administratives, mais pas les frais de raccordement des lampes à la canalisation. De plus, on pratiquait des constatations relatives au pouvoir éclairant et tout arrêt donnait lieu à des retenues ! Les bâtiments communaux devaient avoir des lampes intérieures, de 16 ou 10 bougies (unité pratique d’intensité lumineuse) et la ville avait prévu 6 lampes supplémentaires sur la place du Pont qui devaient être éclairées gratuitement la veille de Noël, le 14 juillet et les 2 jours de la fête votive. En outre, dans toutes les voies qui comportent une distribution, le concessionnaire sera tenu de fournir de la lumière aux particuliers qui en adresseront la demande et souscriront une police d’éclairage de cinq années.
M. Apaix avait tout de même la faculté de dénoncer son traité au bout de la cinquième année. Ce qu’il fit, en signifiant par huissier son intention de cesser l’éclairage, arguant notamment des sacrifices considérables qu’il aurait à faire pour se conformer au cahier des charges s’il était tenu coûte que coûte de fournir du courant alors qu’en temps de sécheresse et au moment des arrosages, il manque de l’eau au canal et que dans ce cas il devrait recourir à une machine à vapeur.
Cinq cafés éclairés !
Le maire insista car « il eut été déplorable de nous retrouver dans la plus complète obscurité » et modifia le cahier des charges. En cas de manque d’eau et de lumière, il ne sera soumis qu’à une retenue proportionnelle ! Et chaque année la commune et M. Apaix auront le droit de dénoncer la concession. C’est ce qui fut décidé le 5 novembre 1899.
La production était toujours très artisanale. Un employé était chargé de la marche de la roue hydraulique et devait donc régler l’arrivée d’eau en provenance du canal, protégée par une grille. Celle-ci pouvait s’obstruer facilement (notamment en automne avec des feuilles) et l’ouvrier devait donc « dégriller » de temps en temps au risque d’être la cause d’une baisse de tension du courant. Ce qu’il faisait en surveillant, dans le café, où il jouait aux cartes, la baisse de l’intensité lumineuse de l’ampoule qui y brillait. Au début, se souvient un habitant, les cafés étaient parmi les seules habitations bénéficiant de l’éclairage tout comme la grande rue était la seule illuminée.
Dans un cahier de comptes tenu par F. Apaix pour la période allant de 1907 à 1911, on recense 21 abonnés (les mêmes pendant ces quatre ans), avec parmi eux cinq cafés, une épicerie, le boucher Gresse, le boulanger Arthaud, le menuisier Martin, le coiffeur Servant, le quincaillier Pestre, un juge de paix nommé Roux, la gare. On y voit que certains cafés consommaient six fois plus d’électricité que les particuliers, quatre fois plus qu’un de leur confrère et deux fois plus que la gare.
Mais en mars 1911, F. Apaix allait cesser d’être le fournisseur de la commune. Dans une séance extraordinaire du 6 mars 1910, présidée par Amédée Terrail, maire du village, il était décrété que « le service d’éclairage ne répond plus aux besoins actuels et que M. Apaix ne peut pas améliorer cette situation ». Un nouveau traité devait alors être passé avec MM. Breynat et Merle, industriels, domiciliés à Chabeuil.
Pour F. Apaix une page allait être tournée ; la minoterie à cylindres resterait sa seule activité, jusqu’en 1918 où le moulin s’arrêterait.
Grâce à lui, Aouste avait eu son heure de gloire. Elle avait pris de vitesse des villes comme Lyon, qui fut électrifiée fin 1894 , Marseille (l’exposition date de 1908) et même Paris pouvait-on lire dans notre journal, au mois de février 1967, ce dont nous n’avons pu avoir confirmation auprès des archives de la capitale !
E A Voreppe
Lampe à incandescence classique

La lampe à incandescence classique, inventée en 1879 par Joseph Swan et améliorée par les travaux de Thomas Edison, produit de la lumière en portant à incandescence un filament de tungstène, le métal qui a le plus haut point de fusion (3422 °C). À l’origine, un filament de carbone était utilisé, mais ce dernier en se sublimant puis en se condensant sur le verre de la lampe, opacifiait assez rapidement le verre.
En présence de dioxygène, le filament porté à haute température brûle instantanément, c’est la raison pour laquelle, ce type de lampe a été muni d’une enveloppe de verre qui permet d’isoler un milieu sans oxygène : l’ampoule, qui a donné son nom populaire au dispositif, est protégé par une enveloppe en verre, destiné à fabriquer de la lumière à partir d’électricité.
À l’intérieur de l’ampoule, on trouve soit un gaz caractéristique du type d’ampoule : gaz noble souvent du krypton ou de l’argon ; soit le vide.
Inéluctablement le filament surchauffé se vaporise et perd de la matière par sublimation, ensuite cette vapeur de métal se condense sur l’enveloppe plus froide. L’ampoule devient de plus en plus opaque et le filament devient plus fragile. Le filament finit par se rompre au bout de plusieurs centaines d’heures : 1000 heures pour une lampe classique, jusqu’à 10 fois moins ou 8 fois plus pour certaines lampes à usage spécial.
La présence d’un gaz noble à l’intérieur de l’ampoule présente plusieurs avantages : certains atomes de tungstène devenus gazeux peuvent se déposer à nouveau sur le filament après un choc avec un atome de gaz noble, allongeant ainsi sa durée de vie. Le filament peut aussi être chauffé davantage. Enfin, cela limite le dépôt de tungstène sur la paroi de l’ampoule.
Dans les lampes actuelles, le filament de tungstène est enroulé en hélice, afin d’augmenter la longueur du filament, et donc la quantité de lumière visible produite.
La forme la plus classique de lampe à incandescence est l’ampoule « bulbe », mais on trouve également d’autres formes, dont celle de tube appelée linolite.

Chronologie de la lampe à incandescence classique
1835 : James Bowman Lindsay présente un prototype de lampe électrique lors d’une assemblée publique à Dundee (Écosse). L’ampoule est posée sur le culot et offre une puissance lumineuse adaptée à la lecture. Il ne protège pas son invention et ne développe pas la technologie au-delà du prototype.
1838 : Marcellin Jobard suggère qu’un filament de carbone, placé dans le vide, et parcouru par un courant électrique pourrait émettre une lumière intense, à destination des mines. L’idée est reprise par l’ingénieur français Charles de Changy qui réalise une lampe électrique à filament de platine en 1858. Le filament brûle à l’air libre et non dans le vide.
1850 : Joseph Swan commence à travailler sur une ampoule utilisant un filament de papier carbonisé ou un gros fil de coton, préalablement parcheminé par son immersion dans l’acide sulfurique concentré, en forme de boucle.
1872 : les premières lampes électriques à fil placé dans le vide sont les lampes dites « russes » d’Alexandre Lodyguine.
1876 : Henry Woodward brevette un premier système de lampe électrique.
1878 : Joseph Swan dépose un brevet de lampe électrique. Sa maison à Gateshead, Angleterre, est la première dans le monde à être éclairée par une lampe électrique. En 1890, il existe plusieurs types de lampes Swan à incandescence donnant l’intensité de 3, 10, 16 ou 32 bougies.
1878 : Thomas Edison fonde la Edison Electric Light Company.
1879 : Thomas Edison dépose un brevet de lampe électrique constituée d’un filament de bambou du Japon sous faible tension dans une ampoule de verre sous vide, après avoir testé 6 000 substances végétales du monde entier, avec un budget de 40 000 dollars. Le 31 décembre, plus de trois mille personnes assistent à la première démonstration publique des nouvelles ampoules au Menlo Park du New Jersey, l’expérience prouvant la validité de la lampe à incandescence. En 1890, il existe deux types de lampe à incandescence Edison, l’une donnant une intensité de 16 bougies, l’autre de 10 bougies. Elles brûlent, en moyenne, mille heures, avant d’être usées.

de Thomas Edison (1879).
1880 : Edison obtient le brevet n° 223 898 de l’US Patent, intitulé « Electric lamp », qui lui confère un monopole virtuel sur l’industrie de la fabrication des lampes électriques à incandescence à filament de carbone.
1881 : Joseph Swan fonde la Swan Electric Light Company.
1881 : Lewis Howard Latimer, ingénieur de la Edison Company, remédie au problème majeur de l’ampoule à filament en bambou, qui grille au bout de 30 h. En 1881, il brevette donc, avec son ami Joseph V. Nichols, la première ampoule à incandescence avec filament de carbone puis obtient, seul, en 1882, un brevet pour son procédé de fabrication et de montage de filaments de carbone.
1882 : en Angleterre, Thomas Edison et Joseph Swan fusionnent leurs entreprises pour former la Edison and Swan Electric Light Company (en) ou Edi-swan.
1898 : Carl Auer von Welsbach parvient à remplacer le filament de carbone par un filament métallique beaucoup plus lumineux et durable. En 1906, il met au point le filament osmium-tungstène.
2008 : Le 8 décembre, les États de l’Union européenne approuvent l’interdiction progressive des lampes à incandescence classiques à partir du 1er septembre 2009 jusqu’à leur abandon total en 2012. Le passage à des méthodes d’éclairages moins dépensière en énergie permettrait de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 15 millions de tonnes par an.
Sources :https://fr.wikipedia.org/
De la lampe à huile à la LED

L’éclairage a toujours été une grande préoccupation pour les hommes. Lucy, Archimède, Louis XIV et Napoléon ont tous été confrontés à l’impossibilité de jouir d’un éclairage artificiel équivalent à celui du soleil. Ce n’est que depuis quelques décennies que les hommes possèdent des sources lumineuses émettant une lumière de qualité. Comment, au fil des siècles, les savants et les inventeurs ont-ils fait progresser l’éclairage?
Le plus vieux système d’éclairage utilisé par les hommes est sans doute la lampe à huile. Les lampes à huile primitives étaient constituée d’une pierre creuse remplie d’huile végétale dans laquelle trempait une mèche. Bien sûr, selon les pays et les époques, cette méthode connut des variantes, que se soit au niveau de la matière de la mèche ou de la constitution du « carburant ».
Par exemple, les Grecs utilisés des lampes en bronze décorées pour les cérémonies et en terre cuite pour l’usage domestique.
C’est au Moyen Age qu’apparaissent les bougies (suif durci autour d’une mèche). En France, dès les années1000, les bouchers fondaient des graisses animales pour fabriquer les bougies.
L’amélioration des lampes à huile au XVIIIème siècle visèrent à perfectionner l’éclairage et à stabiliser la flamme.
En 1784, le physicien Argand propose un bec à double courant d’air. La lampe est composée de deux tubes emboités qui l’alimente en air. La mèche devient circulaire ce qui assure une très bonne combustion de l’huile améliorant ainsi le rendement et la luminosité. La lampe d’Argand connue de nombreuses améliorations.
La lampe à tringle (inventée par Argand, Quinquet et Lange) est composée d’un réservoir d’huile renversé ce qui permet de réguler l’écoulement de l’huile. Cette lampe fonctionne sur le principe du vase de Mariotte.


La lampe à niveau constant et à réservoir latéral inventée vers 1780 par le chimiste Proust permet d’obtenir une flamme régulière.
En 1817, Eugène Chevreul découvrit l’acide stéarique. Cette découverte aboutit quelques années plus tard à la commercialisation de la bougie stéarique. Cette dernière est de meilleure qualité que la chandelle et peu chère de surcroît. En effet, les matières grasses qui la composent sont peu chères. Il est tout de même à noter que cette bougie a été développée dans la même période que l’éclairage au gaz, et pas avant.
La lampe au gaz connut une expansion importante dans les années 1800 grâce à la production industrielle de gaz par distillation de la houille (William Murdock). En 1829, Paris est éclairée au gaz. Cependant, l’éclairage au gaz n’a pas été à la portée de tous. Les campagnes ne connurent pas ce luxe.
La lampe à pétrole ou plutôt la lampe à huile éclairante de pétrole connut un grand succès vers 1860 suite à la découverte aux USA d’importants gisements de pétrole. Cette nouvelle huile va vite remplacer toutes les autres types d’huile et ira même jusqu’à inquiéter l’industrie de l’éclairage au gaz. Quant à la lampe à pétrole elle même, elle va substituer au bec Argand le bec Américain (mèche plate). Ce qui lui confèrera une fabrication et un entretient simple.
L’apport de l’électricité dans l’éclairage
En 1813, Humphry Davy (Anglais) branche aux bornes d’une pile de Volta deux pointes de charbon. Il se rendit compte qu’était générée une étincelle très lumineuse entre ces deux pointes lorsqu’on les rapprochait. Puis l’étincelle persistait si on éloignait lentement les deux pointes. A noter que l’étincelle dure plus longtemps lorsque l’expérience est réalisée sous vide. Mais ce dispositif reste l’apanage des démonstrations spectaculaires réalisées dans les amphithéâtres ou les laboratoires. En effet, aucune application possible n’y avait été trouvée pour l’instant.
Léon Foucault, (le savant Français qui est connu pour son pendule qui servit à démonter que la terre tourne), adapte l’invention de Humphry Davy à l’éclairage. Il substitua au charbon classique le charbon de cornue de gaz. Ce dernier a la particularité d’être peu combustible mais bon conducteur électrique. Léon Foucault mit un terme au problème posé par le fait qu’il faille bouger les charbons au cours de la vie de l’étincelle en réalisant un mécanisme.
La nécessité d’un mécanisme complexe qui régirait le mouvement du charbon fut un frein à l’essor de l’éclairage par arc électrique. Paul Jablochkoff (Russe) révolutionna la technologie de l’arc électrique en réalisant cet arc entre deux baguettes de charbon parallèles l’une à l’autre. Elles sont séparées par une substance isolante à froid et conductrice électrique à chaud (Plâtre ou Kaolin).

Ce dispositif est alimenté en courant alternatif car sinon le pole positif se consomme deux fois plus vite que le pole négatif. Pour information, une bougie Jablochkoff de 25cm de long et de 4 mm de large dure environ 1h30. C’est à partir de la mise au point de la bougie Jablochkoff que l’éclairage public électrique connu un essor significatif (1878). Ce type d’éclairage remplaça souvent les lampes à gaz qui furent source de nombreuses catastrophes humaines (incendies…). Les lampes à arc sont de nos jours guère utilisées.
En 1879, Edison va utiliser le principe de l’incandescence. La lampe à incandescence d’Edison, introduite en Europe en 1882 permit à l’électricité de pénétrer les foyers et les commerces.
La différence principale entre l’éclairage par arc électrique et par incandescence est la différence de gène occasionnée. A l’arc électrique gênant, l’incandescence apporte une lumière douce. Le principal problème technique des ampoules est le choix du filament. Après des mois de recherche, il découvrit que des tiges de bambou calcinées constituaient un bon filament. Cette solution technique connu une vie industrielle en 1881. La lampe à filament de carbone fut utilisée jusqu’à la fin du siècle dernier.
Plus la température du filament est élevée et plus la portion d’énergie rayonnée dans le domaine du visible est grande. Le but des constructeurs était donc d’atteindre une température élevée sans pour autant détruire le filament. En 1907, les filaments en tungstène font leur apparition, leurs propriétés physico-chimiques leurs permettent d’être chauffés à très haute température (point de fusion 3643°C) ce qui permet d’obtenir une efficacité lumineuse de l’ordre de 6 lm/W.
Les lampes halogènes sont des lampes à incandescence. Cependant, elles possèdent en plus des propriétés remarquables. Dans les lampes à incandescence classiques, le filament de tungstène s’évapore peu à peu, déposant un voile noir sur la surface interne de l’ampoule; l’efficacité lumineuse diminue. Dans les lampes halogènes, on a rajouté, et ce pour la première fois en 1959, en plus des gaz de remplissage habituels, des halogènes, iode ou brome, qui captent les atomes de tungstène avant qu’ils n’atteignent la paroi de verre, puis se déposent sur le filament: c’est le cycle régénérateur halogène. Cette réaction halogène-tungstène s’opère d’autant mieux que la distance filament verre est assez faible et que la température est élevée. Ce qui explique la forme des ampoules, courtes et fines, épousant au plus près le filament. Qui dit plus de chaleur dans un petit volume exige une enveloppe de verre capable de résister à plus de 600°C, température indispensable au cycle halogène, et a une pression de deux à trois atmosphères.
Depuis 1880, l’éclairage électrique par lampes à incandescence n’a cessé d’être perfectionné. A partir de 1930, des sources lumineuses d’une autre nature font leur apparition : les lampes à décharge qui ont un spectre de raies discontinu. Ces lampes ne possèdent plus de filament, mais deux électrodes placées dans une enveloppe remplie d’un gaz ou d’une vapeur métallique.
Le passage de la décharge électrique dans la vapeur de sodium à basse pression contenue dans l’ampoule provoque une émission lumineuse presque monochromatique située au début du spectre du visible vers 589 nm de longueur d’onde. Ces lampes de couleur orangé sont très souvent rencontrées dans l’éclairage public et routier, notamment dans les tunnels et sur les vieilles installations.
Il existe de nombreux types de lampes à décharge. Les lampes au sodium basse pression sont un type parmi de nombreux autres.
A l’heure actuelle, les ampoules à filament sont encore présentes dans les foyers. Mais elles ont disparu des lieux publics au profil des néons et des ampoules basses consommation. Les LEDs (Diodes Electroluminescentes) pourraient bientôt révolutionner l’éclairage, à condition d’améliorer la luminosité de ces dernières. En effet, elles ont un rendement nettement supérieur aux ampoules classiques. La lampe à diode électroluminescente, ou lampe à LED (abréviation de l’anglais Light-Emitting Diode), est un type de lampe électrique qui utilise des diodes électroluminescentes. Historiquement, les diodes électroluminescentes furent d’abord utilisées pour constituer des voyants lumineux en raison de leur tension d’alimentation adaptée à l’électronique et de leur longue durée de vie (témoins de veille ou de fonctionnement d’appareils électriques, signalisation, etc.). Puis, à la suite des avancées technologiques et de l’augmentation des puissances, elles sont devenues couramment utilisées pour l’éclairage. En 1907 : H. J. Round est le premier à mettre en évidence un phénomène d’électroluminescence ; en1927 : Oleg Losev dépose le premier brevet de ce qui sera appelé, bien plus tard, une diode électroluminescente et en 1962 : Nick Holonyak Jr., consultant chez General Electric invente la première LED à spectre visible utilisable.
Avec l’exposition internationale d’électricité qui se tint à Paris en 1881, l’électrification du monde était en marche. Toutes les grandes villes, unes à unes, connurent cette révolution. En France, alors que le peuple était enthousiasmé par l’électricité, elle mit du temps avant de devenir une réalité concrète pour tous. Surtout dans les milieux ruraux.
L’électricité apporta beaucoup à l’humanité. L’éclairage en fut une des principales applications. A l’heure actuelle, au début du troisième millénaire, outre la question des sources lumineuses, celle des moyens de les éclairer se pose.
Sources : http://www.led-fr.net/eclairage-historique.htm
22 – Rue des Moulins – Rochefort – Baie à meneaux du XIV°
Voir aussi :
Cette rue desservait un moulin à farine actionné par l’eau, c’était un lieu d’activité important du village, vous pouvez aussi voir les passages sous voûte caractéristiques des rues du Moyen Âge. La baie au dessus de vous rappelle que, depuis 1798, de nombreuses baies à meneaux ont été supprimées pour éviter le paiement d’un double impôt sur ce type d’ouverture: on peut remarquer que les constructions sur voûte contournaient aussi l’ imposition sur la surface au sol des bâtiments !
Si vous observez les angles de certaines rues, au sol, vous voyez la présence de « chasse-roues » évitant la détérioration du bâtiment par les roues de charrettes et tombereaux.


LES PASSAGES SOUS VOÛTE

CONSTRUCTIONS SUR VOUTE
Ce genre de construction est le dernier témoin des constructions de type médiéval qui surplombaient autrefois la rue. Il remonte à l’époque où la ville close, ne parvenant pas à contenir sa population, avait eu recours à ce moyen pour étendre son domaine habitable, à l’image de Paris et d’autres villes qui construisaient sur leurs ponts.
Des constructions similaires sont encore visibles au fil des rues du vieux village. Certaines ont disparues au XIX° siècle, victimes de transformations ou d’aménagements.


LES CHASSE-ROUES
Un chasse-roue, appelé aussi chasse-moyeux, est une pièce métallique ou en pierre située au pied d’une porte cochère ou d’un mur et qui est destinée à empêcher les roues de détériorer le mur. On le désigne également par boute-roue ou bouteroue et il a parfois pour synonyme garde-grève (garde-heurt en Normandie).
Les chasse-roues se sont développés depuis l’Antiquité pendant toute l’époque des transports avec des voitures ou charrettes à cheval.
La conduite de ces véhicules était parfois délicate pour un cocher malhabile ou avec des chevaux rétifs. De plus, les roues et notamment leur moyeu dépassait à l’extérieur du véhicule. Le risque était donc élevé que la roue ou son moyeu heurte et dégrade les montants d’une porte cochère ou le coin d’un mur. Au Moyen Âge, les chasse-roues sont généralement des murets aménagés à la base du parapet d’un pont ou des bornes demi-circulaires appelées bornillon.
Le chasse-roue remettait « dans le droit chemin » le véhicule… moyennant une forte secousse pour les passagers !
De très nombreux exemplaires ont été implantés dans le cadre du style haussmannien, par exemple à Paris.
Ce sont des pièces le plus souvent métalliques en forme d’arc, de boule, de cônes ou de motif décoratif original. Il existe aussi des modèles en pierre dure, avec une forme inclinée pour rabattre les roues vers l’intérieur.
Autres localisations de chasse-roues, généralement en pierre de forme inclinée ou conique :
- Entrée des portes de fermes, franchies par des lourds chariots chargés de foin par exemple.
- Angles de mur à l’intersection de deux rues (avant l’implantation des trottoirs). Dans ce cas, ils étaient souvent dans la même pierre que le mur et en constituaient en quelque sorte un prolongement.
- Virages de routes campagnardes ou le long de parapets de ponts.
- Virages en montée. Dans ce dernier cas, ils permettaient aussi au cocher d’arrêter le véhicule pour laisser souffler les chevaux.
Les chasse-roues en pierre étaient souvent cerclés d’un anneau métallique pour diminuer l’usure.
En ville, les chasse-roues sont devenus obsolètes depuis longtemps. Mais construits sous forme d’un arceau en métal plein ou en pierre, ils sont difficiles à détruire ou gardés pour leur intérêt historique.


Un autre ouvrage caractéristique d’angle de mur : les « pisse-pas-là ». Ces ouvrages sont destinés à préserver les angles des murs de l’urine des passants. Il en existe différents modèles plus ou moins efficaces.

L’IMPÔT SUR LES PORTES ET FENÊTRES
L’impôt sur les portes et fenêtres ou impôt sur les fenêtres est un type d’impôt basé sur le nombre des fenêtres et/ou des portes des bâtiments. En France, l’impôt sur les portes et fenêtres a été mis en place par le Directoire, pendant la Révolution, le 4 frimaire an VII (24 novembre 1798), et supprimé en 1926..
Cet impôt fait partie des « quatre vieilles » contributions directes, avec la contribution foncière, la mobilière, et la contribution des patentes, toutes trois établies par l’assemblée constituante de 1789. Son assiette était établie sur le nombre et la taille des portes et fenêtres. Il ne touchait ainsi que les propriétaires, et introduisait une sorte de proportionnalité, les plus aisés payant également plus d’impôts. Sa création fut accompagnée de celle d’un autre impôt du même type, l’impôt sur les parcs et jardins
Il ne touchait pas les ouvertures des bâtiments à vocation agricole, ni les ouvertures destinées à aérer les caves (soupiraux) ou pratiquées dans les toits (lucarnes, vasistas). Les bâtiments publics n’étaient pas imposés non plus.
Cet impôt fut accusé de pousser à la construction de logements insalubres, avec de très petites ouvertures, donc sombres et mal aérés, et il conduisit à la condamnation de nombreuses ouvertures, ainsi qu’à la destruction, par les propriétaires eux-mêmes, des meneaux qui partageaient certaines fenêtres en quatre, ce qui augmentait substantiellement l’impôt. Étaient aussi construites des fausses-fenêtres, sans ouverture pour échapper à l’impôt, avec parfois des dessins en trompe-l’œil.
Dans le système censitaire de la monarchie de Charles X, le cens était calculé essentiellement sur la foncière, pour favoriser un corps électoral de grands propriétaires. En 1830, peu avant la révolution de juillet, une nouvelle restriction supprime totalement la patente et l’impôt sur les portes et fenêtres du calcul du cens, privant d’accès au vote la bourgeoisie urbaine.
Dans l’entre-deux-guerres, comme il conduisait à une double taxation avec l’impôt sur le foncier bâti, qu’il était d’un faible rapport (60 millions de francs français par an à sa suppression), il faisait l’objet de dispenses pendant 10 ans pour les habitats sociaux (H.B.M) depuis le début du siècle, et sous l’influence des hygiénistes, sa suppression fut obtenue en 1926.
Dominique Ramel, dit Ramel de Nogaret, député de l’Aude et ministre des Finances du Directoire, remet à plat le système fiscal hérité de la Révolution.
Après la « banqueroute des deux tiers », il instaure le 24 novembre 1798 un nouvel impôt sur les portes et fenêtres, qui a l’avantage de pouvoir être établi depuis la rue par les agents du fisc sans contestation possible. Il fait référence à un précédent britannique et mieux encore à l’ostiarum, un impôt créé par Jules César !
Croyant à une mesure temporaire, le gouvernement français réhabilite à cette occasion le nom ancien d’impôt au lieu du nom plus convenable de « contribution » introduit par l’Assemblée Constituante dix ans plus tôt. Dans les faits, le nouvel impôt ne sera aboli que par le Cartel des gauches, en 1926.
Très impopulaire en France comme en Angleterre et dans les pays européens où les armées révolutionnaires vont l’introduire, l’impôt sur les portes et fenêtres a pour effet de réduire le nombre d’ouvertures dans les habitations, au détriment de la santé publique. À Londres, une hausse de cet impôt en 1820 a pour conséquence le développement du rachitisme, aussitôt qualifié de « mal anglais ». Autre conséquence dommageable : les fenêtres à meneaux héritées de la Renaissance sont détruites en masse car, pour les agents du fisc, elles équivalent à quatre fenêtres !

Loi sur l’impôt sur les portes et fenêtres
Le 24 novembre 1798 (4 frimaire an VII), le gouvernement français créa une sorte d’impôt sur les signes extérieurs de richesse. La décision se présentait ainsi :
Article premier : Il y aura pour l’an VII une contribution réglée de la manière suivante :
Article 2 : Cette contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la République, et dans les proportions ci-après.
Article 3 : Les portes et fenêtres, dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, payeront 0 fr 20; de cinq à dix mille, 0 fr 25 ; de dix à vingt-cinq mille, 0 fr 30; de vingt-cinq à cinquante mille, 0 fr 40; de cinquante à cent mille, 0 fr 50; de cent mille et au-dessus, 0 fr 60. Les portes-cochères et celles de magasins, de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, payeront double contribution.
Article 4 : Dans les communes au-dessus de dix mille âmes, les fenêtres des troisième, quatrième et cinquième étages et au-dessus ne payeront que 0 fr 25.
Article 5 : Ne sont pas soumises à la contribution établie par la présente les portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l’habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toitures des maisons habitées.
Ne sont pas également soumises à ladite contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices.
Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la République ne doit point de logement d’après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu’ils occuperont.
Article 6 : Les municipalités seront tenues, dans les dix jours de la réception de la présente loi, de faire, ou de faire faire par des commissaires, l’état des portes et fenêtres sujettes à l’imposition.

23 – Rue de la croisière – ancien péage
Voir aussi :
- La route de l’étain
- Péages
- La mansio
- Voies anciennes
De l’Antiquité au XVIIIeme siècle
Depuis 500 av J.C., la cité se trouvait sur une des branches de la route grecque de l’étain (entre Nantes et la Méditerranée). La traversée de la Drôme se faisait à gué, parfois très difficilement.
A l’époque romaine, après l’installation d’un pont, d’une largeur de 4 mètres permettant le croisement de deux chars, l’entrée sud du village s’effectuait par cette rue.
Du XIIIeme au XVIIIeme siècle, un péage servait à payer les frais de réparation de la voie d’accès et du pont victimes des crues torrentielles de la Drôme – qui parfois emportaient aussi une partie des remparts et des maisons –
A partir du 17ème siècle, l’étroitesse de la rue pose des problèmes de circulation!
A l’époque il était courant d’entendre : « Qué dins Osto vô possa. Tré jours dovan do se prepara », ce qui signifiait « Qui doit passer à Aouste. Trois jours durant doit s’y préparer ».

24 – Place de la Poste
Voir aussi :
Depuis l’Antiquité, une maison abritait une grande inscription aux dieux mânes. Sur cette place se trouvait le premier temple d’Aouste édifié au milieu du XVIeme siècle , il est rasé en 1683, sur ordre de Daniel De Cosnac, évêque de Valence, l’emplacement est donné pour construire l’église !
À la fin du XIXeme siècle divers bâtiments et l’église sont détruits pour créer une « avenue » entre l’église et la gare, des platanes vont décorer la nouvelle place.(Voir le document « construction de l’église actuelle d’Aouste » – fiche 16 l’église )
Vers le café-restaurant , vous pouvez voir une façade construite en 1905, prémices de « l’art déco ».
Sur l’emplacement de l’actuelle poste, on trouvait le jardin du curé avant que l’on y édifie une mairie-école, bâtiment agrandi en 1897 et utilisé ainsi jusqu’en 1913.
La première demande de création d’un bureau de poste à Aouste date de 1860, elle est longuement motivée par une population de 1200 âmes et une « industrie considérable, on y compte deux papeteries, une importante fabrique de soie, deux ateliers assez considérables de foulons de draps, des moulins à farines, pressoirs a huile, des fours a chaux, des chapeliers…. et un assez grand nombre des ouvriers … »
Le 1er août 1861, Aouste se voit attribuer un « facteur-boitier ». Le 1er janvier 1870, le premier bureau est créé et le 16 juin 1886, ouverture de la télégraphie.



25 – Place de la mairie – Ecoles Jules Ferry- Architectures du XX°s
Voir aussi :
- Sur les chemins de l’école …. de 1629 à 1913
- Le corps électoral à Aouste 1832 – 1863 ou l’apprentissage de la démocratie au XIXe siècle.
- Communauté, Consuls et Maires d’Aouste de 1625 à 2014
- Engagement d’un professeur à Crest en 1515
- Fresque
XXeme SIECLE
Depuis l’avènement de la IIIeme République, la commune était confrontée à un manque de locaux scolaires ; un projet d’une école fut établi en 1881 pour deux classes de 42 élèves – garçons et filles séparés -, et d’une école enfantine de 60 élèves, ce projet n’a jamais abouti.
De 1906 à 1913, l’ensemble, mairie-école est édifié au sud de la commune, le bâtiment n’a que peu évolué, on peut encore voir les lampadaires originaux. C’est un bâtiment assez habituel avec une classe pour 48 garçons et 48 filles; au centre la mairie, deux cours avec un préau et un mur séparant filles et garçons, le logement des instituteurs à l’étage, un jardin à l’arrière et un terrain de sport.
Afin de répondre à l’évolution de la population, en 1946, une école sera ouverte quartier Saint Alban puis transférée en 1961 route du Pas de Lauzens, elle est ensuite fermée en 1985.
Ici, sur l’arrière, en 1978, sera ajouté un bâtiment en béton armé accueillant les classes maternelles.
Devant ce bâtiment, mairie-école, une esplanade a été édifiée au début du XXeme siècle en surélévation par rapport à la Drôme. Elle correspond aux aménagements urbains de cette époque, c’est une promenade ombragée, avec des bancs et vision dominante sur la rivière ; c’est un lieu de sociabilité informelle à l’extérieur de l’ancienne cité, un espace éloigné des cafés et le reflet des préoccupations hygiénistes de lutte contre l’alcoolisme.
Sur le côté ouest de cette esplanade, a été édifiée, de 1936 à 1939, la « salle d’éducation populaire », un bâtiment conçu pour accueillir des représentations théâtrales avec une vaste scène et une grande tribune en plan incliné ; cette construction semble inspirée par les idées éducatives de Jean Zay. L’actuelle salle des fêtes a peu changé depuis 80 ans, elle a même gardé sa couleur originelle !
En juin 2018, une fresque de 80 m² viendra illustrer le pignon ouest du bâtiment. Cette œuvre, colorée et onirique, évoque l’enfance par les choix graphiques retenus en mettant en scène trois oiseaux d’espèce présentes en vallée de la Drôme.

E1- Canal Soubeyran
Bienvenue à Aouste-sur-Sye, bienvenue pour une approche de l’histoire locale !
Au centre-village, promenez vous dans une cité millénaire guidés par 26 panonceaux explicatifs et par des clous de voirie à l’effigie de l’empereur Auguste. La cité gallo romaine lui fut dédiée.
La Vélodrôme emprunte, ici, sur quelques dizaines de mètres, le tracé du canal dit de Soubeyran. Dés 1342 ce canal, rive gauche de la Drôme, alimentait à Crest des moulins puis l’industrie textile. La prise d’eau se situait à 100 mètres en amont, en direction d’Aouste, cette « vanne de décharge » est un des vestiges.

Depuis le Moyen Âge, l’activité économique d’Aouste et Crest était liée au textile, et, ensuite, à la papeterie. Les canaux de la Sye, de la Gervanne et de la Drôme fournissaient l’énergie motrice. Amélioration de la circulation de l’eau et nouvelles turbines (inventées dans la première partie du XIXe siècle) ont permis un fantastique développement économique. Vers 1920, 9 canaux alimentaient localement:une tannerie, une usine à billes, trois papeteries et six usines textile, à Aouste, Crest, Mirabel et Blacons, prés de 1000 emplois dépendaient du bon fonctionnement des canaux.
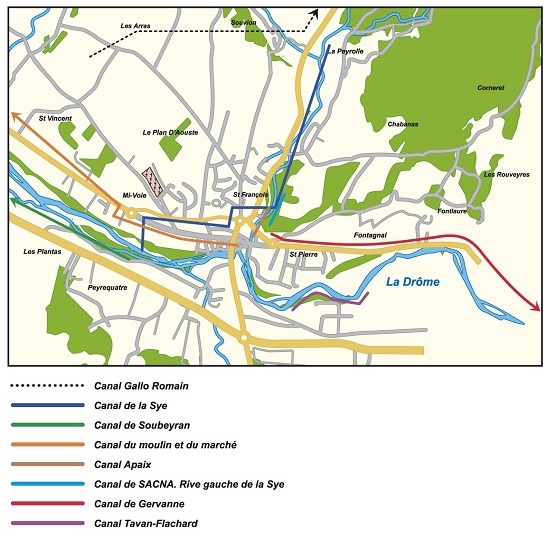
E2 – Canal Tavan-Flachard (en cours d’installation)
Bienvenue à Aouste-sur-Sye, bienvenue pour une approche de l’histoire locale! Au centre-village, découvrez une cité millénaire guidés par 26 panonceaux explicatifs et par des clous de voirie à l’effigie de l’empereur Auguste. La cité gallo romaine lui fut dédiée.
De tous temps, fils et tissus ont été fabriqués à Aouste-sur-Sye. À la fin du Moyen-Âge, l’utilisation de la force motrice de nouveaux canaux permit le développement de ces activités. Ce bâtiment abritait une ancienne usine textile. L’eau de la rivière Drôme, détournée depuis la commune de Piégros-La-Clastre à 1,5 km en amont, alimentait le canal.



Agrandie en 1920 par une famille de soyeux lyonnais « Les Flachard », cette usine employait jusqu’à 120 personnes vers 1930.
Suite au projet de fermeture deux salariés créent « MDC » -Manufacture Drômoise de Confection. 2007 a vu la cessation de toutes activités textiles.